Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier
Agit à des fins professionnelles, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, l’agent général d’assurance qui demande le paiement de l’indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents d’assurance et ce, quand bien même il aurait cessé son activité à la date de la demande. Le taux de l’intérêt légal applicable en cas de retard dans le paiement de cette indemnité n’est donc pas celui applicable aux particuliers.
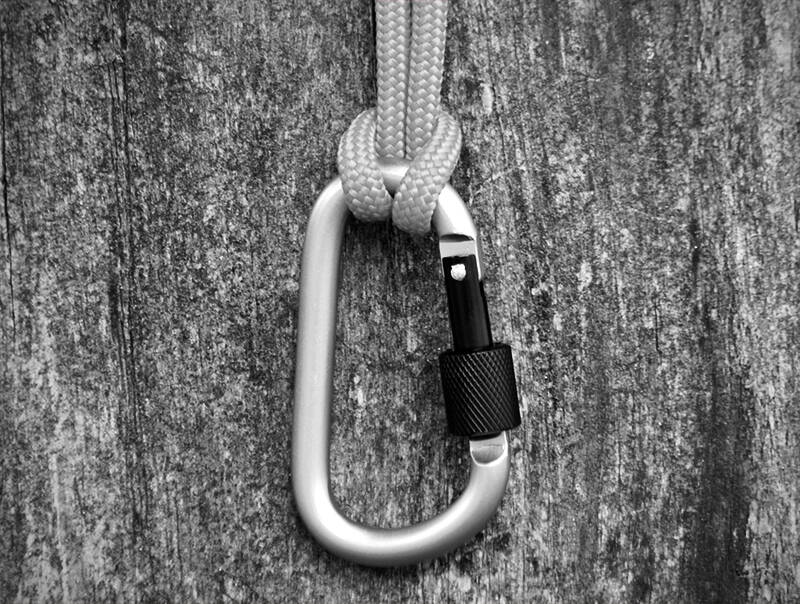
L’importance de l’indemnité de cessation du contrat d’agence
Bien que le statut d’agent d’assurance déroge à celui d’agent commercial, il reste que les deux partagent un trait commun essentiel : l’attribution d’un droit à indemnisation en cas de cessation des relations avec l’agent. C’est même précisément cette question qui, comme pour les agents commerciaux (pour lesquels, v. F. Buy, M. Lamoureux et J.-C. Roda, Droit de la distribution, 2e éd., LGDJ, coll. « Manuel » 2019, p. 46, n° 35), a justifié l’adoption d’un statut spécial dès 1927 (sur ces développements historiques, v. J. Bigot et al., La distribution d’assurance, 3e éd., LGDJ, coll. « Traité de droit des assurances », 2020, t. 2, p. 531 s.). Aujourd’hui, le droit à l’indemnité de fin de contrat est légalement reconnu par l’article L. 540-1, alinéa 2, du code des assurances et rappelé à l’article 1er, alinéa 6, de l’annexe du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances (adopté sur le fondement de l’anc. art. L. 520-2 c. assur., devenu en 2005 l’art. L. 540-2).
Le retard de paiement de l’assureur.
Cela fait donc près d’un siècle que le droit positif reconnaît ce droit à indemnisation de l’agent général d’assurance en cas de cessation de ses activités. Et pourtant, le versement de ces indemnités peut encore se faire avec un retard considérable. L’affaire ayant donné lieu à la décision du 15 février 2024 ici commentée l’illustre parfaitement. En l’espèce, les sociétés Allianz IARD et Allianz vie ont été condamnées à payer à un agent d’assurance éconduit la somme de 407 878 € avec intérêts à compter du 1er novembre 2014. Ce n’est que six ans plus tard, le 9 juillet 2020, que la somme de 435 423,23 € (correspondant au capital, auquel se sont ajoutés 27 545,23 € d’intérêts de retard) lui fut finalement versée.
La détermination du taux d’intérêt légal applicable
Ces retards de paiement rendent essentielle la question de la détermination du taux de l’intérêt légal alors applicable (sur la question des intérêts moratoires, v. Rép. civ., v° Intérêts des sommes d’argent, par F. Gréau, spéc. nos 70 s.). On sait que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (C. civ., art. 1231-6, al. 1er, reprenant en modernisant quelque peu son énoncé l’anc. art. 1153 c. civ. ; on sait en effet que la réforme du droit des obligations opérée en 2016 n’a en principe fait que renuméroter les dispositions relatives à la responsabilité civile) et que « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement » (C. civ., art. 1231-7, reprenant l’anc. art. 1153-1 c. civ.). On sait aussi que, depuis l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal (sur laquelle, v. F. Fruleux et J.-M. Serre, Réforme du taux de l’intérêt légal. Nouveautés, évolutions et choix fiscaux, JCP E 2014. 1666), deux taux sont désormais prévus au titre de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le 1er janvier 2015, et comme le rappelle la Cour de cassation dans sa solution, « le taux de l’intérêt légal comprend », d’une part, « un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels » et, d’autre part, « un taux applicable dans tous les autres cas ». La détermination du taux applicable sera justement le cœur de l’affaire ici commentée. L’agent considérait relever du taux d’intérêt légal des particuliers, et non de celui applicable aux professionnels. L’enjeu est loin d’être négligeable lorsque l’on sait que, sur toute la période comprise entre 2015 et 2020, les taux d’intérêt légaux applicables aux particuliers et aux professionnels marquaient une différence d’environ trois points (le taux d’intérêt légal applicable aux professionnels oscillaient aux alentours de 1 % en 2015 pour descendre progressivement à 0,87 % au 1er semestre 2020, tandis que le taux applicable aux particuliers est passé d’un peu plus de 4 % en 2015 à 3,15 % au 1er semestre 2020 ; avant la réforme de 2014, le taux de l’intérêt légal était tombé à 0,04 % en 2013 et 2014, v. sur ce chiffre, J.-F. Hamelin, Rev. sociétés 2022. 483 ![]() ).
).
La demande en paiement d’indemnité de cessation des fonctions d’agents d’assurance a-t-elle une finalité professionnelle ?
La qualité de personne physique de l’agent d’assurance ne faisant aucun doute, tout revenait finalement à se demander si l’on pouvait considérer qu’en introduisant une action en paiement de l’indemnité de cessation des fonctions prévue par le statut des agents d’assurance, ce dernier agissait ou non pour des besoins professionnels au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier.
Les arguments du pourvoi contre la qualification professionnelle
C’est bien contre cette qualification que l’agent d’assurance, débouté de ses demandes par la cour d’appel, entendait s’élever par son pourvoi en cassation. Il reprochait, d’abord, à la cour d’appel d’avoir retenu que la créance d’indemnité était née « au titre » d’une activité professionnelle, critère effectivement absent de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Il lui reprochait, ensuite et surtout, de ne pas avoir caractérisé, en plus du fait que la créance soit née dans l’exercice d’une activité professionnelle, le fait que celle-ci entretenait un rapport direct avec ladite activité professionnelle. Il reprochait, enfin, aux juges d’avoir retenu la qualification professionnelle alors que la demande de versement de l’indemnité avait été introduite après la cessation de l’activité.
Rejet du pourvoi par la Cour de cassation
Ces arguments ne convaincront pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. Elle énonce de manière générale que « [n]’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de [l’article L. 313-2 du code monétaire et financier], le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui », d’une part, « n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et », d’autre part, « ne se trouve pas en rapport direct avec son activité ».
Elle en déduit que, « l’action en paiement de l’indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents d’assurance, ayant pour objet de compenser la perte du droit à commissions perçues lorsqu’ils étaient agents généraux d’assurance », les demandeurs « ont agi pour des besoins professionnels au sens de [l’article L. 313-2 du code monétaire et financier] » et ce, « bien qu’ayant cessé leur activité à la date de leur demande ». Si la solution nous paraît tout à fait fondée d’un point de vue pratique, les critères de détermination de la nature professionnelle de l’action nous paraissent, quant à eux, et sous un angle théorique, plus discutables.
Le caractère professionnel indiscutable de la demande en recouvrement de l’indemnité de cessation de contrat
D’un point de vue pratique, d’abord, il ne nous semble guère faire de doute que la créance dont le paiement est demandé est bien née dans le cadre d’une activité professionnelle et a bien un lien direct avec celle-ci. C’est que, comme le rappelle la Cour, la raison d’être de cette indemnité réside dans le fait « de compenser la perte du droit à commissions perçues lorsque [les demandeurs] étaient agents généraux d’assurance ». C’est donc que le fait générateur de cette indemnité réside dans les créances indubitablement professionnelles nées à l’occasion de l’exécution du contrat d’agence. Cette indemnité participant par ailleurs de l’essence même du statut d’agent général d’assurance, le fait que la demande en paiement intervienne après la cessation de l’activité, devrait être sans incidence sur sa nature professionnelle. La situation est bien distincte de celle évoquée par le précédent jurisprudentiel qui a très certainement inspiré le pourvoi et dans lequel la Cour de cassation a considéré que la demande en recouvrement du prix de cession de parts sociales n’avait pas de caractère professionnel (Com. 9 mars 2022, n° 20-11.845, Dalloz actualité, 21 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508 ![]() ; Rev. sociétés 2022. 483, note J.-F. Hamelin
; Rev. sociétés 2022. 483, note J.-F. Hamelin ![]() ). C’est que l’activité professionnelle est exercée par la société elle-même et non par ses associés et que le fait que le cédant soit également le gérant de la société, et donc simple mandataire de celle-ci, ne change rien à l’affaire (J.-F. Hamelin, préc., spéc. n° 8).
). C’est que l’activité professionnelle est exercée par la société elle-même et non par ses associés et que le fait que le cédant soit également le gérant de la société, et donc simple mandataire de celle-ci, ne change rien à l’affaire (J.-F. Hamelin, préc., spéc. n° 8).
Les critères de qualification discutables des « besoins professionnels » de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier
C’est de ce même précédent (Com. 9 mars 2022, n° 20-11.845, préc.) que la Cour de cassation reprend mot pour mot, dans l’affaire commentée, son principe de définition de celui qui « n’agit pas pour des besoins professionnels ». L’inspiration certainement puisée dans la définition du consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation avait été relevée par plusieurs commentateurs au sujet de la décision de la chambre commerciale de 2022 (v. entre autres les notes préc.). Elle est ici très certainement la même sous la plume, cette fois, de la deuxième chambre civile. Cependant, outre le fait que le caractère cumulatif des deux critères employés par la Cour semble critiquable (J.-F. Hamelin, préc., n° 6), force est de constater que le critère du « rapport direct » avec l’activité professionnelle ne figure pas dans la définition légale du consommateur ou du professionnel (il s’agit là de l’ancien critère employé par la jurisprudence, v. Y. Picod et N. Picod, Droit de la consommation, Dalloz, coll. « Université », p. 48, n° 40).
Plus généralement, il nous semble regrettable que les magistrats n’aient pas jugé opportun de reprendre mot pour mot les définitions issues du droit de la consommation, lesquelles, mettant en avant la finalité de l’acte (J. Calais-Auloy et al., Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 8, n° 7) et non le fait que « la créance soit née dans l’exercice » de l’activité professionnelle, nous semblent plus en phase avec le critère de la personne « n’agissant pas pour des besoins professionnels » évoqué par l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. À moins d’assumer une subtile mais véritable différence d’approche entre le droit de la consommation et le droit financier, mais cela ne semble pas avoir été l’intention initiale du législateur (v. sur ce point, Dalloz actualité, 21 mars 2022, obs. C. Hélaine, préc.)…
Civ. 2e, 15 févr. 2024, F-B, n° 22-17.751
© Lefebvre Dalloz