Article 750-1 du code de procédure civile : l’épilogue ?
Par un arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une pierre à l’édifice des questions soulevées à l’occasion des péripéties de l’article 750-1 du code de procédure civile et, plus particulièrement, s’agissant de la mise en œuvre de la modulation dans le temps de son annulation contentieuse par le Conseil d’État.
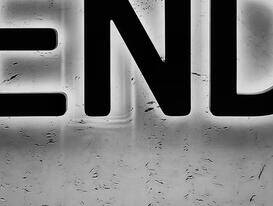
Il est des affaires emblématiques que l’on expose régulièrement à nos étudiants à la fois pour éclairer la démonstration, mais aussi pour marquer les esprits. L’histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est peut-être pas aussi palpitante que certains grands arrêts du droit pénal, mais elle permet, à elle seule, d’illustrer de nombreuses notions abordées dans un cours d’introduction au droit privé. Compétences respectives des pouvoirs législatif et réglementaire, entrée en vigueur de la loi, contrôle a priori de constitutionnalité, réserve d’interprétation, contrôle de légalité, modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse, sont autant d’éléments mis en lumière au cours des aventures de cette disposition.
Cette « extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile » (G. Maugain, L’extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile, Dalloz actualité, 23 mai 2023) a déjà été narrée. Afin de bien comprendre les enjeux de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2025, nous reprendrons toutefois les principales étapes du récit, avant de nous concentrer sur le dénouement que semble constituer cette décision.
Situation initiale. Au commencement, une volonté législative : celle de promouvoir les modes de résolution amiable des différends et d’étendre le préalable amiable obligatoire instauré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (art. 4). C’est l’objectif poursuivi par l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite « loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », qui tend à instaurer une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative obligatoire préalablement à la saisine du juge « lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ». Ce même article poursuit avec des exceptions à ce préalable amiable obligatoire, prévoyant notamment une dispense de recours à l’un des modes de résolution amiable en présence d’un motif légitime, lequel peut consister en « l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ».
Élément perturbateur. À l’origine des chamboulements : la saisine du Conseil constitutionnel par la voie d’un contrôle préalable de constitutionnalité de la loi du 23 mars 2019. Si le Conseil constitutionnel, au sein de sa décision « la plus longue de son histoire » (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2018-778 et 2019-779 DC, Commentaire des décisions, p. 2), n’a pas censuré l’article 3 de ladite loi, il a toutefois assorti sa validation d’une réserve d’interprétation suivant laquelle « il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de "motif légitime" et de préciser le "délai raisonnable" d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent » (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, Dalloz actualité, 25 mars 2019, obs. P. Januel ; ibid., 25 mars 2019, obs. T. Coustet ; AJDA 2019. 663 ![]() ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ![]() ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ![]() ; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet
; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet ![]() ; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt
; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt ![]() ; JCP 2019. 359, obs. A. Botton ; CCE 2019. Comm. 34, obs. A. Lepage ; Dr. pénal 2019. Alerte 26, obs. W. Roumier ; Procédures 2019. Comm. 172, obs. J. Buisson ; Gaz. Pal. 7 mai 2019, n° 17, p. 44, obs. F. Fourment ; LPA 15 juill. 2019, n° 140, p. 3, obs. J.-P. Derosier).
; JCP 2019. 359, obs. A. Botton ; CCE 2019. Comm. 34, obs. A. Lepage ; Dr. pénal 2019. Alerte 26, obs. W. Roumier ; Procédures 2019. Comm. 172, obs. J. Buisson ; Gaz. Pal. 7 mai 2019, n° 17, p. 44, obs. F. Fourment ; LPA 15 juill. 2019, n° 140, p. 3, obs. J.-P. Derosier).
Les péripéties. Se succèdent alors plusieurs rebondissements. Le pouvoir réglementaire, par décret d’application n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a donné naissance à l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa première mouture applicable à compter du 1er janvier 2020. Cet article prévoyait une obligation, à peine d’irrecevabilité, d’effectuer une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute saisine du juge pour certains litiges (à savoir, ceux qui tendaient au paiement du somme n’excédant pas 5 000 € et les actions mentionnées aux art. R. 211-3-4 et R. 211-3-8 COJ).
Le même texte envisageait des dispenses à cette obligation et notamment « si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable […] est justifiée par un motif légitime tenant […] à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ». Le coup de baguette magique transformant les termes « délai raisonnable » par ceux de « délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige » n’a cependant pas suffi à convaincre du respect de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’État fut ainsi saisi d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 décembre 2019. Dans sa décision du 22 septembre 2022 (CE, ch. réun., 22 sept. 2022, Conseil national des barreaux et autres, n° 436939, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. M. Barba ; ibid., 4 oct. 2020, obs. M. Barba ; Lebon ![]() ; AJDA 2022. 1817
; AJDA 2022. 1817 ![]() ; D. 2022. 1912
; D. 2022. 1912 ![]() ; ibid. 2096, entretien M. Barba
; ibid. 2096, entretien M. Barba ![]() ; ibid. 2023. 571, obs. N. Fricero
; ibid. 2023. 571, obs. N. Fricero ![]() ; Rev. prat. rec. 2023. 34, chron. B. Gorchs-Gelzer
; Rev. prat. rec. 2023. 34, chron. B. Gorchs-Gelzer ![]() ), il a annulé « l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué » au motif de l’imprécision des modalités et du ou des délais qui permettraient d’établir l’indisponibilité des conciliateurs de justice. Le Conseil d’État a décidé, en outre, de faire usage de son pouvoir de modulation dans le temps de la portée de l’annulation ainsi prononcée (CE, ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886, Lebon avec les concl.
), il a annulé « l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué » au motif de l’imprécision des modalités et du ou des délais qui permettraient d’établir l’indisponibilité des conciliateurs de justice. Le Conseil d’État a décidé, en outre, de faire usage de son pouvoir de modulation dans le temps de la portée de l’annulation ainsi prononcée (CE, ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886, Lebon avec les concl. ![]() ; AJDA 2004. 1183
; AJDA 2004. 1183 ![]() , chron. C. Landais et F. Lenica
, chron. C. Landais et F. Lenica ![]() ; ibid. 1049, tribune J.-C. Bonichot
; ibid. 1049, tribune J.-C. Bonichot ![]() ; ibid. 1219, étude F. Berguin
; ibid. 1219, étude F. Berguin ![]() ; ibid. 2014. 116, chron. J.-E. Schoettl
; ibid. 2014. 116, chron. J.-E. Schoettl ![]() ; D. 2004. 1499, et les obs.
; D. 2004. 1499, et les obs. ![]() ; ibid. 1603, chron. B. Mathieu
; ibid. 1603, chron. B. Mathieu ![]() ; ibid. 2005. 26, obs. P.-L. Frier
; ibid. 2005. 26, obs. P.-L. Frier ![]() ; ibid. 2187, obs. C. Willmann, J.-M. Labouz, L. Gamet et V. Antoine-Lemaire
; ibid. 2187, obs. C. Willmann, J.-M. Labouz, L. Gamet et V. Antoine-Lemaire ![]() ; Just. & cass. 2007. 15, étude J. Arrighi de Casanova
; Just. & cass. 2007. 15, étude J. Arrighi de Casanova ![]() ; Dr. soc. 2004. 762, étude P. Langlois
; Dr. soc. 2004. 762, étude P. Langlois ![]() ; ibid. 766, note X. Prétot
; ibid. 766, note X. Prétot ![]() ; RFDA 2004. 438, note J.-H. Stahl et A. Courrèges
; RFDA 2004. 438, note J.-H. Stahl et A. Courrèges ![]() ; ibid. 454, concl. C. Devys
; ibid. 454, concl. C. Devys ![]() ).
).
La formulation employée par le Conseil, à cette occasion, a cependant suscité des interrogations. En effet, ce dernier a précisé que « Les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué dans la mesure précisée au point 43 avant son annulation […] sont définitifs, sous réserve des actions engagées à la date de la présente décision ». Or, d’une part, l’annulation de l’article 4 du décret de 2019 laissait subsister l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dans sa version initiale, laquelle doit cependant être considérée comme inapplicable dès lors que le préalable obligatoire de conciliation était prévu uniquement pour la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe, ce tribunal, comme ce mode de saisine, n’existant plus respectivement depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019. D’autre part, si le sort des décisions définitives apparaissait fixé, quid de la réserve émise pour les « actions engagées à la date » de la décision du Conseil d’État ? C’est la question à laquelle répond l’arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025.
Encore faut-il, cependant, faire état d’un nouvel épisode dans les aventures de l’article 750-1 : le législateur a remis son ouvrage sur le métier et a réintroduit l’article 750-1 au sein du code de procédure civile par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, lequel précise désormais notamment que l’indisponibilité de conciliateurs de justice peut être une cause de dispense au préalable obligatoire lorsqu’il entraîne « l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ». Cette nouvelle mouture du texte étant applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, il persiste donc « une période incertaine de près d’un an » (V. Egéa, Nouvel article 750-1 du CPC : le préalable amiable obligatoire enfin précisé !, JCP 2023. Actu. 596), période pendant laquelle de nombreux commentateurs ont appelé les praticiens à la prudence (v. not., en ce sens, M. Barba, Contrôle de légalité de la réforme de la procédure civile de 2019 : retour vers le futur au Conseil d’État [Deuxième partie : le champ d’annulation], Dalloz actualité, 4 oct. 2022 ; S. Amrani-Mekki, Annulation du préalable amiable obligatoire et autres validations procédurales – À propos de la décision du Conseil d’État du 22 septembre 2022, JCP 2022. Actu. 1186).
Le dénouement. C’est justement à propos de cette période d’incertitude que la Cour de cassation a été saisie. Le litige à l’origine de la saisine est un différend relatif au paiement d’une somme (inférieure à 5 000 €) au titre du solde d’un contrat d’architecte. Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, par jugement du 31 mai 2022, avait déclaré irrecevable la demande de l’architecte au motif de l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal.
Un pourvoi en cassation est formé le 9 août 2022 par l’architecte dont les moyens ne sont pas reproduits, mais la Cour de cassation relève d’office un moyen. Ainsi, au visa, de l’article 750-1 du code civil, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, elle rappelle que ce texte a fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État le 22 septembre 2022 et considère que l’instance litigieuse étant « atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige ».
La solution n’est pas inattendue. La Direction des affaires civiles et du Sceau, dans une dépêche en date du 22 septembre 2022, avait précisé, s’agissant de la modulation dans le temps des effets de l’annulation consécutive à la décision du Conseil d’État du 22 septembre 2022, que, « ramenée à la procédure civile, la notion d’"actions engagées à la date" de la décision du Conseil d’État ne peut s’interpréter qu’au travers de celle d’instance en cours », ajoutant que « par conséquent, il n’est plus possible, dans l’ensemble des instances en cours, de prononcer ou de confirmer l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, même si au jour de la demande celle-ci n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ». De plus, la Cour de cassation a déjà eu récemment l’occasion de rendre une décision identique, mais non publiée (Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 22-21.597).
L’arrêt rendu le 6 février 2025, s’il fait l’objet cette fois-ci d’une publication au Bulletin, ne vient que confirmer une solution déjà acquise. Pour autant, cette solution peut paraître surprenante aux yeux des parties et, en ce qui concerne le présent litige, au client de l’architecte. En effet, à la date du jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio, l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas encore fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État, la partie qui soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation préalable est donc parfaitement dans son droit. Elle l’est toujours au moment de la formation du pourvoi par son adversaire le 9 août 2022. L’instance devant la Cour de cassation est cependant pendante au moment de l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile : la conséquence est inévitable, la modulation dans le temps des effets de l’annulation ne portant pas atteinte au principe de l’effet rétroactif pour les instances en cours, l’article 750-1 du code de procédure civile est réputé ne pas avoir existé au moment de la saisine du tribunal judiciaire.
« Nom de Zeus ! » s’est peut-être alors écrié le client de l’architecte. Et on le comprendra, tant cette annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile et la modulation dans le temps de ses effets s’apparente aux aventures de Marty McFly et du Dr Emmett Brown (v. déjà, sur cette analogie, M. Barba, Contrôle de légalité de la réforme de la procédure civile de 2019 : retour vers le futur au Conseil d’État [Deuxième partie : le champ d’annulation], Dalloz actualité, 4 oct. 2022, préc.). Il faut toutefois souligner que la modulation des effets dans le temps de l’annulation contentieuse a été décidée par le Conseil d’État « eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive […] de l’article 750-1 du code de procédure civile (CE, ch. réun., 22 sept. 2022, n° 436939, préc., § 69) et non eu égard à un impératif, par exemple, de sécurité juridique. C’est ce qui explique cette volonté de ne pas remettre en cause le principe de l’effet rétroactif de l’annulation aux instances en cours. Les conséquences de la rétroactivité seraient manifestement excessives pour le fonctionnement du service public de la justice si les décisions prises en application du décret du 11 décembre 2019 et devenues définitives devaient être reconsidérées. Les conséquences apparaissent cependant moins insurmontables pour les instances en cours, de sorte que le principe de rétroactivité de l’annulation doit s’appliquer à celles-ci. D’application complexe, les conséquences de cette modulation n’en demeurent pas moins justifiées.
Si l’arrêt rendu le 6 février 2025 par la Cour de cassation peut être considéré comme un dénouement en ce qu’il résout l’une des difficultés posées par les péripéties de l’article 750-1 du code de procédure civile, il n’est cependant pas certain qu’il puisse être qualifié d’épilogue, d’autres questions pouvant encore être soulevées dans le futur (sur « les questions toujours en suspens », v. not., G. Maugain, L’extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile, Dalloz actualité, 23 mai 2023, préc.).
par Solenne Hortala, Agrégée des facultés de droit, Professeure à l'UPPA, IFTJ
Civ. 2e, 6 févr. 2025, F-B, n° 22-20.070
© Lefebvre Dalloz