Baux commerciaux et crise sanitaire : une interprÃĐtation dÃĐvoyÃĐe de la protection offerte par lâordonnance du 25 mars 2020
Lâinterdiction des sanctions pour dÃĐfaut de paiement des ÂŦ loyers et charges Âŧ dont lâÃĐchÃĐance de paiement intervient pendant la pÃĐriode protÃĐgÃĐe, prÃĐvue à lâarticle 4 de lâordonnance du 25 mars 2020, ne sâapplique pas aux effets dâune clause rÃĐsolutoire acquise antÃĐrieurement à la pÃĐriode protÃĐgÃĐe, dont la suspension ÃĐtait conditionnÃĐe au respect dâun ÃĐchÃĐancier fixÃĐ par le juge.
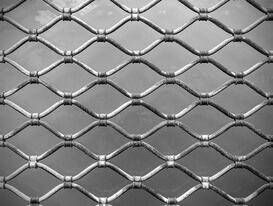
Interpréter, c’est choisir. L’interprétation n’est pas qu’un acte de connaissance, une découverte des divers sens qu’un texte peut revêtir. C’est également un acte de volonté, un choix entre ces possibilités.
Dans l’arrêt sous étude du 15 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a clairement pris une nouvelle fois le parti des bailleurs contre celui des preneurs, dans ce qui apparaît comme un épisode inédit de la saga « Baux commerciaux et crise sanitaire » (sur cette saga, v. not., M. Mekki, JCP N 2022, n° 36.1216).
Aux termes d’une décision sévère, plus politique que juridique, la Cour de cassation privilégie une interprétation contra legem des dispositions de faveur que l’ordonnance du 25 mars 2020 avait instituées, vidant en partie de son contenu la protection exceptionnelle offerte aux commerçants défaillants au cours de la période protégée.
Dans les faits, une cessionnaire de fonds de commerce preneuse à bail commercial avait connu, avant la crise sanitaire, des difficultés pour honorer le paiement des loyers. La bailleresse l’avait alors assignée en référé. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2019, la locataire avait été autorisée judiciairement à s’acquitter d’un arriéré locatif en vingt-quatre mensualités à compter du 15 du mois suivant sa signification réalisée le 9 janvier 2020.
L’ordonnance avait aussi suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail et prévu qu’à défaut de paiement à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, d’une seule des mensualités, cette clause serait acquise huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure, l’expulsion de l’occupante pouvant alors être poursuivie. Cet aménagement était fondé sur les pouvoirs reconnus au juge par les articles L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil (devenus art. 1345-5 à la faveur de l’ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016).
La suite est malheureusement connue. La crise sanitaire s’étant déclenchée en début d’année 2020, une série de mesures gouvernementales fut prise pour interdire l’accès au public de certains établissements afin de lutter contre la propagation du virus covid-19. La locataire a été contrainte de cesser son activité à compter du 14 mars 2020 et n’a pas été en mesure de s’acquitter des échéances des mois d’avril et mai 2020.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2020, la bailleresse a mis la locataire en demeure de payer trois mensualités de l’échéancier fixé et deux termes de loyer échus pendant la période de protection, puis a notifié le 29 octobre 2020 un commandement de quitter les lieux. La locataire a contesté la validité de ce commandement en se prévalant des articles 1er et 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020. Selon ces dispositions, combinées aux articles 1er et 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et 1er de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, « les personnes physiques et morales de droit privé qui, exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour la limiter, sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, ne peuvent encourir d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire », soit le 10 septembre 2020 (§ 6).
En clair, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait une période dite « protégée », comprise entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, au cours de laquelle le manquement des preneurs à bail commercial au paiement des loyers ou charges locatives ne pouvait donner lieu à la mise en œuvre d’une clause résolutoire.
Malgré la protection exceptionnelle instaurée par ce texte, la Cour d’appel de Paris rejeta, le 28 octobre 2021, la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, confirmant ainsi la prise d’effet de la clause résolutoire.
La succombante forma un pourvoi en cassation et tenta, dans chacune des branches du moyen, de convaincre la Cour de cassation que la protection offerte par l’ordonnance du 25 mars 2020 lui était bien applicable.
Elle précisa notamment que pour être éligible à ce dispositif, il n’est nullement nécessaire d’avoir effectivement bénéficié du fonds de solidarité (3e branche), lequel d’ailleurs n’est pas subordonné à une interdiction générale et absolue de recevoir du public (4e branche). Surtout, elle rappela que les conditions temporelles posées par le texte sont bel et bien remplies ici, puisque le défaut de paiement était intervenu au cours de la période protégée, donc entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 (1re branche). Peu importe, d’après la demanderesse au pourvoi, qu’il s’agisse en l’espèce de chefs de dispositif d’une décision de justice exécutoire condamnant au paiement d’une dette locative née antérieurement à la période protégée (2e branche).
La Cour de cassation ne se laissa pas convaincre et rejeta le pourvoi dans l’arrêt rapporté.
La lecture des motifs révèle que le désaccord avec la demanderesse au pourvoi porte surtout sur la deuxième branche du moyen. Après avoir rappelé la teneur des dispositions instaurant une période protégée (§ 6), la troisième chambre civile procède à une interprétation des articles L. 145-41 du code de commerce et des articles 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil (§ 7) en ces termes : « Faute de libération dans les conditions fixées par le juge, l’effet résolutoire de la clause est réputé avoir joué au jour où le bénéfice de cette clause a été acquis au bailleur, soit un mois après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux » (§ 8).
Cet effet rétroactif suffit, selon la Cour de cassation, à justifier une interprétation restrictive de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle en déduit en effet que « l’interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges dont l’échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ne s’applique pas aux effets d’une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d’un échéancier fixé par le juge » (§ 9).
Nul salut, donc, pour la preneuse à bail, sommée de quitter les lieux pour n’avoir pu, en temps de crise sanitaire, régler sa dette locative rééchelonnée. Déguisée en un raisonnement juridique habile, la solution est en réalité pleinement politique. La Cour aurait tout à fait pu privilégier une approche juridique plus favorable à la locataire. Pire, une analyse rapide de l’arrêt révèle que l’interprétation ici retenue est contraire tant à la lettre du texte qu’à son esprit.
Une interprétation contraire à la lettre du texte
En premier lieu, l’interprétation de la Cour est contraire à la lettre de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, qui, combiné à son article 1er, n’énonce que trois conditions cumulatives pour qu’un preneur puisse bénéficier de la protection :
- être éligible au fonds de solidarité ;
- être en défaut de paiement d’une échéance de loyer intervenue entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 concernant un bail professionnel ;
- et être menacé, de ce fait, par une clause résolutoire, une clause pénale ou toute autre clause de déchéance.
Le syllogisme le plus élémentaire conduit à une solution radicalement différente de celle retenue ici par la Cour de cassation. Les trois conditions cumulatives étaient en effet toutes réunies : la preneuse était éligible au fonds de solidarité, se trouvait en défaut de paiement sur des échéances intervenues entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 et était, en conséquence, menacée par une clause résolutoire. Pour retenir une solution différente, la Cour de cassation ajoute une condition non prévue par le texte : que la clause résolutoire n’ait pas été acquise puis suspendue avant le 12 mars 2020. Ou plus exactement, que le défaut de paiement concerne un loyer antérieur au 12 mars 2020 et non, contrairement à la lettre du texte, une échéance antérieure à cette date.
Il se trouve aussi que le texte à interpréter vise toutes les clauses résolutoires n’ayant pas pris effet. Il n’exclut absolument pas les clauses qui ont été judiciairement suspendues. Peu devrait donc importer que la clause résolutoire ait été acquise puisqu’elle a été suspendue judiciairement. Son effet (terme employé par le texte) a d’abord été paralysé par la suspension judiciaire, puis déclenché par un défaut de paiement survenu pendant la période protégée. En réalité, en fondant tout son raisonnement sur la rétroactivité de la levée de la suspension, la Cour de cassation confond le fait générateur déclenchant la prise d’effet de la clause résolutoire (intervenu pendant la période protégée) et la date de la résiliation (antérieure à la période protégée). Or, ce qui devrait surtout compter, c’est que le défaut de paiement soit intervenu pendant la période protégée, peu important la date à laquelle la résolution prend effet. Le texte n’exige nullement qu’une résolution intervienne au cours de la période protégée : il exige uniquement que le défaut de paiement se produise en cette période.
Une interprétation contraire à l’esprit du texte
En second lieu, l’interprétation de la Cour est contraire à l’esprit de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, animé par une logique de protection de tous les preneurs à bail commercial contre les effets de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales imposant la fermeture des établissements commerciaux. En creux, la Cour de cassation valide ici un raisonnement consistant à sanctionner un preneur déjà défaillant avant la crise. La solution est sévère, car même si la crise n’était pas la cause des défauts de paiements survenus en fin d’année 2019, elle était la cause de ceux intervenus de 2020. En d’autres termes, le nouveau calendrier de paiement fixé par le juge des référés aurait peut-être été respecté s’il n’y avait pas eu de crise sanitaire. Comment nier que c’est la fermeture de l’établissement qui a rendu la locataire inapte à régler sa dette rééchelonnée ?
L’esprit du texte est donc ici dévoyé. La Cour le réduit à une fonction de protection des commerçants n’ayant connu de difficultés que pendant la crise sanitaire. Or, le but du texte est de protéger tous les professionnels contre les effets de la crise sanitaire, non de ne protéger que ceux d’entre eux qui ne se trouvent en difficulté qu’en raison de la crise sanitaire. La Cour réalise ainsi une distinction non conforme à l’esprit du texte entre les commerçants les plus solides (pleinement protégés) et les plus fragiles (nullement protégés). Une telle partition est d’ailleurs en contradiction directe avec l’alinéa 1er, in fine, de l’article 4 de l’ordonnance, selon lequel la protection s’applique « nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce », donc même en cas de procédure collective.
On le voit, la Cour aurait pu privilégier une interprétation juridique du texte protectrice des preneurs les plus fragiles. L’interprétation est un choix, la Cour a fait le sien.
© Lefebvre Dalloz