Cession de marque : portée de l’absence d’inscription au registre des marques
Dans un arrêt rendu le 26 juin 2024, la chambre commerciale précise que l’absence d’inscription au registre des marques n’entraîne pas la nullité de la cession de la marque mais l’inopposabilité de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant celle-ci.
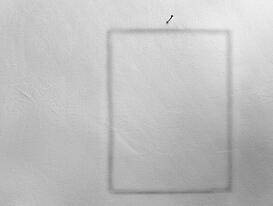
L’arrêt rendu le 26 juin 2024 dispose de toutes les qualités pour intéresser les praticiens du droit civil et du droit des affaires. Situé au carrefour du droit des sûretés, du droit commercial et de celui de la propriété intellectuelle, il vient régler une question nécessitant de s’éloigner de la lettre d’un texte pour en revenir à son esprit. À la fois destiné aux sélectives Lettres de chambre et au Bulletin, cet arrêt met fin à un débat complexe d’interprétation de l’article L. 143-17 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés.
Avant le 1er janvier 2023, on pouvait en effet se questionner sur la nature de la sanction applicable à un défaut d’inscription au registre des marques de l’INPI dans les délais requis lors d’une cession de fonds de commerce qui comportait une cession de marque. L’article L. 143-17 du code de commerce évoquait explicitement un cas de nullité de la cession mais une partie de la doctrine avait milité pour y voir une simple inopposabilité de la sûreté accompagnant l’opération. L’ordonnance de 2021 a, heureusement, gommé la sémantique posant difficulté pour prévoir une simple inopposabilité dans cette perspective. Mais la clarification concernant le droit ancien reste assurément heureuse eu égard aux stocks de dossiers concernés.
Les faits ayant donné lieu au pourvoi puisent leur source dans un maillage historique qui remonte au XXe siècle. Une personne physique fonde en 1957 une société que nous appellerons « U. E. » spécialisée dans la conception et la fabrication ainsi que la vente de boîtes de vitesse entre autres organes de transmission. Le 28 mars 1988, plusieurs marques verbale et semi-figurative sont enregistrées pour désigner différents produits (sous les nos 1458311 et 1458312, pt n° 1 de l’arrêt). Voici que le 12 mai 2014, la société se retrouve en liquidation judiciaire. Les actifs sont cédés quelques semaines plus tard à une société « I » durant le plan de cession.
En janvier 2015, une société « E » décide d’acquérir les actifs déjà cédés une première fois. Les différentes cessions sont inscrites au registre des marques le 17 décembre 2015 et le 14 janvier 2016. Remarquons ces dates car elles seront importantes pour la suite.
Le 20 janvier 2016, une société « M. » laquelle est la création du fils du fondateur de la société initiale « U. E. », dépose une marque verbale n° 4242041 concernant la classe 7 de la classification internationale (machine-outils, moteurs not.), même classification que celle des marques enregistrées par son père en 1988.
Le 8 septembre 2016, la société « E » – qui avait donc acquis les actifs en 2015 – a assigné le fils du fondateur de la société « U. E. » ainsi que la société fondée par ce dernier (la société « M. ») afin d’obtenir l’annulation de la marque déposée sous le n° 4242041. Quant au fils du fondateur et à la société « M. », ils sollicitent l’annulation de la cession des marques nos 1458311 et 1458312. Ces derniers estimaient que la cession aurait dû être enregistrée à l’INPI dans les délais de l’article L. 143-17 du code de commerce, ce qui n’avait pas été fait. Une seconde difficulté reposait également sur un élément difficilement décelable dans les faits narrés par la chambre commerciale. La société « E » utilisait comme dénomination sociale le nom patronymique du fondateur initial de la société « U. E. ». Aussi intéressant soit ce problème, ce n’est pas celui qui nous occupera aujourd’hui.
En cause d’appel, la cession des deux marques nos 1458311 et 1458312 est déclarée valable. Les juges du fond avaient, en effet, considéré que l’absence d’inscription dans le délai prévu n’emportait pas la nullité de la cession de la marque mais seulement l’inopposabilité de la sûreté garantissant la cession du fonds de commerce. Le pourvoi en cassation reproche précisément ce raisonnement à la cour d’appel. C’est ce point qui, sans aucun doute, explique le haut niveau de publication de la décision étudiée.
Nous allons examiner pourquoi l’arrêt du 26 juin 2024 aboutit à un rejet du moyen développé par les demandeurs à la cassation concernant l’interprétation de l’article L. 143-17 du code de commerce.
À titre préliminaire, notons que la décision intéresse également le droit de la responsabilité civile à travers la divulgation d’information et le dénigrement en continuant une lignée jurisprudence déjà connue sur le préjudice qui en résulte automatiquement (nos 23 à 25 et nos 27 à 29 de l’arrêt).
Un duel entre la lettre et l’esprit
Toute la difficulté de l’arrêt que nous étudions aujourd’hui repose sur une formulation malheureuse de l’article L. 143-17 du code de commerce avant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Ce texte prévoyait avant le 1er janvier 2023 que « les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels » (nous soulignons).
La lecture de la disposition légale semble ne pas emporter de difficulté puisqu’il est fait mention expressément de la nullité de la cession. C’est la raison pour laquelle le pourvoi en cassation avait de très sérieuses chances d’être couronné de succès au premier regard. Mais c’était sans compter sur l’interprétation de ce texte par la doctrine. Un certain nombre d’auteurs avaient avancé l’idée selon laquelle la nullité décrite par le texte n’était qu’un trompe-l’œil. Ainsi, plusieurs spécialistes ont pu évoquer que la rédaction de l’article L. 143-17 était « assez fâcheuse » et qu’il fallait lire entre les lignes une inopposabilité, notamment du privilège du vendeur en cas de cession du fonds de commerce incluant une marque quand les délais légaux n’étaient pas respectés pour l’enregistrement à l’INPI (Rép. com., v° Fonds de commerce, par J. Derruppé et T. de Ravel d’Esclapon, n° 955).
C’est pour cette raison que la décision explique qu’en raison de la « finalité d’information des tiers » du texte (pt n° 9), la doctrine et les juges du fond ont pu considérer que la sanction n’était donc pas la nullité de la cession mais l’inopposabilité de la sûreté et plus précisément du privilège du vendeur (v. égal., C. Denizot et A. Reygrobellet [dir.], Fonds de commerce, 2011, Dalloz Action, n° 74.55, spéc. p. 956). On remarquera également le rappel de l’arborescence de l’article L. 143-17 dans le code de commerce pour asseoir cette idée même s’il faut parfois se méfier des arguments dits a rubrica (pt n° 8 de la décision ; v. à ce titre réc., Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 22-20.533 FS-B, Dalloz actualité, 25 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1229 ![]() ).
).
Il peut toutefois paraître assez déroutant, si ce n’est surprenant, que l’arrêt du 26 juin 2024 commence par rappeler des arguments tirés de la finalité du texte, voire de la volonté du législateur (nos 8 et 9). Les textes clairs ne doivent normalement pas faire l’objet d’une quelconque interprétation en ce sens (interpretatio cessat in claris ; sur les règles d’interprétation, P. Malinvaud et N. Balat, Introduction à l’étude du droit, 22e éd., LexisNexis, coll. « Manuel », 2022, p. 131, n° 135 ; F. Terré et N. Molfessis, Introduction générale au droit, 15e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 865, n° 623). C’est la raison pour laquelle on peut lire au point n° 10 de la décision étudiée la remarquable affirmation suivante : « Si toute recherche de la volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge lorsque le sens de la loi, tel qu’il résulte de sa rédaction, n’est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a cependant exception si l’application du texte aboutit à quelque absurdité » (nous soulignons). L’aspect le plus intéressant de cet énoncé réside dans sa rareté car très peu de décisions de la Cour de cassation explorent cet aspect méthodologique transcendant tant le droit des sûretés que celui de la propriété intellectuelle. Il faut dire que la chambre commerciale n’avait finalement que peu de choix car, à notre connaissance au moins, aucun arrêt publié au Bulletin ces dernières années n’avait statué sur le choix de l’interprétation de l’article L. 143-17 ancien du code de commerce.
Pour aboutir à tordre la lettre du texte en passant d’une nullité de la cession à une inopposabilité de la sûreté, il convenait donc en d’autres termes d’expliquer le caractère intenable en pratique de l’argumentation littérale. C’est ce que nous allons maintenant examiner.
Éviter l’absurdité du texte légal
La chambre commerciale utilise, dans son arrêt du 26 juin 2024, quatre arguments d’inégale intensité pour justifier sa position, à savoir que l’ancien article L. 143-17 du code de commerce doit être interprété dans le sens d’une inopposabilité de la sûreté et non dans celui d’une nullité de la cession de la marque. Nous les classerons par ordre d’importance pour solidifier le sens de l’orientation retenue.
1. L’énoncé légal comporte une maladresse dans sa formulation antérieurement au 1er janvier 2023. Il était, en effet, prévu une « nullité à l’égard des tiers ». La chambre commerciale retient donc qu’en raison de la définition de la nullité, à savoir l’anéantissement rétroactif de l’acte juridique, le texte ne peut qu’être obscur car on ne comprendrait qu’assez mal que l’opération soit nulle pour les tiers mais valable entre les parties (pt n° 12 de l’arrêt). Une telle ambiguïté milite très clairement pour la confusion d’une nullité avec une inopposabilité puisque la rétroactivité de la première « développe en principe ses effets non seulement dans les rapports entre les parties à l’acte nul, mais aussi à l’égard des tiers qui ont traité avec les parties et dont les droits sont dépendants de cet acte » (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », p. 677, n° 584).
2. L’arrêt du 26 juin 2024 rappelle que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne vient pas annuler les transmissions ou les modifications des droits qui portent sur des marques mais implique seulement de rendre inopposables de telles opérations quand elles ne sont pas publiées (pt n° 13 de la décision étudiée). Ce point est assurément important car l’article L. 143-17 du code de commerce ancien ne pouvait donc pas aisément prévoir une nullité dans le contexte du fonds de commerce quand celui-ci est vendu ou quand celui-ci est nanti. Du moins, il y aurait eu un caractère assez étonnant à admettre le contraire. La chambre commerciale voit dans cette branche de l’option une certaine absurdité.
3. L’article L. 143-17 ne peut qu’exiger l’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce à l’INPI selon la décision étudiée. En tout état de cause, celle-ci rappelle que l’acquéreur du fonds ne peut pas, en pratique, s’occuper de l’inscription d’une vente ou d’une cession dans la mesure où l’article R. 143-6 applicable aux faits de l’espèce invite le vendeur ou le créancier nanti à avoir seule qualité pour solliciter ladite inscription. Mais cet argument peut paraître fragile car il transpose déjà une partie de la solution au raisonnement suivi pour y aboutir.
4. La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a mis fin au débat en prévoyant la substitution du mot « nullité » par l’expression « inopposabilité ». L’arrêt du 26 juin 2024 utilise cet argument comme pierre finale de sa démonstration (pt n° 14). Il pourrait s’agir, toutefois, d’un changement de direction du droit nouveau rendant ainsi inopérant cette idée comme directive d’interprétation de l’ancien article L. 143-17 du code de commerce. Le Rapport remis au président de la République ne permet pas d’en savoir davantage car ce document est assez laconique à ce titre (v. ss. l’art. 27 du rapp.).
La combinaison de ces quatre arguments suffit, d’une manière pertinente, à juger que l’absence d’inscription à l’INPI de la cession de marque dans le délai prévu par le texte ne peut qu’entraîner l’inopposabilité de la sûreté (en cas de cession, du privilège du vendeur) et non la nullité de la cession de la marque (pt n° 15), ce qui explique le caractère non fondé du moyen développé par les demandeurs à la cassation.
Cette torsion du texte, pour remplacer la nullité par une inopposabilité, est remarquable à deux titres au moins :
- d’une part, la chambre commerciale utilise son pouvoir interprétatif pour restaurer le sens précis de l’énoncé légal qui, évoquant une nullité à l’égard des tiers, ne pouvait finalement que prévoir une inopposabilité de la sûreté, objet même de l’article L. 143-17 (de l’art finalement de restaurer implicitement les vertus de l’argument a rubrica, pt n° 8) ;
- d’autre part, l’arrêt parvient à un certain équilibre entre les différentes matières qui, chacune prise dans son individualité, parviennent au même constat. Seule l’inopposabilité pouvait, en pratique, se justifier tant en droit des sûretés qu’en droit de la propriété intellectuelle. Pour le fonds de commerce lui-même, la décision est d’autant plus heureuse eu égard à l’importance de la marque dans la cession de ce dernier.
Étant donné que le droit ancien des sûretés continue d’alimenter un contentieux assez âpre, l’arrêt du 26 juin 2024 fait figure de phare dans l’obscurité. Une telle précision dans le droit antérieur au 1er janvier 2023, date d’entrée en vigueur du nouvel article L. 143-17 du code de commerce modifié prévoyant explicitement une inopposabilité, viendra en effet très grandement éclairer la pratique.
Voici donc un bien bel arrêt au croisement de plusieurs matières fondamentales : introduction au droit et directives d’interprétation, droit commercial, droit des sûretés et droit de la propriété intellectuelle. Il s’agit assurément d’une décision qui marque la fin d’un débat complexe où la lettre et l’esprit étaient en profonde opposition.
Com. 26 juin 2024, FS-B, n° 23-11.020
© Lefebvre Dalloz