Chronique CEDH : confirmation et consolidation des critères de protection des lanceurs d'alerte
Comme il se doit dans chaque chronique d'actualité des mois de janvier-février, il faudra commencer par faire écho au discours annuel du Président de la Cour européenne des droits de l'homme qui, pour la première fois, est une Présidente. Sur le plan strictement jurisprudentiel, la Cour de Strasbourg, au cours des deux premiers mois de 2023, se sera surtout signalée à l'attention en refusant la mention du sexe neutre sur l'acte de naissance ; en élargissant la protection des lanceurs d'alerte et celle des victimes secondaires ; en stigmatisant l'absence de toute reconnaissance juridique des couples homosexuels ou l'avertissement du caractère dangereux pour les enfants d'un livre de contes mettant en scène des personnages LGBTI ; en conciliant le respect effectif de la Convention avec les exigences de la lutte contre le terrorisme. Elle se sera aussi intéressée à des questions qui retiennent plus rarement son attention comme les particules nobiliaires ou les variantes d'une langue nationale …
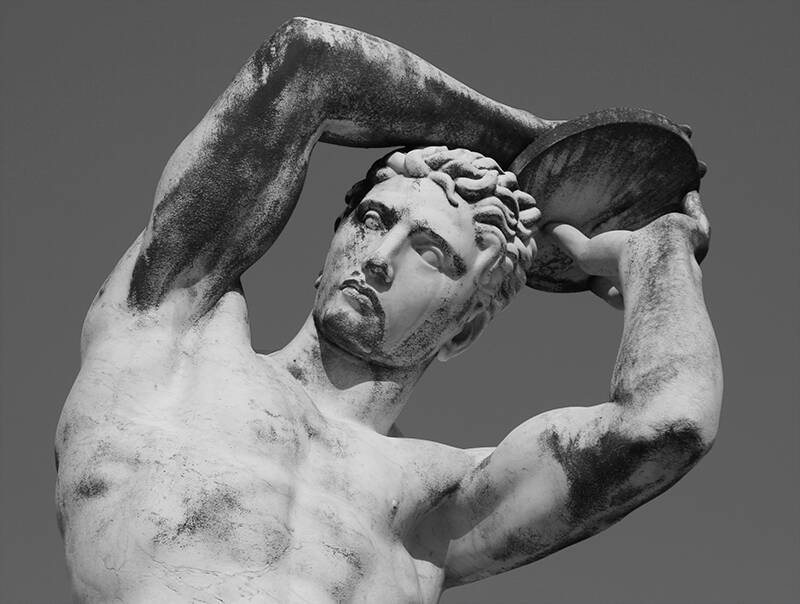
Discours annuel de la Présidente de la Cour européenne des droits de l’homme
C’est à Mme Siofra O’Leary, juge irlandaise devenue la première femme élue le 19 septembre 2022 à la Présidence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’est revenu l’honneur de se soumettre à une conférence de presse et de prononcer le 26 janvier 2023 le discours marquant le début d’une nouvelle année d’activité qui donne l’occasion de tirer un bref bilan de celle qui vient de s’achever. Elle y a bien entendu souligné la gravité des événements qui ont conduit à l’exclusion de la Russie du Conseil de l’Europe et à sa sortie de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle y a aussi délivré d’intéressantes données statistiques révélant que, en 2021 le nombre des requêtes pendantes est passé de 70 150 à 74 650 et que le nombre des requêtes ayant donné lieu à un arrêt est de 4 168. Il est important de remarquer que sur ces 4 168 arrêts, 3 554 ont été rendus par un comité de trois juges et ne laissent pratiquement aucune trace dans les communiqués du greffe qui alimentent cette chronique pour laquelle l’image galvaudée de la partie émergée de l’iceberg convient donc parfaitement. Mme la Présidente O’Leary a également attiré l’attention sur le succès grandissant d’une procédure dont cette chronique bimensuelle échoue à faire ressortir l’importance. Il s’agit de la stratégie dite « impact » mise en place en 2021 pour permettre à la Cour de Strasbourg de compter de plus en plus en se prononçant plus rapidement sur des affaires prioritaires et souvent sensibles qui ne portent pas pour autant sur le noyau dur des droits de l’homme. La liberté d’expression des juges, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail ou l’euthanasie étaient les principaux sujets des 429 affaires « impact » identifiées en 2021 pour bénéficier d’un traitement ciblé et plus rapide.
Ajournement de l’inscription de la mention « sexe neutre » sur l’acte de naissance
Les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles ne correspondant pas à la définition classique du sexe féminin ou du sexe masculin ne sont pas très nombreuses, mais la souffrance qu’elles éprouvent parce qu’il leur a été assigné sur l’acte de naissance un des deux sexes impuissant à refléter leur identité n’est plus étouffée sous le poids des préjugés. La question de savoir si, pour répondre à leurs attentes, il convient de supprimer pour tout le monde l’indication du sexe sur les actes d’état civil ou d’admettre pour le leur la mention sexe neutre ou intersexe, est en effet devenue une question de société. En France, le jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal de grande instance de Tours a largement contribué à la faire émerger. On sait que son audace consistant à ordonner que dans l’acte de naissance du demandeur soit substituée à la mention « sexe masculin » la mention « sexe neutre » par préférence à ma mention « intersexe », avait été refrénée par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 2 mars 2016 approuvée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017. L’audace tourangelle n’a pas été retrempée par la Cour européenne des droits de l’homme puisque, par son arrêt Y. c/ France du 31 janvier 2023 (n° 76888/17, Dalloz actualité, 9 févr. 2023, obs. M. Brillat ; D. 2023. 239, et les obs. ![]() ; ibid. 400, point de vue B. Moron-Puech
; ibid. 400, point de vue B. Moron-Puech ![]() ; AJ fam. 2023. 70, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; AJ fam. 2023. 70, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ). Elle est, en effet, parvenue à la conclusion suivant laquelle la France n’avait pas manqué à son obligation positive de garantir au requérant intersexué le respect de sa vie privée en refusant de modifier son acte de naissance dans le sens indiqué à Tours. Le refus de dresser un constat de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne vaut pas, cependant, approbation générale des arguments retenus par la cour d’appel d’Orléans et par la Cour de cassation. C’est ainsi qu’elle leur reproche vertement d’avoir confondu la notion d’identité et la notion d’apparence en retenant contre le demandeur qu’il avait adopté le comportement social d’une personne de sexe masculin. Elle se range, en revanche aux « motifs tirés du respect du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la nécessité de préserver la cohérence et la sécurité des actes de l’état civil ainsi que l’organisation sociale et juridique du système français, avancés par les autorités nationales ». Au nom de la marge d’appréciation qui doit être élargie en l’absence de consensus européen et lorsque sont en jeu des questions de politique générale relevant d’un choix de société, elle admet prudemment qu’il convient d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Contrairement à ce que les contempteurs attitrés de la Cour européenne des droits de l’homme auraient peut-être attendus, elle laisse les États membres du Conseil de l’Europe et, en l’occurrence la France, entièrement libre de s’effrayer des conséquences pratiques et anthropologiques de l’effondrement d’un système fondé sur la binarité du sexe.
). Elle est, en effet, parvenue à la conclusion suivant laquelle la France n’avait pas manqué à son obligation positive de garantir au requérant intersexué le respect de sa vie privée en refusant de modifier son acte de naissance dans le sens indiqué à Tours. Le refus de dresser un constat de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne vaut pas, cependant, approbation générale des arguments retenus par la cour d’appel d’Orléans et par la Cour de cassation. C’est ainsi qu’elle leur reproche vertement d’avoir confondu la notion d’identité et la notion d’apparence en retenant contre le demandeur qu’il avait adopté le comportement social d’une personne de sexe masculin. Elle se range, en revanche aux « motifs tirés du respect du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la nécessité de préserver la cohérence et la sécurité des actes de l’état civil ainsi que l’organisation sociale et juridique du système français, avancés par les autorités nationales ». Au nom de la marge d’appréciation qui doit être élargie en l’absence de consensus européen et lorsque sont en jeu des questions de politique générale relevant d’un choix de société, elle admet prudemment qu’il convient d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Contrairement à ce que les contempteurs attitrés de la Cour européenne des droits de l’homme auraient peut-être attendus, elle laisse les États membres du Conseil de l’Europe et, en l’occurrence la France, entièrement libre de s’effrayer des conséquences pratiques et anthropologiques de l’effondrement d’un système fondé sur la binarité du sexe.
Si le refus d’admettre l’indication de la mention « sexe neutre » voire « intersexe » sur l’acte de naissance est clair et net, il ne correspond peut-être, cependant, qu’à un ajournement. L’arrêt Y. c/ France se termine en effet par le rappel du principe qu’avait ciselé l’arrêt Rees c/ Royaume-Uni du 17 octobre 1986 relatif à ce que l’on appelait alors le transsexualisme : « la Convention est un instrument vivant, qui doit toujours s’interpréter et s’appliquer à la lumière des conditions actuelles, et [ ] la nécessité de mesures juridiques appropriées doit donc donner lieu à un examen constant eu égard, notamment, à l’évolution de la société et de l’état des consciences ». On se souvient des conséquences de l’examen constant, notamment par le célèbre arrêt B. c/ France du 25 mars 1992, des requêtes des personnes qui souhaitent non pas une neutralisation mais un changement du sexe indiqué sur leur acte de naissance….
Confirmation et consolidation des critères de protection des lanceurs d’alerte
La Cour de Strasbourg qui s’est toujours refusée à faire entrer les lanceurs d’alerte sous une définition, s’est néanmoins attachée à organiser une protection renforcée de leur droit à la liberté à la liberté d’expression pour leur permettre de divulguer, nonobstant leur obligation de loyauté, de réserve et de discrétion, des informations confidentielles recueillies sur leur lieu de travail qui leur ont paru relever de l’intérêt général. Elle y est parvenue en établissant, à partir de son célèbre arrêt de grande chambre Guja c/ Moldavie du 12 février 2008 (n° 14277/04, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ![]() ) un liste de six critères à savoir : les moyens utilisés pour la divulgation, l’authenticité de l’information divulguée, la bonne foi, l’intérêt public que présente l’information divulguée, le préjudice causé et la sévérité de la sanction. Par un arrêt du 11 mai 2021, une chambre avait appliqué les « critères Guja » dans une affaire Halet c/ Luxembourg (n° 21884/18, Dalloz actualité, 20 mai 2021, obs. S. Lavric ; D. 2021. 1901, et les obs.
) un liste de six critères à savoir : les moyens utilisés pour la divulgation, l’authenticité de l’information divulguée, la bonne foi, l’intérêt public que présente l’information divulguée, le préjudice causé et la sévérité de la sanction. Par un arrêt du 11 mai 2021, une chambre avait appliqué les « critères Guja » dans une affaire Halet c/ Luxembourg (n° 21884/18, Dalloz actualité, 20 mai 2021, obs. S. Lavric ; D. 2021. 1901, et les obs. ![]() , note M. Lassalle
, note M. Lassalle ![]() ; AJ pénal 2021. 368, obs. E. Daoud
; AJ pénal 2021. 368, obs. E. Daoud ![]() ). Ils lui avaient permis de conclure que la condamnation à une amende de 1 000 € d’un salarié qui avait livré à une journaliste d’investigation française des documents confidentiels révélant des accords très avantageux conclus entre l’administration fiscale luxembourgeoise et de puissantes sociétés multinationales, n’avait pas entraîné d’ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. La chambre avaient notamment privilégié l’importance du préjudice subi par l’employeur par rapport au bénéfice procuré par cette divulgation qui n’aurait d’ailleurs pas présenté un grand intérêt pour le public. L’affaire devenue « affaire Luxleaks » ayant été renvoyée en grande chambre, la Cour a profité de l’occasion « pour confirmer et consolider les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de protection des lanceurs d’alerte, en en affinant les critères de mise en œuvre, à la lumière du contexte européen et international actuel » où se remarque l’importance grandissante de la place et du rôle des lanceurs d’alerte. Ce travail de révision opéré par l’arrêt Halet c/ Luxembourg du 14 février 2023 ne s’est pas manifesté par des adjonctions ou des suppressions des « critères Guja » mais par des précisions ou de forts rappels qui les concernent presque tous à l’exemple du premier qui désormais permettra plus clairement aux lanceurs d’alerte d’alerter directement les médias lorsque le comportement de l’employeur n’est pas illégal mais simplement répréhensible. Le plus important est que, petite touche par petite touche, la Grande chambre en soit arrivée à un recadrage de la mise en balance des intérêts en présence qui conduit à relativiser le préjudice que la divulgation des informations confidentielles a infligé à l’employeur. C’est ainsi que déjugeant la chambre, la grande chambre a pu dresser un constat de violation de l’article 10 reflétant mieux l’importance, à l’échelle nationale aussi bien qu’européenne, du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales.
). Ils lui avaient permis de conclure que la condamnation à une amende de 1 000 € d’un salarié qui avait livré à une journaliste d’investigation française des documents confidentiels révélant des accords très avantageux conclus entre l’administration fiscale luxembourgeoise et de puissantes sociétés multinationales, n’avait pas entraîné d’ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. La chambre avaient notamment privilégié l’importance du préjudice subi par l’employeur par rapport au bénéfice procuré par cette divulgation qui n’aurait d’ailleurs pas présenté un grand intérêt pour le public. L’affaire devenue « affaire Luxleaks » ayant été renvoyée en grande chambre, la Cour a profité de l’occasion « pour confirmer et consolider les principes qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de protection des lanceurs d’alerte, en en affinant les critères de mise en œuvre, à la lumière du contexte européen et international actuel » où se remarque l’importance grandissante de la place et du rôle des lanceurs d’alerte. Ce travail de révision opéré par l’arrêt Halet c/ Luxembourg du 14 février 2023 ne s’est pas manifesté par des adjonctions ou des suppressions des « critères Guja » mais par des précisions ou de forts rappels qui les concernent presque tous à l’exemple du premier qui désormais permettra plus clairement aux lanceurs d’alerte d’alerter directement les médias lorsque le comportement de l’employeur n’est pas illégal mais simplement répréhensible. Le plus important est que, petite touche par petite touche, la Grande chambre en soit arrivée à un recadrage de la mise en balance des intérêts en présence qui conduit à relativiser le préjudice que la divulgation des informations confidentielles a infligé à l’employeur. C’est ainsi que déjugeant la chambre, la grande chambre a pu dresser un constat de violation de l’article 10 reflétant mieux l’importance, à l’échelle nationale aussi bien qu’européenne, du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales.
Renforcement de la protection des mineurs sexuellement agressés contre la victimisation secondaire
On attribue généralement au psychiatre Martin Symonds l’émergence du concept de victimisation secondaire qui désigne les conséquences négatives découlant du traitement de la victime par les autorités. Comme souvent, la prise en compte juridique d’un concept criminologique aux contours encore un peu flottants ne va pas sans difficultés auxquelles la Cour européenne des droits de l’homme est de plus en plus souvent confrontée. Son arrêt B. c/ Russie du 7 février (n° 36328/20, Dalloz actualité, 23 févr. 2023, obs. A. Lefebvre) vient de lui permettre de préciser sa manière de l’approcher dans une affaire où une jeune fille victime d’abus sexuels se plaignait d’un traumatisme supplémentaire provoqué par les contacts directs avec les auteurs des abus allégués qui lui avaient été imposés pour les besoins de l’enquête. La Cour commence par préciser qu’il s’agit bien là d’une question de victimisation secondaire distincte de celle de l ’effectivité de l’enquête qu’il lui arrive de regarder, on le sait, sous les volets procéduraux des articles 2, 3 ou 8. C’est dire que le manque d’appétence des autorités pour faire progresser les investigations ou pour informer l’intéressé de leur état d’avancement qui témoignent d’une passivité exaspérante et qui semblent relever du concept criminologique de victimisation secondaire est déjà prise en compte par d’autres techniques conventionnelles. Il ne reste donc que les éléments traduisant, comme en l’espèce, une activité indifférente aux sentiments et aux appréhensions de la victime ou, comme souvent, tendant à retourner la responsabilité contre elle. La Cour affirme en avoir déjà stigmatisées quelques-unes par application de l’article 8 ou par combinaison des articles 8 et 3. L’originalité de l’arrêt B. c/ Russie du 7 février 2023 vient de ce que, eu égard à la vulnérabilité aiguë de la requérante et au caractère particulièrement grave de la victimisation secondaire alléguée, que l’on pourrait qualifier de victimisation secondaire active, il a examiné la question au regard du seul article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants dont il a d’ailleurs dressé un constat de violation unanime.
5 - Stigmatisation de l’absence de toute reconnaissance juridique des couples homosexuels
Les conséquences de la sortie de la Russie de la Convention européenne des droits de l’homme commence à se faire sentir comme en témoigne le refus dans une affaire V.K.K (n° 6719/23) examinée le 15 février d’indiquer des mesures provisoires relativement à des événements survenus après le 16 septembre 2022, date officielle de son départ du système de garantie collective des droits de l’homme. Néanmoins, il reste encore des affaires se rapportant à des faits antérieurs à cette date dont la Russie, d’après l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’homme doit encore répondre devant la Cour de Strasbourg. Ainsi, pendant quelques mois ou quelques années, servira-t-elle de miroir où se refléteront les atteintes aux valeurs cardinales du Conseil de l’Europe qu’elle vient de quitter. Cette fonction provisoire est parfaitement illustrée par l’arrêt de grande chambre Fedotova et autres du 17 janvier (n° 40792/10) qui constate une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de plusieurs requérants parce que la Russie s’obstine à refuser toute forme de reconnaissance et de protection juridiques aux couples homosexuels. Rappelant l’évolution de sa jurisprudence l’ayant conduite à juger que si les États n’étaient pas tenus d’aller jusqu’à admettre le mariage homosexuel, ils avaient l’obligation positive de mettre en place un cadre juridique spécifique en faveur des couples homosexuels ; relevant la tendance nette et continue des États membres du Conseil de l’Europe de faire avancer leur législation dans cette direction, la Cour considère que la marge d’appréciation de l’État défendeur était désormais réduite au point qu’il ne pouvait plus refuser la moindre forme de reconnaissance et de protection aux couples homosexuels sans violer l’article 8 de la Convention qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. Reprochant à la Russie de maintenir une législation incarnant un préjugé de la majorité hétérosexuelle à l’égard de la minorité homosexuelle, la Cour, dans ce qui pourrait passer pour un message d’adieu, lui assène solennellement quelques vérités bien senties à savoir que « permettre aux couples de même sexe de bénéficier d’une reconnaissance et d’une protection juridiques sert incontestablement [ses] idéaux et valeurs en ce que pareilles reconnaissance et protection confèrent une légitimité à ces couples et favorisent leur inclusion dans la société, sans égard à l’orientation sexuelle des personnes qui les composent » et que « la société démocratique au sens de la Convention rejette toute stigmatisation fondée sur l’orientation sexuelle parce qu’] elle a pour socle l’égale dignité des individus et [ ] se nourrit de la diversité qu’elle perçoit comme une richesse et non comme une menace ».
Stigmatisation d’un étiquetage présentant comme nuisible pour les enfants un livre de contes mettant en scène des personnages LGBTI
L’éditeur d’un livre de contes pour enfant avait dû se résoudre, au grand dam de l’auteur, à le mettre en vente avec l’apposition d’une étiquette avertissant qu’il était potentiellement nuisible pour des enfants de moins de quatorze ans. Deux des contes avaient en effet provoqué un vif émoi en présentant les relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles. Par un arrêt de grande chambre Macaté c/ Lituanie du 23 janvier (n° 62435/19), la Cour se disant fermement convaincue que les mesures qui restreignent l’accès des enfants aux contenus relatifs aux relations homosexuelles au seul motif de l’orientation sexuelle sont incompatibles avec les notions d’égalité, de pluralisme et de tolérance qui sont indissociables d’une société démocratique, a conclu que cet étiquetage présentant le contenu du livre comme nuisible pour les enfants ne répondait à aucun des motifs légitimes de restriction du droit à la liberté d’expression admis par le § 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et a jugé qu’il avait porté atteinte au droit à la liberté d’expression de l’auteur.
Conciliation contextualisée du respect effectif de la Convention avec les exigences de la lutte contre le terrorisme
L’assignation à résidence, pendant l’état d’urgence déclaré en 2015 après les terribles attentats de novembre, d’un converti à l’islam qui avait donné des signes inquiétants de radicalisation, aura permis à la Cour européenne des droits de l’homme d’apporter d’importantes précisions quant à la manière de concilier le respect effectif de la Convention pour lequel elle déploie des efforts soutenus depuis son célèbre arrêt Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979 et les exigences toujours plus impérieuses de la lutte contre le terrorisme. C’est au regard de l’article 2 du Protocole n° 4 consacrant la liberté de circulation, seul applicable en l’espèce pour des raisons techniques de non épuisement des voies de recours internes, qu’elles les a introduites par un arrêt Pagerie c/ France du 19 janvier (n° 24203/16, Dalloz actualité, 30 janv. 2023, obs. E. Maupin ; AJDA 2023. 103 ![]() ). Soulignant d’emblée l’importance qu’il fallait accorder au contexte de la vague d’attentats commis sur le territoire français à compter de 2015, elle organise les conditions d’une mise en balance plus favorable aux exigences de la lutte contre le terrorisme. Elle y parvient d’abord en affirmant qu’il lui revient d’exercer son contrôle à la lumière de la Convention considérée comme un ensemble indivisible au sein duquel les droits protégés sont interdépendants et intimement liés si bien que, en matière de lutte contre le terrorisme, la Convention impose aux États membres autant de prendre des mesures préventives pour protéger la vie de la population en cas de risque réel et immédiat d’attentat que d’assurer la garantie effective des droits protégés. Elle y parvient surtout en admettant que, sous réserve de l’existence de garanties contre l’arbitraire, le droit est plus particulièrement fondé à se servir de formules plus ou moins vagues, dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique lorsqu’il s’agit de faire face à des événements d’une gravité exceptionnelle et largement imprévisibles, et prévenir de manière la plus efficace possible la réalisation de risques majeurs pour la sécurité nationale, la sûreté publique et l’ordre public, et ainsi assurer le respect effectif du droit à la vie de la population. Les garanties contre l’arbitraire offertes par la France dans son arsenal de mesures d’urgence destinées à lutter contre le terrorisme ayant été jugées satisfaisantes, aucun constat de violation de l’article 2 du Protocole n° 4 n’a été dressé.
). Soulignant d’emblée l’importance qu’il fallait accorder au contexte de la vague d’attentats commis sur le territoire français à compter de 2015, elle organise les conditions d’une mise en balance plus favorable aux exigences de la lutte contre le terrorisme. Elle y parvient d’abord en affirmant qu’il lui revient d’exercer son contrôle à la lumière de la Convention considérée comme un ensemble indivisible au sein duquel les droits protégés sont interdépendants et intimement liés si bien que, en matière de lutte contre le terrorisme, la Convention impose aux États membres autant de prendre des mesures préventives pour protéger la vie de la population en cas de risque réel et immédiat d’attentat que d’assurer la garantie effective des droits protégés. Elle y parvient surtout en admettant que, sous réserve de l’existence de garanties contre l’arbitraire, le droit est plus particulièrement fondé à se servir de formules plus ou moins vagues, dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique lorsqu’il s’agit de faire face à des événements d’une gravité exceptionnelle et largement imprévisibles, et prévenir de manière la plus efficace possible la réalisation de risques majeurs pour la sécurité nationale, la sûreté publique et l’ordre public, et ainsi assurer le respect effectif du droit à la vie de la population. Les garanties contre l’arbitraire offertes par la France dans son arsenal de mesures d’urgence destinées à lutter contre le terrorisme ayant été jugées satisfaisantes, aucun constat de violation de l’article 2 du Protocole n° 4 n’a été dressé.
Réhabilitation de la particule nobiliaire
Depuis les arrêts Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994 (n° 16213/90, AJDA 1994. 511, chron. J.-F. Flauss ![]() ; ibid. 1995. 212, chron. J.-F. Flauss
; ibid. 1995. 212, chron. J.-F. Flauss ![]() ; D. 1995. 5
; D. 1995. 5 ![]() , note J.-P. Marguénaud
, note J.-P. Marguénaud ![]() ; RTD civ. 1994. 563, obs. J. Hauser
; RTD civ. 1994. 563, obs. J. Hauser ![]() ), Stjerna c/ Finlande du 25 novembre 1994 (n° 18131/91, AJDA 1995. 212, chron. J.-F. Flauss
), Stjerna c/ Finlande du 25 novembre 1994 (n° 18131/91, AJDA 1995. 212, chron. J.-F. Flauss ![]() ) ou Henry Kismoun c/ France du 5 décembre 2013 (n° 32265/10, Dalloz actualité, 17 déc. 2013, obs. R. Mésa ; AJDA 2014. 147, chron. L. Burgorgue-Larsen
) ou Henry Kismoun c/ France du 5 décembre 2013 (n° 32265/10, Dalloz actualité, 17 déc. 2013, obs. R. Mésa ; AJDA 2014. 147, chron. L. Burgorgue-Larsen ![]() ; AJ fam. 2014. 194, obs. C. Doublein
; AJ fam. 2014. 194, obs. C. Doublein ![]() ; RTD civ. 2014. 332, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2014. 332, obs. J. Hauser ![]() ), il ne fait plus le moindre doute que le nom et le prénom relèvent du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 en tant qu’élément majeur de l’identité de la personne. Il y a donc de temps en temps des constats de violation de ce que l’on peut appeler le droit au nom qui s’est conventionnellement imposé nonobstant les aspects de police civile qui font obligation de le porter et de ne pas en changer comme de chemise. Ils ont été dressés en raison de refus d’accepter un nom de famille choisi au moment d’un mariage ou d’une naissance (Losonci Rose et Rose c/ Suisse du 9 nov. 2010, n° 664/06, Dalloz actualité, 2 déc. 2010, obs. C. Schurrer ; D. 2011. 804
), il ne fait plus le moindre doute que le nom et le prénom relèvent du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 en tant qu’élément majeur de l’identité de la personne. Il y a donc de temps en temps des constats de violation de ce que l’on peut appeler le droit au nom qui s’est conventionnellement imposé nonobstant les aspects de police civile qui font obligation de le porter et de ne pas en changer comme de chemise. Ils ont été dressés en raison de refus d’accepter un nom de famille choisi au moment d’un mariage ou d’une naissance (Losonci Rose et Rose c/ Suisse du 9 nov. 2010, n° 664/06, Dalloz actualité, 2 déc. 2010, obs. C. Schurrer ; D. 2011. 804 ![]() , note C. Brière
, note C. Brière ![]() ) ; une demande de changement de nom (Henry Kismoun, préc.) ou de rectification de l’orthographe du nom (Bulgakov c/ Ukraine du 11 sept. 2007, n° 58894/00). Il y a eu aussi des cas de violation de l’article 8 parce qu’un changement de nom avait été imposé par les autorités comme dans l’affaire Daroczy c/ Hongrie du 1er juillet (n° 44378/05). L’arrêt Künsberg Sarre c/ Autriche du 17 janvier 2023 (n° 19474/20) vient d’enrichir spectaculairement cette quatrième catégorie. Il constate, en effet, plusieurs violations de l’article 8 parce que, en vertu d’une loi de 1919 sur l’abolition de la noblesse appliquée de manière un peu désordonnée, les requérants, à l’occasion d’un renouvellement de leur carte d’identité, avaient été obligés de jeter aux oubliettes la particule Von à laquelle ils étaient habitués. Rendue en considération de l’importance centrale des noms quant à l’auto-identification et l’auto-définition, la solution de la Cour de Strasbourg, si attentive à faire respecter les valeurs d’une société démocratique, est d’autant plus ironique qu’elle se plaît à reprocher aux autorités autrichiennes de n’avoir pas réussi à expliquer depuis 1919 en quoi l’interdiction de porter un nom de famille orné d’une particule était nécessaire pour maintenir l’égalité démocratique et la sécurité publique.
) ; une demande de changement de nom (Henry Kismoun, préc.) ou de rectification de l’orthographe du nom (Bulgakov c/ Ukraine du 11 sept. 2007, n° 58894/00). Il y a eu aussi des cas de violation de l’article 8 parce qu’un changement de nom avait été imposé par les autorités comme dans l’affaire Daroczy c/ Hongrie du 1er juillet (n° 44378/05). L’arrêt Künsberg Sarre c/ Autriche du 17 janvier 2023 (n° 19474/20) vient d’enrichir spectaculairement cette quatrième catégorie. Il constate, en effet, plusieurs violations de l’article 8 parce que, en vertu d’une loi de 1919 sur l’abolition de la noblesse appliquée de manière un peu désordonnée, les requérants, à l’occasion d’un renouvellement de leur carte d’identité, avaient été obligés de jeter aux oubliettes la particule Von à laquelle ils étaient habitués. Rendue en considération de l’importance centrale des noms quant à l’auto-identification et l’auto-définition, la solution de la Cour de Strasbourg, si attentive à faire respecter les valeurs d’une société démocratique, est d’autant plus ironique qu’elle se plaît à reprocher aux autorités autrichiennes de n’avoir pas réussi à expliquer depuis 1919 en quoi l’interdiction de porter un nom de famille orné d’une particule était nécessaire pour maintenir l’égalité démocratique et la sécurité publique.
Tragique actualité du droit à la vie et de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Avec quelques années ou quelques mois de recul, l’actualité jurisprudentielle des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme constitue une sorte d’inventaire raisonné des fléaux qui minent notre temps. Pour les mois de janvier et février, on y trouve, en effet, les signes avant-coureurs de la Guerre d’Ukraine avec la décision de grande chambre Ukraine et Pays-Bas c/ Russie du 19 janvier 2023 (n° 8019/16) qui déclare partiellement recevable les griefs dirigés contre la Russie relativement à la destruction imputée aux forces séparatistes pro-russes du Donetsk de l’appareil assurant le vol MH 17 de la Malaysia Airlines qui a coûté la vie 298 passagers et membres de l’équipage le 17 juillet 2014. Il y est également fait écho à la tragédie des migrants illégaux avec les arrêts Daraibou c/ Croatie du 17 janvier (n° 84723/17) qui constate une violation des deux volets substantiel et procédural de l’article 2 en raison d’un incendie mortel survenu dans un poste de police affecté à leur détention et Alhowais c/ Hongrie du 2 février (n° 59435/17) qui en fait autant tout en ajoutant une violation du volet procédural de l’article 3 dans un cas de noyade après refoulement du bateau des passeurs. Le terrorisme a été également représenté avec l’arrêt Machalikashvili c/ Géorgie du 19 janvier (n° 32245/19, Dalloz actualité, 21 févr. 2023, obs. E. Delacoure) qui dénonce, au regard de l’article 2, l’absence d’enquête effective sur une opération meurtrière destinée à lutter contre lui. L’indignité des conditions de détention est toujours à l’ordre du jour comme en témoigne l’arrêt Ochigava c/ Géorgie du 16 février (n° 14142/15) qui dénonce au regard des deux volets de l’article 3 des mauvais traitements parfois assimilables à des actes de torture infligés à un détenu et l’arrêt Machina c/ Moldavie du 17 janvier (n° 69086/14) jugeant que la transmission de l’hépatite C à un détenu et l’absence de soins adaptés contrevenait à la prohibition des traitements inhumains et dégradants. Le fléau des brutalités policières continue à laisser des traces jurisprudentielles dans l’affaire Cömert et autres c/ Turquie (n° 17231/17) qui, le 12 janvier a donné lieu à une atypique décision d’irrecevabilité provisoire en attente de l’aboutissement des voies de recours internes relative au décès d’un manifestant, dans l’affaire Elvan c/ Turquie (n° 64937/19) qui, elle, a débouché, le 7 février sur un constat de violation du volet procédural de l’article 2 en raison de l’ineffectivité de l’enquête sur les circonstances du décès d’un jeune manifestant après une blessure au lance-grenades et dans l’affaire M. B. et autres c/ Slovaquie n° 2 (n° 63962/19) relative aux morsures de chiens et au passage à tabac subis par de jeunes roms dans un commissariat de police qui, le 7 février, a donné lieu à des constats de violation de l’article 3 isolément et combiné avec l’article 14. Le cas le plus troublant de cette sinistre série est un cas de violence ministérielle. L’arrêt Kutayev c/ Russie du 24 janvier (n° 17912/15) se rapporte en effet aux tortures directement infligés par le ministre de l’Intérieur tchétchène à un militant des droits de l’homme qui avait refusé de se rendre à une réunion organisée par l’engageant Président Kadyrov. Cet arrêt n’a pas seulement dressé un constat de violation de l’article 3 : il a aussi considéré que l’héroïque militant des droits de l’homme avait été victime d’une violation de l’article 18 qui permet de lutter contre les détournements de pouvoir ; de l’article 5, § 1, parce que son arrestation et sa détention n’avaient pas de motifs légitimes et de l’article 6, § 1, en raison de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture. Les accidents de la route ont également donné lieu à un arrêt Hubert Nowak c/ Pologne du 16 février (n° 57916/16) qui, à la requête d’un accidenté devenu tétraplégique se plaignant d’avoir été trop longtemps laissé pour mort, a constaté une violation du violet procédural de l’article 2 et une non violation de son volet substantiel.
Regain de vitalité du droit à la liberté et à la sûreté
Depuis quelques temps le droit garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ne donnait lieu qu’à des arrêts et décisions un peu clairsemés. Déjà à l’œuvre dans l’atypique affaire Kutayev (préc., n° 9), il semble avoir bénéficié d’un regain de vitalité au début de l’année 2023. C’est d’abord la qualité des motifs des placements et des maintiens en détention qui l’a mobilisé de manière d’ailleurs contrastée : violation de l’article 5 parce qu’ils n’étaient ni suffisants ni pertinents dans l’arrêt Hysia c/ Albanie du 21 février (n° 52048/16) ; non violation dans l’arrêt Perstner c/ Luxembourg du 16 février (n° 7446/21) parce que les rejets des demandes de libération provisoire étaient, eux, correctement motivés. La personnalité des requérants qui ont réussi à faire juger que leur arrestation et leur détention avait violé l’article 5 aura beaucoup contribué à le remettre un peu en lumière : un journaliste dans l’arrêt Abdullah Kilic c/ Turquie du 31 janvier (n° 43979/17) qui a aussi constaté un violation du droit à la liberté d’expression ; le maire de Tbilissi, capitale de la Géorgie dans l’arrêt Ugulava du 9 février (n° 5432/15).Il faut également souligner l’intérêt des arrêts Dugan c/ Turquie du 7 février (n° 84543/17) qui dénonce au regard de l’article 5 la conduite au poste de police d’un transgenre pour une simple perturbation de la circulation ; Minasian et autres c/ Modalvie du 17 janvier (n° 26879/12) qui adopte la même solution en raison d’un placement en détention en attente d’expulsion. En revanche, dans l’affaire B. Y. c/ Grèce du 26 janvier (n° 60990/14) relative au renvoi, sous l’apparence d’une disparition forcée, d’un opposant politique de la Grèce vers la Turquie, l’absence de preuves concrètes et concordantes n’a pas permis de constater une violation de l’article 5 s’ajoutant à une violation du volet procédural de l’article 3 qui est la seule à avoir été dénoncée.
Omniprésence du droit à un procès équitable
Même si son champ d’application est limité aux contestations sur des droits et obligations dont le caractère civil doit être établi et au bien-fondé des accusations en matière pénale, l’article 6, § 1, déploie toujours un peu plus son influence dans les directions les plus diverses. Depuis quelques temps, on le sait il est mobilisé pour venir au soutien des magistrats eux-mêmes, de plus en plus souvent accablés de pressions et de représailles politiques. Les mois de janvier et février 2023 auront fourni à la Cour de Strasbourg de nouvelles occasions de placer le principe de séparation des pouvoirs sous le regard exigeant du droit à un procès équitable. Ainsi des violations de l’article 6, § 1, ont-elles été dénoncées par les arrêts Ovcharenko et Kolos c/ Ukraine du 12 janvier 2023 (n° 27276/15) parce qu’un juge avait été révoqué pour avoir contribué à une décision estimée politiquement incorrecte et Catana c/ Moldavie du 21 février (n° 43237/13) en raison d’une composition du Conseil supérieur de la Magistrature ne répondant pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Les accointances de l’article 6, § 1, avec le droit constitutionnel sont également révélées par l’arrêt Janacek c/ République tchèque du 2 février (n° 9634/17) qui a jugé contraire aux exigences du droit à un procès équitable le refus de communiquer des observations écrites produites par le juge à la demande de la Cour constitutionnelle.
L’article 6, § 1er, apporte aussi sa contribution à l’annexion du droit des contrats même si l’arrêt Parizek c/ République tchèque du 12 janvier (n° 76286/14) a considéré qu’il ne pouvait être d’aucun secours pour un locataire se plaignant d’une décision de justice qui avait contribué à donner une allure rétroactive à une augmentation des loyers.
Logiquement, c’est le droit processuel qui est exposée aux plus fortes influences de l’article 6, § 1. Renonçant, comme d’habitude, à une présentation absolument exhaustive des arrêts qui assurent le maintien de cette présence tous azimuts, on signalera seulement les arrêts Rocchia c/ France du 2 février (n° 74530/17) dénonçant à nouveau le formalisme excessif qui avait conduit cette fois à déclarer un appel irrecevable ; Paun Jovanovic c/ Serbie du 7 février (n° 41394/15) qui dénonce lui aussi l’insuffisance de la motivation d’une décision de justice ; Zaydov c/ Azerbaïdjan du 19 janvier (n° 60824/08) déplorant aussi l’insuffisance de la motivation de la décision de condamnation d’un hooligan et le déroulement de son procès qui ne lui avait pas permis de faire interroger les témoins à charge ; Miladinova c/ Bulgarie du 7 février (n° 31604/17) jetant l’opprobre sur un refus d’indemniser le préjudice provoqué par des poursuites pénales qui devaient déboucher sur un acquittement ou Rustamzade c/ Azerbaïdjan n° 2 du 23 février (n° 22323/16) estimant que, dans son ensemble, une procédure pénale n’avait pas répondu aux exigences d’un procès équitable. Parmi les arrêts et décisions, plus rares mais néanmoins significatifs qui ne débouchent pas sur un constat de violation de l’article 6, § 1, on remarquera la décision Taleski et autres c/ Macédoine du Nord du 16 février (n° 77796/17) qui en déclarant une requête irrecevable pour non épuisement de voies de recours internes prive d’une réponse à l’intéressante questions de savoir si les poursuites peuvent reprendre après l’annulation d’une grâce.
Retour sur l’article 8
Le droit au respect de la vie privée était au cœur des arrêts relatifs au sexe neutre, à la reconnaissance du couple homosexuel et aux particules nobiliaires qui ont été mis en exergue (préc., nos 2, 5 et 8). L’article 8 qui protège aussi le droit au respect des correspondances n’a pas pour autant cessé, au cours des mois de janvier et février 2023,de recevoir des applications plus banales. Ainsi l’arrêt Potoczka et Adamco c/ Slovaquie (n° 7286/16) du 12 janvier a-t-il constaté une nouvelle fois que la mise sur écoute téléphonique pouvait lui porter atteinte et l’arrêt Svetova c/ Russie du 24 janvier (n° 54714/17) – qui a aussi dressé un constat de violation de l’article 10 en raison de tentatives pour percer le secret des sources journalistiques – l’a mobilisé à nouveau pour dénoncer les conditions de la perquisition et de la saisie de documents qui cette fois avaient été opérées chez un défenseur des droits de l’homme. On trouve, comme toujours, un bon nombre d’arrêts qui ont redit à des parents que le refus de leur restituer leurs enfants placés dans une famille d’accueil n’avait pas porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale (Kilic c/ Autriche du 12 janvier, n° 27700/15) ou qui ont infligé la même réponse négative au parent qui se plaignait de la restitution à l’autre de l’enfant qu’il lui avait enlevé (G. K. c/ Chypre du 21 février, n° 16205/21). À peine remarquera-t-on un peu plus d’originalité dans l’arrêt Bycenko c/ Lituanie du 14 février (n° 10477/21) qui a estimé que le refus d’attribuer la garde de l’enfant à un père se plaignant d’une discrimination fondée sur le genre n’avait pas porté atteinte aux droits qu’il tient de l’article 8 et dans l’arrêt Jacquinet et Ambarek Ben Mohamed c/ Belgique (n° 62860/15) du 7 février justifiant au regard de l’article 8 le refus d’autoriser le père et le fils à changer leur patronyme pour le nom de la mère.
Harlem shake et autres manifestations de la liberté d’expression
Les lecteurs de cette chronique bimestrielle qui sont sans doute nombreux à pratiquer le Harlem shake apprendront sans doute avec plaisir que l’arrêt précité Rustmanzade c/ Azerbaïdjan n° 2 du 23 février (n° 22323/16) a consacré, au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, une sorte de droit d’utiliser internet pour diffuser des scènes d’exécution de cette danse que les autorités avaient interprétée comme un signe d’hooliganisme. Ceux, probablement plus nombreux, qui n’apprécient que modérément le genre des débats-spectacles télévisés ne seront sans doute pas trop attristés de savoir que l’arrêt C8 (Canal 8) c/ France du 9 février (n° 58951/18, Dalloz actualité, 22 févr. 2023, obs. S. Lavric) a estimé eu égard au caractère essentiellement commercial des comportements adoptés au cours de l’émission « Touche pas à mon poste », que la sanction de 3 000 000 d’euros infligée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en réaction à un canular sexiste et stéréotypé de son animateur, n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression de la société de télévision qui la diffuse.
L’article 10 a continué à exercer son rôle déterminant quant à la liberté d’expression de la presse soit pour la protéger comme l’a fait l’arrêt Khural et Zeylanov c/ Azerbaïdjan du 19 janvier (n° 383/12) qui a considéré qu’une condamnation pour diffamation par voie de presse assortie d’une obligation de publier des excuses avait violé l’article 10, soit pour rappeler que son exercice comporte des devoirs et responsabilités ainsi qu’en atteste l’arrêt Axel Springer SE c/ Allemagne du 17 janvier (n° 8964/18, Dalloz actualité, 24 janv. 2023, obs. S. Lavric) approuvant une décision de justice qui avait ordonné la publication d’un correctif à un article de presse.
Nouvelles applications du principe de non-discrimination
Au cours des deux premiers mois de l’année 2023, le principe de non-discrimination ne s’est peut-être pas montré aussi dynamique que d’ordinaire. On en relève cependant deux applications particulièrement intéressantes. La première résulte d’une combinaison classique, par l’arrêt Kreyndlin et autres c/ Russie du 31 janvier (n° 33470/18), de l’article 14 avec un autre article de la Convention avec cette originalité que cette fois, l’autre article est l’article 3 qui prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle aura permis de stigmatiser les agressions et les intimidations dirigées contre des militants de Greenpeace qui avaient participé en 2016 à une lutte contre des incendies généralisés. La seconde résulte de l’arrêt précité Paun Jovanovic c/ Serbie du 7 février qui, lui, mobilise le Protocole additionnel n° 12 pour dénoncer, de manière originale, une discrimination entre pratiquants de deux variantes de la langue nationale au cours d’une procédure pénale.
Polyvalence de l’article 1er du Protocole n° 1
Jamais série bimestrielle d’arrêts et décisions appliquant l’article 1er du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens n’a sans doute aussi montré que celle de janvier-février 2023 le nombre impressionnant de disciplines sur lesquelles il étend son influence. Ainsi ont-ils été concernés :
- le droit des biens avec l’arrêt Ibrahimbeyov et autres c/ Azerbaïdjan du 16 février (n° 32380/13) même s’il admet une annulation sans indemnisation de titres de propriété ;
- le droit des contrats avec l’arrêt précité Parizek c/ République tchèque du 12 janvier (n° 76286/14) même s’il reste insensible à une augmentation de loyers ;
- le droit bancaire avec la décision Freire Lopes c/ Portugal du 23 février (n° 58598/21) même si elle déclare irrecevable une requête s’insurgeant contre les conséquences patrimoniales de l’élimination des produits toxiques d’une banque en difficulté ;
- le droit social avec la décision Zegarac c/ Serbie du 9 février (n° 54805/15) même si elle déclare irrecevable une requête contestant la réduction des pensions de retraite mise en œuvre par un plan d’austérité ;
- le droit des procédures collectives avec l’arrêt Katona et Zavarsky c/ Slovaquie du 9 février (n° 43932/19) qui constate une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 en raison de l’effacement des dettes d’un débiteur soumis à une procédure collective ;
- le droit des propriétés intellectuelles avec l’arrêt Korotyuk c/ Ukraine du 19 janvier (n° 74633/17) qui constate une violation de l’article 1er du Protocole no 1 en raison de la mise à disposition sur un site de téléchargement payant d’un manuel scolaire sans le consentement de son auteur ;
- le droit de la famille avec les arrêts Domenech Araguilla et Rodriguez Gonzalez c/ Espagne du 19 janvier 2023 (n° 32667/19) et Valverde Digon c/ Espagne du 26 janvier (n° 22386/19) qui dénoncent l’absence de réversion de la pension au survivant ou à la survivante d’un couple en partenariat civil ;
- la procédure pénale avec les arrêts Akshyn Garayev c/ Azerbaïdjan du 2 février (n° 30352/11) et Capatina c/ Roumanie du 28 février (n° 911/16) qui se prononcent le premier pour constater une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 sur la durée de conservation des biens d’une personne poursuivie pendant le déroulement de la procédure ; le second pour juger qu’il n’y avait pas de violation sur la confiscation des biens d’une personne condamnée pour corruption et criminalité organisée.
Divers
Il convient enfin de faire une place à l’arrêt Hoppen et Syndicat des employés A.B. Amber Grid c/ Lituanie du 17 janvier (n° 976/20) qui n’a pas jugé contraire à l’article 11 qui consacre aussi la liberté syndicale le licenciement d’un syndicaliste impliqué dans une négociation collective et à l’arrêt Valaitis c/ Lituanie du 17 janvier (n° 39375/19) qui ne constate pas de violation de l’article 13 consacrant le droit à un recours effectif pour la très intéressante raison que les autorités avaient tenu compte d’un précédent arrêt de la Cour pour introduire des changements clairs et positifs pour mieux réprimer les délits homophobes.
© Lefebvre Dalloz