Chronique de droit des entreprises en difficulté du 4e trimestre 2024
Après avoir présenté quelques statistiques en matière de défaillance d’entreprises, cet article dresse le panorama des arrêts les plus importants rendus par la Cour de cassation en droit des entreprises en difficulté au cours de la fin de l’année 2024. Le volet sanctions occupe une place de choix.
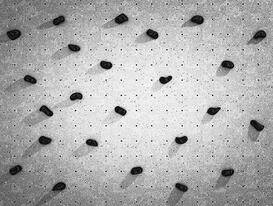
Quelques statistiques
Les chiffres du troisième trimestre 2024 sont connus et nous pouvons avoir une vision plus complète à présent. Nous avons déjà signalé que 63 741 défaillances avaient été enregistrées sur douze mois au 30 septembre 2024, selon la Banque de France, dont 1 151 sauvegardes, 14 047 redressements judiciaires. La tendance à l’augmentation déjà constatée est confirmée pour l’année 2024, soit environ 63 000 défaillances sur un an. Il faut cependant relever que 94 % des défaillances concernent des entreprises de moins de 10 salariés et 68 % des procédures sont des liquidations judiciaires directes. Depuis octobre 2021, il n’y a eu que 200 procédures de sortie de crise, mais les praticiens considèrent cependant que cet outil reste utile.
Rappelons, en ce qui concerne les prêts garantis par l’État (PGE), que plus de 800 000 ont été accordés pour un total d’environ 150 milliards d’euros jusqu’à juin 2022. La dernière échéance de remboursement devrait arriver en 2026 avec un taux de non-remboursement assez faible. Fin 2024, deux tiers des PGE devraient être remboursés. Il n’y a eu que 4 % d’entreprises qui ont rencontré des difficultés pour rembourser leur PGE, soit environ 30 000 entreprises, mais seulement 1 100 entreprises ont fait appel au médiateur du crédit pour une restructuration.
Pour ce qui est, enfin, des délais de paiement, le délai moyen de treize jours de retard a été enregistré au premier semestre 2024 selon le cabinet Altarès. Moins d’une entreprise sur deux paye ses fournisseurs dans le délai prévu. L’Espagne, l’Italie et le Portugal payent encore plus tard. Ces retards de paiement seraient responsables d’environ 25 % des défaillances des entreprises (M. Di Martino, note n° 179 du 29 oct. 2024, qui fait une bonne synthèse ; v. aussi, Veille permanente, 22 oct. 2024, qui pointe une augmentation des procédures collectives en hausse de 35 % entre 2022 et 2023).
La conciliation
La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en matière de prévention : le débiteur est dispensé de déclarer son état de cessation des paiements pendant le cours de la conciliation, tant que la procédure existe. Mais lorsqu’elle est terminée, cette obligation reprend sa vigueur (Com. 20 nov. 2024, n° 23-12.297 FS-B, Dalloz actualité, 5 déc. 2024, obs. P. Cagnoli ; D. 2024. 2004 ![]() ; RCJPP 2024, n° 06, p. 47, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RCJPP 2024, n° 06, p. 47, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ![]() ; RTD com. 2024. 997, obs. F. Macorig-Venier
; RTD com. 2024. 997, obs. F. Macorig-Venier ![]() ). Selon le commentateur précité, la logique du raisonnement de la Cour de cassation semble « imparable » en référence à l’article L. 611-4 du code de commerce. Il considère que l’obligation de déclarer cet état formulée par l’article L. 631-4 n’existe qu’autant que le débiteur n’a pas, dans le délai de quarante-cinq jours, sollicité une conciliation. En l’espèce, l’état de cessation des paiements est intervenu pendant la conciliation. La Cour de cassation considère que le bilan doit être déposé sans délai si l’état de cessation des paiements est intervenu pendant la conciliation. Là encore, le choix de cette expression semble bienvenu à ce commentateur éminent.
). Selon le commentateur précité, la logique du raisonnement de la Cour de cassation semble « imparable » en référence à l’article L. 611-4 du code de commerce. Il considère que l’obligation de déclarer cet état formulée par l’article L. 631-4 n’existe qu’autant que le débiteur n’a pas, dans le délai de quarante-cinq jours, sollicité une conciliation. En l’espèce, l’état de cessation des paiements est intervenu pendant la conciliation. La Cour de cassation considère que le bilan doit être déposé sans délai si l’état de cessation des paiements est intervenu pendant la conciliation. Là encore, le choix de cette expression semble bienvenu à ce commentateur éminent.
Cependant, il importe de nuancer cette analyse en regard des considérations de la pratique. Plusieurs points doivent être à cet égard rappelés :
- en premier lieu, la demande usuelle du conciliateur consiste à demander un stand still aux créanciers concernés, c’est-à-dire une suspension d’exigibilité pendant la durée de la conciliation. Cette formalité n’est pas anodine et elle permet de préserver un climat de sérénité indispensable à la négociation. Cela pourrait contredire la règle de principe fixée par l’arrêt, en réalité, il s’agit d’une commodité souhaitable ;
- en outre, il importe que la demande de délai formulée contre le créancier récalcitrant soit faite pendant la durée de la conciliation pour favoriser la négociation et l’obtention d’un accord avec les autres créanciers. Là encore, il s’agit de traiter la question de la cessation des paiements pendant la conciliation et non à son issue. En effet, après l’échec de la conciliation, cette demande de délai ne pourra être évidemment traitée dans les mêmes conditions ;
- enfin, il faut rappeler que dès qu’il constate l’échec de la négociation, le conciliateur doit demander qu’il soit mis fin à sa mission et le dirigeant doit assumer sa responsabilité car, dès lors, il doit déclarer son état de cessation des paiements. Pourrait-on considérer qu’il dispose d’un nouveau délai de quarante-cinq jours après la fin de la conciliation ? Cela pourrait être logique et pratique pour préparer ce dépôt de bilan. La Cour de cassation semble imposer un dépôt de bilan immédiat mais chacun sait qu’un dépôt de bilan doit être préparé pour éviter une casse supplémentaire. Cette question doit donc rester ouverte et sans recourir à Raymond Devos ou à Fernand Reynaud, la question de l’immédiateté reste posée. On peut cependant imaginer qu’il existe un laps de temps entre l’échec de la conciliation et la date du rapport du conciliateur. Après ce rapport, le président rend une ordonnance mettant fin à la mission du conciliateur et c’est dès lors, que l’obligation de dépôt de bilan prend son plein effet.
Il convient en outre de souligner que lorsqu’un stand still est accordé pendant la durée de la procédure, on peut imaginer qu’il existe un espoir d’accord pendant la durée de la conciliation qui a été ouverte. La question se pose cependant sur le mois supplémentaire qui peut être demandé par le conciliateur. Si l’échec de la conciliation est patent et indiscutable, ce mois supplémentaire ne sera pas demandé et la fin de la mission aura donc lieu à l’issue de la période initialement accordée.
Le dirigeant n’a de toute façon pas intérêt à trop attendre, car le temps d’inaction dégrade l’entreprise et accroît sa responsabilité personnelle, notamment lorsqu’il faudra apprécier le montant de l’aggravation du passif entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Une obligation de célérité relève donc ici du bon sens.
Les créances
La procédure d’admission des créances. Une nouvelle décision fait le point sur les conséquences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective (Com. 2 oct. 2024, n° 23-18.665 F-B, Dalloz actualité, 13 nov. 2024, obs. R. Laffly ; RCJPP 2024, n° 06, p. 20, obs. C. Simon ![]() ; Veille permanente, 29 oct. 2024, note J.-P. Rémery). Il faut rappeler que dans une instance en cours qui tend à une condamnation à payer une somme d’argent, le mandataire judiciaire doit être mis en cause pour que la reprise d’instance soit régulière. Il doit aussi être intimé en cas d’appel du créancier. À défaut, l’appel est irrecevable.
; Veille permanente, 29 oct. 2024, note J.-P. Rémery). Il faut rappeler que dans une instance en cours qui tend à une condamnation à payer une somme d’argent, le mandataire judiciaire doit être mis en cause pour que la reprise d’instance soit régulière. Il doit aussi être intimé en cas d’appel du créancier. À défaut, l’appel est irrecevable.
En l’espèce, c’est la société débitrice in bonis qui avait introduit l’instance en paiement et le défendeur avait formulé une demande reconventionnelle qui avait fait l’objet d’une déclaration de créance après l’ouverture de la procédure. En appel, le défendeur prétendument créancier, avait relevé appel de la décision ayant rejeté sa demande de fixation au passif de sa créance. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel qui a déclaré sa demande irrecevable.
La note – intéressante – de Jean-Pierre Rémery sur cet arrêt fait le point sur la procédure de vérification du passif en présence d’une instance en cours, en citant notamment les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce. Elle fait aussi le point sur la notion de l’indivisibilité de l’appel en matière de vérification du passif, le débiteur ayant le droit propre de discuter son passif, le créancier et le mandataire judiciaire ayant intérêt à suivre la procédure. L’idée est, en effet, que le passif doit être fixé sans contestation à l’égard de tous, ce qui suppose que la décision soit opposable à tous. Les parties concernées doivent donc être mises en cause. En outre, même après l’adoption du plan, le mandataire judiciaire doit être présent ès-qualités.
La contestation sérieuse d’une créance. Nous savons qu’en application de l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse sur une créance invite la personne intéressée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré, à peine de forclusion, sauf en cas d’appel, si cette voie de recours est ouverte.
La Cour de cassation a jugé qu’en cas de confirmation de l’ordonnance qui a invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente, le délai d’un mois court à compter de la notification de l’arrêt. Le délai a donc couru deux fois et c’est le second délai qui est le bon (Com. 23 oct. 2024, n° 23-17.962 F-B, Dalloz actualité, 13 nov. 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1861 ![]() ). Le commentateur indique qu’il est tiraillé entre deux visions opposées, considérant que l’arrêt de la Cour de cassation est pragmatique mais que le procédé utilisé lui paraît dangereux. Il considère que l’appel pourrait être utilisé ainsi à des fins dilatoires pour échapper au couperet de la forclusion du mois.
). Le commentateur indique qu’il est tiraillé entre deux visions opposées, considérant que l’arrêt de la Cour de cassation est pragmatique mais que le procédé utilisé lui paraît dangereux. Il considère que l’appel pourrait être utilisé ainsi à des fins dilatoires pour échapper au couperet de la forclusion du mois.
Cependant, dès lors que la Cour a fixé un nouveau délai d’un mois, la solution apparaît bien pragmatique. Il pourrait être envisagé que les cours d’appel, dans le dispositif de leurs arrêts, désignent quelle partie doit saisir le juge de la contestation sérieuse et sous quels délais à peine de la forclusion d’un mois, courant à compter de la signification du jugement. Ne serait-il pas temps de revoir le texte pour éviter une acrobatie ? Nous rejoignons donc l’avis de Benjamin Ferrari.
Cautionnement et procédure collective
Les effets d’une liquidation judiciaire sur la caution. En l’espèce, après la liquidation d’une société, la caution qui avait exécuté son engagement lors de la mise en redressement judiciaire a assigné en paiement les sous-cautions. Il a été considéré que la déclaration de créance à la procédure collective effectuée par la caution avait interrompu la prescription de son action contre la sous-caution jusqu’à la clôture de la procédure collective.
La cour d’appel avait déclaré l’action prescrite en relevant que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis le paiement par la caution auprès de la banque créancière. Or, il fallait tenir compte des causes d’interruption de la prescription prévues par les articles 2241 et 2246 du code civil, de sorte que l’arrêt a été cassé (Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.093 FS-B, Dalloz actualité, 21 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2149 ![]() , note D. Sindres
, note D. Sindres ![]() ; RCJPP 2024, n° 06, p. 47, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; RCJPP 2024, n° 06, p. 47, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ![]() ; RTD civ. 2024. 934, obs. C. Gijsbers
; RTD civ. 2024. 934, obs. C. Gijsbers ![]() ; Gaz. Pal. 22 oct. 2024, p. 26 ; Veille permanente, 5 nov. 2024, note F. Reille, qui rappelle que la caution doit déclarer sa créance au passif du débiteur principal, même avant paiement, comme le confirme l’art. L. 622-34 c. com, en application de l’ord. n° 2021-1193 du 15 sept. 2021 et depuis cette date).
; Gaz. Pal. 22 oct. 2024, p. 26 ; Veille permanente, 5 nov. 2024, note F. Reille, qui rappelle que la caution doit déclarer sa créance au passif du débiteur principal, même avant paiement, comme le confirme l’art. L. 622-34 c. com, en application de l’ord. n° 2021-1193 du 15 sept. 2021 et depuis cette date).
Les conséquences de l’annulation de l’ouverture d’un compte courant sur la caution. Dans cette affaire après une liquidation judiciaire, des cautions avaient été assignées par une banque, mais un jugement avait constaté que les engagements pris par les cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, seule une troisième caution ayant été condamnée. En appel, celle-ci a été condamnée à payer une somme au titre des restitutions consécutives à l’annulation de la convention d’ouverture des comptes courants et de la convention d’autorisation de découvert en limitant la déduction des frais et intérêts bancaires à ceux dus au titre du découvert. Cet arrêt a été cassé car la Cour de cassation a estimé qu’il fallait déduire tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d’ouverture des comptes courants, compte tenu de leur annulation (Com. 11 sept. 2024, n° 23-11.534 F-B, Dalloz actualité, 19 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1573 ![]() ; Veille permanente, 1er oct. 2024, note N. Casal).
; Veille permanente, 1er oct. 2024, note N. Casal).
Signalons aussi un arrêt intéressant qui évoque la notion de disproportion de la caution par rapport à ses biens et revenus sur l’évaluation des parts sociales et sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution non avertie (Com. 9 oct. 2024, n° 23-15.346 F-B, Dalloz actualité, 15 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1772 ![]() ; RTD civ. 2024. 873, obs. H. Barbier
; RTD civ. 2024. 873, obs. H. Barbier ![]() ; ibid. 936, obs. C. Gijsbers
; ibid. 936, obs. C. Gijsbers ![]() ; Gaz. Pal. 5 nov. 2024, p. 20, note P. Grulier).
; Gaz. Pal. 5 nov. 2024, p. 20, note P. Grulier).
Les sanctions
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quel passif prendre en considération ?
La Cour de cassation a rappelé les sommes qu’il faut prendre en compte pour déterminer une insuffisance d’actif (Com. 23 oct. 2024, n° 23-15.365 FS-B, Dalloz actualité, 23 oct. 2024, obs. T. Duchesne ; D. 2024. 1863 ![]() ; Rev. sociétés 2024. 745, obs. P. Roussel Galle
; Rev. sociétés 2024. 745, obs. P. Roussel Galle ![]() ; Veille permanente, 15 nov. 2024, note M. Dizel). Il est bien connu que l’article L. 651-2 du code de commerce dispose que pour mettre à la charge de l’ancien dirigeant fautif le montant de l’insuffisance d’actif, en tout ou en partie, il convient de ne tenir compte que des dettes nées avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, trois cogérants s’étaient succédé, l’un d’entre eux étant qualifié de dirigeant de fait par le liquidateur judiciaire. C’est la responsabilité de ce dernier qui avait été retenue, solidairement avec un dirigeant de droit. Les juges du fond avaient déduit du montant de l’actif recouvré lors de la liquidation, des sommes correspondant à des frais de recouvrement du compte client et de ventes aux enchères. Le pourvoi indiquait que ces dettes nées après le jugement d’ouverture ne pouvaient entrer dans le passif pris en considération pour déterminer l’insuffisance d’actif prise en compte. La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel en soulignant que ces dettes n’avaient pu naître qu’après le jugement déclaratif, de sorte qu’elles ne pouvaient effectivement pas être ajoutées au passif pris en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif.
; Veille permanente, 15 nov. 2024, note M. Dizel). Il est bien connu que l’article L. 651-2 du code de commerce dispose que pour mettre à la charge de l’ancien dirigeant fautif le montant de l’insuffisance d’actif, en tout ou en partie, il convient de ne tenir compte que des dettes nées avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, trois cogérants s’étaient succédé, l’un d’entre eux étant qualifié de dirigeant de fait par le liquidateur judiciaire. C’est la responsabilité de ce dernier qui avait été retenue, solidairement avec un dirigeant de droit. Les juges du fond avaient déduit du montant de l’actif recouvré lors de la liquidation, des sommes correspondant à des frais de recouvrement du compte client et de ventes aux enchères. Le pourvoi indiquait que ces dettes nées après le jugement d’ouverture ne pouvaient entrer dans le passif pris en considération pour déterminer l’insuffisance d’actif prise en compte. La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel en soulignant que ces dettes n’avaient pu naître qu’après le jugement déclaratif, de sorte qu’elles ne pouvaient effectivement pas être ajoutées au passif pris en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif.
Dans sa note, le professeur Thibaut Duchesne a rappelé les principales règles régissant la matière en relevant notamment que prendre en considération un passif postérieur reviendrait à condamner le dirigeant pour des dettes dont il n’a pas la maîtrise, dès lors qu’il est dessaisi de la gestion de l’entreprise. Il considère donc que cette solution mérite approbation, y compris pour les frais du recouvrement, dès lors qu’il a été entrepris postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. En outre, ces frais permettaient d’augmenter l’actif appréhendable par les créanciers. Cette solution mérite en effet d’être retenue pour appliquer d’une manière correcte la règle fixée clairement par l’article précité.
La négligence et la responsabilité pour insuffisance d’actif
Nous savons que cette responsabilité ne peut être invoquée en cas de simple négligence depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », qui a complété l’article L. 651-2 du code de commerce. En l’espèce, il avait été reproché à un dirigeant la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel et il avait été relevé que le bilan et le grand livre de la période considérée n’avaient pas été fournis, la faute résultant de la tenue d’une comptabilité incomplète irrégulière ou fictive. Le dirigeant a considéré que ces motifs ne peuvent caractériser une faute qui ne soit pas une simple négligence.
La Cour de cassation a estimé que les motifs retenus étaient impropres à caractériser une faute qui ne soit pas une simple négligence dans la gestion de la société. Cet arrêt peut paraître surprenant car la non-fourniture d’un bilan va sans doute au-delà d’une simple négligence (Com. 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Dalloz actualité, 17 oct. 2024, obs. T. Duchesne ; D. 2024. 1716 ![]() ; Rev. sociétés 2024. 745, obs. P. Roussel Galle
; Rev. sociétés 2024. 745, obs. P. Roussel Galle ![]() ; Veille permanente, 2 oct. 2024, note M. Dizel). Doit-on imaginer que la tenue d’une comptabilité incomplète relève par principe de la négligence ? Par sa carence, le dirigeant n’a-t-il pas privé le tribunal de la possibilité d’apprécier la création d’un nouveau passif en période suspecte ? Il faut imaginer que la solution doit être nuancée et qu’à l’occasion du renvoi de cette affaire, les juges motiveront d’une manière plus approfondie, leur décision.
; Veille permanente, 2 oct. 2024, note M. Dizel). Doit-on imaginer que la tenue d’une comptabilité incomplète relève par principe de la négligence ? Par sa carence, le dirigeant n’a-t-il pas privé le tribunal de la possibilité d’apprécier la création d’un nouveau passif en période suspecte ? Il faut imaginer que la solution doit être nuancée et qu’à l’occasion du renvoi de cette affaire, les juges motiveront d’une manière plus approfondie, leur décision.
La responsabilité du dirigeant d’une personne morale qui dirige une SAS
En l’espèce, une SAS était donc dirigée par une personne morale qui était elle-même dirigée par un dirigeant personne physique. La SAS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et le liquidateur a agi en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant personne physique de la personne morale, présidente de la SAS. Le liquidateur a obtenu satisfaction devant le tribunal et devant la cour d’appel. Le dirigeant a cependant considéré que les statuts de la SAS prévoyaient que la personne morale, présidente, avait désigné un représentant permanent autre que lui-même. Dès lors, il contestait sa responsabilité et la Cour de cassation lui a donné raison en rendant un arrêt de censure (Com. 20 nov. 2024, n° 23-17.842 F-B, Dalloz actualité, 29 nov. 2024, obs. T. Duchesne ; D. 2024. 2005 ![]() ).
).
Certes, l’article L. 651-1 du code de commerce dispose que la responsabilité est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales, mais il est aussi prévu que lorsqu’une SAS est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la personne physique qui dirige cette personne morale, ne peut voir sa responsabilité engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.
La Cour de cassation a donc procédé à une interprétation stricte. Pourtant, l’article L. 227-7 du code de commerce prévoit que si la SAS peut être dirigée par une personne morale, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Le commentateur considère que l’article L. 651-2 étant un texte « spécial », il doit primer sur le droit commun de la SAS (T. Duchesne, obs. préc.).
Droit social des entreprises en difficulté
La demande d’une expertise par le Comité social et économique
Il s’agissait en l’espèce de la nécessité du recours à un expert-comptable dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique (C. trav., art. L. 2312-63). Dans le cadre de l’alerte qui avait été déclenchée par le Comité social et économique (CSE), l’employeur avait demandé l’annulation de la délibération du CSE au tribunal judiciaire et il avait obtenu gain de cause. En l’espèce, un expert avait déjà été désigné moins de deux mois avant pour effectuer une expertise dans le cadre de l’information consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ce qui représentait pour chaque expertise, une dépense de 30 000 €. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du CSE (Soc. 11 sept. 2024, n° 23-12.500, Veille permanente, 4 oct. 2024, note S. Baudouin).
Il faut préciser qu’en deux ans et demi il s’agissait de la quatorzième demande d’expertise, ce qui en dit long sur les abus qui peuvent être commis. Il faut souligner que le tribunal judiciaire avait retenu qu’il n’avait pas à statuer sur le bienfondé sur le droit d’alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l’expertise. Il faut ajouter que le tribunal avait exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour considérer que l’expertise n’était pas nécessaire, compte tenu de l’expertise précédente. Sur les quatorze expertises exercées en deux ans et demi, trois l’avaient été dans le cadre du droit d’alerte économique, de sorte qu’un abus avait bien été relevé.
Les garanties collectives en cas de liquidation judiciaire de l’employeur
La Cour de cassation a précisé les conditions d’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 19 sept. 2024, n° 22-22.190, Gaz. Pal. 26 nov. 2024, p. 39, note B. Waltz-Teracol). Lorsqu’un employeur est en liquidation judiciaire, les anciens salariés licenciés peuvent bénéficier du maintien à titre gratuit de certaines garanties en cas de cessation du travail non consécutive à une faute lourde. La Cour de cassation indique que ces dispositions qui sont d’ordre public ne sont applicables que si le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur n’est pas résilié. Il n’importe pas à cet égard que la résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés.
Le feuilleton de l’AGS et de la liquidation judiciaire
Nous avons déjà commenté plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation sur l’épineuse question du droit de l’AGS à être remboursée de ses avances au titre des créances superprivilégiées. Lorsque l’AGS les a ainsi perçues, peut-elle en restituer une partie au liquidateur pour lui permettre d’être réglé de ses émoluments ? La réponse vient d’être rendue et elle est négative. En effet, la Cour de cassation considère que le paiement n’est pas réalisé à titre provisionnel, mais à titre définitif et hors du classement des créanciers (Com. 20 nov. 2024, n° 23-19.085 F-B, Dalloz actualité, 4 déc. 2024, obs. L. Fin-Langer ; D. 2024. 2005 ![]() ).
).
Était ici en cause le domaine de la subrogation de l’AGS dans les créances des salariés qui ont en principe une nature alimentaire (nous avions commenté les arrêts du 17 janv. 2024, nos 22-19.451 et 23-12.283, Dalloz actualité, 1er févr. 2024, obs. C. Gailhbaud ; D. 2024. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ![]() ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ![]() ; RTD civ. 2024. 112, obs. H. Barbier
; RTD civ. 2024. 112, obs. H. Barbier ![]() ). En l’espèce, le liquidateur avait remis à l’AGS 40 000 € et six ans plus tard, il demandait la restitution d’une somme de 3 013 € pour payer ses émoluments, ce que l’AGS avait refusé.
). En l’espèce, le liquidateur avait remis à l’AGS 40 000 € et six ans plus tard, il demandait la restitution d’une somme de 3 013 € pour payer ses émoluments, ce que l’AGS avait refusé.
Il faut préciser que la Cour a rendu un arrêt de cassation au visa de l’article L. 625-8, applicable à la liquidation judiciaire. Il ne s’agissait pas ici d’un paiement provisionnel en application de l’article L. 643-3, alinéa 1er, du code de commerce. En pratique, cette solution va sans doute inciter les liquidateurs à conserver des fonds qui leur permettront ultérieurement d’être réglés de leurs émoluments et d’en tenir compte dans le cadre des versements qui auront lieu au profit de l’AGS. D’une manière générale, nous sommes convaincus que c’est par le dialogue entre l’AGS et les liquidateurs qu’une solution sera trouvée, ce qui permettra de rétablir une coopération fructueuse qui existait encore récemment. Cela ne pourra être fait que par le rétablissement d’un climat de confiance et par une bonne entente, indispensables entre les acteurs de la procédure collective.
Questions diverses
La fixation d’une astreinte provisoire après l’ouverture d’une sauvegarde
Cette action était-elle soumise ou non à l’interdiction des poursuites ? Après l’ouverture d’une sauvegarde, il a été jugé que cette action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Dès lors, l’ouverture de la procédure de sauvegarde était sans incidence sur la possibilité de fixer une nouvelle astreinte provisoire à l’égard du débiteur qui poursuivait son activité et qui pouvait être contraint à exécuter ses obligations de faire (Com. 11 sept. 2024 n° 23-15.441, Dalloz actualité, 23 oct. 2024, obs. D. Lemberg-Guez ; RCJPP 2024, n° 06, p. 18, obs. N. Hoffschir ![]() ; RTD civ. 2024. 884, obs. H. Barbier
; RTD civ. 2024. 884, obs. H. Barbier ![]() ; Veille permanente, 4 nov. 2024, note P. Roussel Galle).
; Veille permanente, 4 nov. 2024, note P. Roussel Galle).
L’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur
La Cour de cassation a rappelé que, dans le cadre d’une procédure ouverte après la publication de la loi du 6 août 2015 (C. com., art. L. 526-1), l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale a effet à l’égard de la procédure collective et dans ce cas, le liquidateur ne peut demander d’ordonner la vente de l’immeuble devenu indivis et constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire (Com. 11 sept. 2024, n° 23-17.721, AJDI 2024. 808 ![]() ; Veille permanente, 9 oct. 2024, note P. Roussel Galle).
; Veille permanente, 9 oct. 2024, note P. Roussel Galle).
Dans cette affaire, la résolution du plan de redressement avait été prononcée en 2017 et les époux au profit desquels le plan avait été arrêté ont divorcé en 2020. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Le liquidateur, tant de l’ex-époux que de l’ex-épouse, a souhaité se faire autoriser à vendre l’immeuble, mais l’irrecevabilité avait été soulevée, dès lors qu’il s’agissait de la résidence principale de l’ex-époux. La demande du liquidateur était irrecevable, étant précisé qu’en l’espèce, les juges d’appel avaient retenu que l’insaisissabilité légale invoquée ne pouvait s’opposer au principe du paiement des dettes dont chaque époux est tenu sur les biens communs. La Cour de cassation a considéré que la loi avait été violée et a de ce fait censuré l’arrêt d’appel.
La cession du fonds de commerce du débiteur
Il faut rappeler que cette cession doit se faire selon les modalités fixées par le juge-commissaire dans le cadre d’une vente de gré à gré des biens meubles d’un débiteur en liquidation judiciaire. Il s’agit ici de l’application de l’article L. 642-19 du code de commerce applicable à ce type de vente. Le juge-commissaire avait autorisé ici la cession, le transfert de propriété étant reporté au jour de la notification de l’ordonnance à l’acquéreur.
Quelques jours après, le liquidateur avait résilié le bail et avait mis en demeure l’acquéreur de récupérer les matériels et le stock pour libérer les locaux. Il faut préciser que l’offre de reprise ne comprenait pas le droit au bail. Puis, l’acte de cession avait été signé sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur des agréments nécessaires par la Direction générale des douanes et la Française des jeux, s’agissant d’un buraliste. Le prix avait été remis au notaire. Puis, l’acquéreur avait renoncé à la vente et il a été poursuivi par le liquidateur qui souhaitait que soit constatée la réalisation des conditions suspensives et qu’il soit condamné à verser à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la valeur du fonds de commerce et au montant des indemnités d’occupation payées au bailleur, ainsi que les frais de déménagement.
Les juges du fond avaient condamné l’acquéreur à régler les indemnités d’occupation et les frais de déménagement et cette solution a été confirmée par la Cour de cassation. En effet, le juge-commissaire avait rendu sa décision qui avait été notifiée sans qu’un recours ait été formulé. L’acquéreur était donc devenu propriétaire des actifs cédés à la date de notification de l’ordonnance et il lui appartenait d’en prendre possession. Cependant, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû rechercher si le liquidateur n’avait pas tardé à libérer les lieux après avoir résilié le bail commercial, de sorte qu’il aurait ainsi contribué à la faute et à la réalisation du dommage dont il demandait réparation (Com. 2 oct. 2024, n° 23-16.325 F-D, Veille permanente, 18 oct. 2024, note B. Joret).
Une transmission universelle du patrimoine intervenue en cas de dissolution de la société au cours d’un plan
Dans cette affaire, toutes les parts sociales avaient été réunies en une seule main et l’inaliénabilité du fonds de commerce avait été prévue pendant le cours du plan de redressement. Dans ce cas, la dissolution de la société n’a pas entraîné la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique. Il faut relever qu’au cours de l’exécution du plan, la société, même dissoute, ne perd pas sa capacité d’ester en justice (Com. 2 oct. 2024, n° 23-14.912 F-B, Dalloz actualité, 25 oct. 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1716 ![]() ).
).
La note, particulièrement intéressante, rappelle que la réunion de toutes les parts sociales d’une société en une seule main, n’entraîne pas sa dissolution de plein droit, même si tout intéressé peut la solliciter si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an (C. civ., art. 1844-5, al. 1er). En cas de dissolution, il est prévu qu’elle entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, nécessairement personne morale et ce sans qu’il y ait lieu à liquidation (C. civ., art. 1844-5, al. 3 et 4).
En l’espèce et pendant le cours du plan, la dissolution avait été prononcée par anticipation d’une SARL qui avait pour associée unique une autre société depuis une cession de parts intervenue un mois avant la décision. Puis la SARL a assigné l’un de ses débiteurs et elle a été radiée. L’associée unique de la SARL dissoute a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour poursuivre l’instance. Puis un jugement a constaté l’exécution du plan de redressement de la SARL et a prononcé la clôture de la procédure collective. La société poursuivie en paiement des factures va contester cette action engagée par la SARL et sa capacité d’ester en justice a donc été remise en cause, compte tenu de sa dissolution intervenue au cours de l’exécution du plan.
La Cour de cassation a donc rappelé que la dissolution d’une société dont toutes les parts sociales ont été réunies en une seule main intervenue au cours d’un plan de redressement n’entraîne pas la transmission de son patrimoine à l’associée unique.
Compte tenu de l’inaliénabilité au cours de l’exécution du plan et de la dissolution intervenue pendant cette période, la transmission de cet élément du patrimoine demeurait soumise aux exigences du droit des entreprises en difficulté, de sorte que la transmission universelle du patrimoine (TUP) n’a pu s’opérer et la capacité d’ester en justice de la société dissoute est demeurée intacte.
Benjamin Ferrari commente avec clarté cet arrêt en rappelant l’argumentation des thèses opposées et nous renvoyons à la lecture de son intéressante chronique. Il examine en détail les conséquences de la mesure d’inaliénabilité qui avait été prononcée et considère que l’inaliénabilité n’est pas la seule raison pour laquelle le jeu de l’article 1844-5 du code civil est proscrit, postérieurement à l’adoption d’un plan. Il considère aussi qu’il n’est pas certain qu’une TUP puisse avoir lieu après l’adoption d’un plan. Il relève qu’il existe une difficulté concernant le droit d’opposition des créanciers d’une société soumise à un plan. Cela pourrait en effet se heurter à la suspension des poursuites individuelles concernant les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure (C. com., art. L. 622-21), dès lors que le débiteur ne peut procéder à leur paiement (C. com., art. L. 622-7). Il faut donc rester prudent sur la possibilité de procéder à une TUP dans de telles conditions au cours de l’exécution d’un plan et dès lors, ce commentaire apparaît particulièrement intéressant.
Les fonctions du mandataire judiciaire après l’arrêt du plan
Il a été jugé que le jugement qui a arrêté le plan d’une société en désignant le commissaire à l’exécution du plan ne met pas fin aux fonctions du mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances. Ainsi, l’absence du mandataire judiciaire en appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel, dès lors que cette matière est indivisible au sens de l’article 553 du code de procédure civile (Com. 2 oct. 2024, n° 23-18.665 F-B, Dalloz actualité, 13 nov. 2024, obs. R. Laffly ; RCJPP 2024, n° 06, p. 20, obs. C. Simon ![]() ). En l’espèce, l’affaire est compliquée par le fait que le mandataire judiciaire avait une double casquette, car il était aussi commissaire à l’exécution du plan et il aurait dû être mis en cause en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, ce qui n’a pas été fait. Il ne faut donc pas oublier d’intimer le mandataire judiciaire et le lecteur est invité à se reporter à cet égard au commentaire cité.
). En l’espèce, l’affaire est compliquée par le fait que le mandataire judiciaire avait une double casquette, car il était aussi commissaire à l’exécution du plan et il aurait dû être mis en cause en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, ce qui n’a pas été fait. Il ne faut donc pas oublier d’intimer le mandataire judiciaire et le lecteur est invité à se reporter à cet égard au commentaire cité.
Les conséquences du plan de sauvegarde sur les statuts
La Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité qui dénonçait une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Une atteinte existait en effet selon le demandeur par l’effet de l’article L. 626-3 du code de commerce qui permet de dépasser la minorité de blocage s’opposant aux modifications statutaires rendues nécessaires par le plan de sauvegarde. Rappelons en effet que le juge peut autoriser l’assemblée générale des associés à adopter les modifications statutaires prévues dans le projet de plan à la majorité simple, ce qui neutralise le droit de vote des associés minoritaires. Il était indiqué qu’aucune restriction n’avait été prévue sur la nature et la gravité des modifications statutaires, ce qui posait problème selon la demanderesse à la tierce opposition. En outre, le juge statue sur requête et sans débat contradictoire. Il a donc été jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer les questions au conseil constitutionnel (Com., QPC, 10 juill. 2024, n° 24-11.071, Rev. sociétés 2024. 532, obs. L. C. Henry ![]() ; 11 sept. 2024, n° 24-12.371, Veille permanente, 27 sept. 2024, note L. C. Henry).
; 11 sept. 2024, n° 24-12.371, Veille permanente, 27 sept. 2024, note L. C. Henry).
La procédure de redressement judiciaire sans administrateur
Que peut faire le dirigeant dans un tel cadre ? Il a été répondu qu’il peut embaucher un salarié sans l’autorisation du juge-commissaire. En l’espèce, il avait embauché un apprenti pour une durée de deux ans mais la liquidation judiciaire avait provoqué la rupture anticipée de ce contrat et l’AGS avait refusé de payer les indemnités de rupture. L’apprenti avait donc assigné le dirigeant en responsabilité et l’arrêt d’appel avait considéré qu’il aurait dû soumettre ce contrat à l’autorisation du juge-commissaire (C. com., art. L. 622-7, II). La Cour de cassation a considéré que les articles L. 622-3 et L. 622-7 (dans la rédaction antérieure à l’ord. n° 2021-1193 du 15 sept. 2021, Dalloz actualité, 17 sept. 2021, obs. K. Lemercier et F. Mercier ; ibid., 20 sept. 2021, obs. K. Lemercier et F. Mercier) avaient été violés car le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et il exerce les fonctions dévolues à l’administrateur. Dès lors, il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans autorisation du juge-commissaire car cela ne constitue pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise (Com. 2 oct. 2024, n° 23-11.022 F-D, Rev. sociétés 2024. 744, obs. L. Caroline Henry ![]() ; Veille permanente, 8 oct. 2024, note C. Cadic).
; Veille permanente, 8 oct. 2024, note C. Cadic).
Il faut aussi signaler l’hypothèse d’une procédure de revendication : en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à une demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. Cet accord ne peut en outre résulter du seul silence de ce mandataire après la réception de la copie de la demande de revendication de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur (Com. 23 oct. 2024, n° 23-18.095 F-B, Dalloz actualité, 18 nov. 2024, obs. R. Pfortner ; D. 2024. 1861 ![]() ). Rappelons que la situation est prévue par l’article L. 641-14-1 du code de commerce. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel en faisant état de la nécessité de la protection de la collectivité des créanciers. Le commentateur précise, à juste titre, que le créancier doit s’assurer de l’accord du mandataire judiciaire et il importe donc d’attirer l’attention sur cette nécessité.
). Rappelons que la situation est prévue par l’article L. 641-14-1 du code de commerce. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel en faisant état de la nécessité de la protection de la collectivité des créanciers. Le commentateur précise, à juste titre, que le créancier doit s’assurer de l’accord du mandataire judiciaire et il importe donc d’attirer l’attention sur cette nécessité.
Les conditions de la compensation légale
Nous savons que lorsqu’une procédure collective a été ouverte, une compensation pose problème. En principe, elle est interdite, car elle suppose l’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes (C. civ., art. 1347). La compensation permet en effet le paiement d’une dette, alors qu’en principe, la procédure collective provoque une interdiction des paiements concernant les créances antérieures à l’ouverture de cette procédure. En l’espèce, il s’agissait d’apprécier les conditions dans lesquelles une compensation légale peut s’opérer au profit du cessionnaire d’une créance après la notification de la cession au débiteur. Cette notification doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective pour permettre à cette compensation légale de s’opérer (Com. 23 oct. 2024, n° 23-17.704 F-B, Dalloz actualité, 27 nov. 2024, obs. D. Boustani-Aufan ; D. 2024. 1861 ![]() ; APC 2024, n° 19, p. 3, obs. L. Fin-Langer, qui rappelle que l’article 1323 du code civil prévoit que la cession produit ses effets immédiatement entre les parties. Elle rappelle également que la notification de la cession est essentielle et précise que le cessionnaire est le perdant puisqu’il ne peut obtenir le paiement par compensation).
; APC 2024, n° 19, p. 3, obs. L. Fin-Langer, qui rappelle que l’article 1323 du code civil prévoit que la cession produit ses effets immédiatement entre les parties. Elle rappelle également que la notification de la cession est essentielle et précise que le cessionnaire est le perdant puisqu’il ne peut obtenir le paiement par compensation).
© Lefebvre Dalloz