Clarification et mise à jour des règles d’organisation et de fonctionnement de la justice
Le 28 novembre 2024 a été publié le décret n° 2024-1073 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire. Ce décret adapte et modifie des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice dans cinq codes différents. Sont principalement concernées les règles relatives au juge unique du tribunal judiciaire, celles concernant le greffe du Tribunal mixte de commerce de Papeete et celles encadrant le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales. L’objectif est de clarifier et de rendre plus lisibles certaines dispositions.
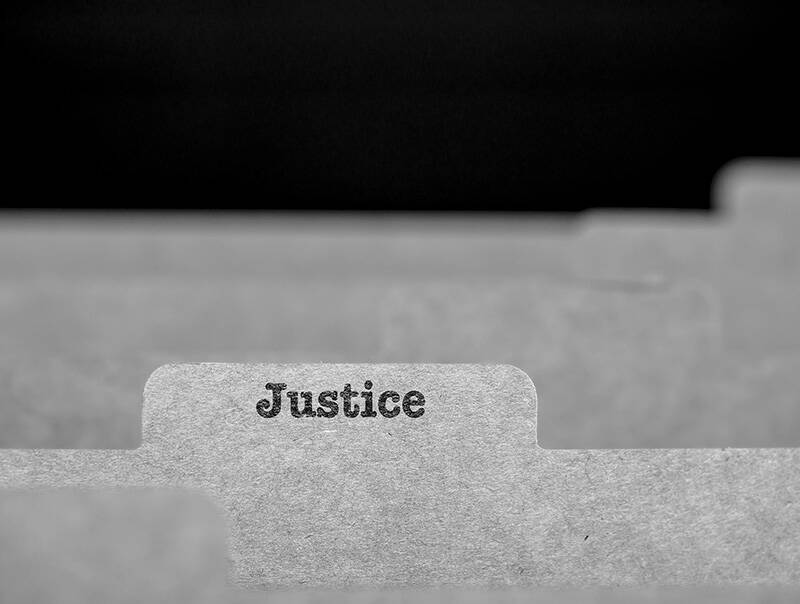
Le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire, entré en vigueur le 30 novembre 2024 (art. 20, I), a pour objet de mettre à jour, de clarifier et de rendre plus lisibles certaines dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice. Il procède ainsi à une modification du code de l’organisation judiciaire, du code de commerce, du code pénitentiaire, du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du code du travail. Sont principalement concernées les règles relatives au juge unique du tribunal judiciaire, au comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales et au greffe du Tribunal mixte de commerce de Papeete.
La clarification des règles relatives au juge unique devant le tribunal judiciaire
Pour rappel, si le principe est le recours à une formation collégiale afin de garantir une décision de qualité et l’impartialité de la juridiction, il constitue néanmoins une limite à la célérité de la justice. C’est pourquoi l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire autorise le recours à un juge unique. En effet, à la lecture de ce texte, des exceptions à la collégialité existent en fonction de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger. Toutefois, l’alinéa 2 de ce même article précise que, sous réserve des compétences exclusives du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes. Ainsi, le « législateur a pensé, non sans raison, que certaines affaires graves ne pouvaient en aucun cas être soustraites aux garanties de la collégialité » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. III, Sirey, 1991).
Cette exception à la collégialité est prévue aux articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire. Le premier dispose que le recours à un juge unique est de plein droit dans les hypothèses énumérées par cet article. Le second prévoit que le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut décider qu’une affaire sera tranchée par un juge unique. Avant le décret du 28 novembre 2024, l’article R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire énonçait que ce renvoi à un juge unique pouvait se faire « en toute matière ». Une incohérence existait toutefois avec l’article L. 212-1 du même code, lequel prévoyait, comme indiqué supra, une exception au recours au juge unique. La lecture de la partie réglementaire nécessitait une bonne connaissance de la partie législative, qui interdit le juge unique dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes. Le décret clarifie cette situation en insérant un renvoi à l’article L. 212-1 à l’article R. 212-9 afin de délimiter le champ d’application du recours à un juge unique.
La procédure consécutive à ce renvoi à un juge unique n’a pas été modifiée. Le code de procédure civile prévoit que cette attribution peut intervenir jusqu’à la fixation de la date d’audience (C. pr. civ., art. 812), sans que la décision soit motivée, puisqu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Les parties ou leurs avocats en sont simplement avisés (C. pr. civ., art. 812). Le juge unique exercera alors les pouvoirs conférés tant au tribunal qu’au juge de la mise en état (C. pr. civ., art. 813).
La précision quant à la composition du comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales
Le décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 (Dalloz actualité, 13 déc. 2023, obs. M. Chollet) a institué, au sein des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales (COJ, art. R. 212-62-1). Par ailleurs, il a créé le rôle de magistrats coordonnateurs, l’un appartenant au siège et l’autre au parquet. En complément de ce pôle, un comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales (COPIL) a également été institué dans les seuls tribunaux judiciaires (COJ, art. R. 212-62-2). Le COPIL a pour objectif de réunir les acteurs impliqués dans la prise en charge des situations individuelles en ce domaine et de garantir la pertinence ainsi que l’actualité des informations échangées. En pratique, deux types de comités de pilotage existaient : un comité pragmatique, qui n’examinait pas les situations individuelles et un comité judiciaire, composé d’un nombre limité de participants, dédié à l’étude des cas individuels. Le décret du 23 novembre 2023 a codifié l’existence du COPIL. Ce dernier se réunit au moins une fois par an, avec un ordre du jour établi conjointement par les chefs de juridictions. Il est composé des membres du pôle spécialisé, auxquels les chefs de juridictions peuvent ajouter, selon l’ordre du jour, des représentants de l’administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, des services de l’État, des collectivités territoriales, d’associations, etc. En prenant acte de ces évolutions, le décret du 28 novembre 2024 a introduit l’article R. 113-14-1 dans le code pénitentiaire, précisant la possibilité pour des représentants de l’administration pénitentiaire d’être invités à participer à ces comités de pilotage.
Les règles relatives aux greffiers
Le décret commenté apporte aussi des éclaircissements quant aux greffiers.
En premier lieu, pour être nommé greffier au tribunal de commerce, le candidat doit, en principe, être inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article R. 742-16 du code de commerce (C. com., art. R. 742-19). Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les lauréats du concours mentionné à l’article R. 742-6-1 du même code et ayant validé leur stage ou bénéficiant d’une dispense. L’inscription sur la liste d’aptitude prend fin dans les cas suivants : à la demande de l’intéressé, à la date de sa nomination ou après l’expiration d’un délai de cinq ans (C. com., art. R. 742-17-1, al. 1er). Par dérogation, ce délai de cinq ans est suspendu lorsque la personne inscrite sur la liste exerce les fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française, ou celles de greffier du Tribunal mixte de commerce de Papeete (C. com., art. R. 742-17-1, al. 3). Dans ce cas, le délai de cinq ans ne recommence à courir qu’après la cessation des fonctions. Il convient de noter qu’il s’agit d’une suspension et non d’une interruption du délai. Ainsi, ce dernier reprendra à partir du moment où il s’était arrêté avant la suspension.
En second lieu, le décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 relatif au greffe du Tribunal de première instance et du Tribunal mixte de commerce de Papeete est modifié, et de nouvelles dispositions sont intégrées au code de l’organisation judiciaire. D’une part, le costume du greffier du tribunal mixte de commerce ou de son délégué est précisé (COJ, art. R. 553-20) ; d’autre part, il est prévu l’obligation pour le greffier du tribunal mixte de commerce de contracter une assurance de responsabilité professionnelle (COJ, art. R. 553-21). Si le décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 entre en vigueur le 1er janvier 2025, les règles édictées par le décret du 28 novembre 2024 entrent, quant à elles, en vigueur dès le 1er décembre 2024.
La clarification de diverses dispositions
Enfin, le décret du 28 novembre 2024 revient sur un certain nombre d’articles afin d’assurer une meilleure lisibilité. Ces modifications seront simplement mentionnées ici.
Il clarifie le service juridictionnel au sein du tribunal judiciaire en abrogeant l’article R. 212-11 du code de l’organisation judiciaire, en considération des dispositions des articles L. 212-8 et R. 212-20 de ce même code. Le texte abrogé prévoyait que le premier président de la cour d’appel pouvait désigner un magistrat du siège exerçant au sein d’une chambre de proximité pour remplir, conformément à une disposition réglementaire, les fonctions de président ou de membre d’une commission juridictionnelle ou administrative.
Il clarifie les règles relatives aux assemblées générales des juridictions.
Pour le tribunal judiciaire, le décret intègre les dispositions de l’article 8 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, qui modifie notamment l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Cet article précise les conditions d’accès au statut de magistrat exerçant à titre temporaire et les fonctions pouvant être exercées. Ont été ajoutées les fonctions suivantes « assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux civil, assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal […] de substitut près les tribunaux judiciaires […] [présidence de] l’audience de règlement amiable ». En conséquence, les règles sur les assemblées générales ont été modifiées dans le code de l’organisation judiciaire pour préciser que les magistrats exerçant à titre temporaire y assistent. Cela concerne celles des magistrats du siège (COJ, art. R. 212-34, al. 7), celles des magistrats du parquet – ils peuvent exercer la fonction de substitut (COJ, art. R. 212-38, al. 7) –, celles des magistrats du siège et des magistrats du parquet (renvoi aux art. R. 212-34 et R. 212-38 par art. R. 212-41, al. 7) et celles plénières des magistrats et des fonctionnaires (renvoi aux art. R. 212-34 et R. 212-38 par art. R. 212-49, al. 7).
Pour la cour d’appel, le décret corrige des imprécisions rédactionnelles concernant la commission restreinte pour l’assemblée des magistrats du siège et du parquet (COJ, art. R. 312-50). Effectivement, il était difficile de concilier les articles R. 312-27, R. 312-50 et R. 312-58 du code de l’organisation judiciaire. Selon le premier de ces textes, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet inclut nécessairement une commission restreinte. Cependant, le deuxième laissait entendre que, dans certaines juridictions, une telle commission n’était pas obligatoire. Enfin, le dernier définissait la composition de la commission plénière et prévoyait des dispositions spécifiques en l’absence de commission restreinte dans une cour d’appel. Cet écueil rédactionnel est corrigé par le décret, qui affirme que cette commission restreinte est obligatoire dans toutes les juridictions d’appel.
Il abroge, plus de quinze ans après la révision constitutionnelle du 23 février 2007 relative à la responsabilité pénale du président de la République, l’alinéa 3 de l’article R. 411-7 du code de l’organisation judiciaire concernant la nomination par le bureau de la Cour de cassation des membres de la commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Avant la réforme constitutionnelle et la loi n° 2014-1392 du 24 novembre 2014, la commission d’instruction était composée de magistrats du siège. Cet article ne pouvait être maintenu, car l’enquête est désormais menée par une commission composée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat.
Il précise également quel juge du tribunal judiciaire préside l’installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. L’article R. 492-7 du code rural et de la pêche maritime précise désormais qu’il s’agit du juge désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il réalise une refonte de l’annexe de l’article R. 1422-4 du code du travail, qui énumère les ressorts et sièges des conseils de prud’hommes. Une nouvelle présentation de cette annexe était nécessaire, l’ancienne étant jugée difficile à consulter.
Enfin, le décret intègre ces changements en modifiant en conséquence les dispositions relatives à l’outre-mer et en supprimant notamment un renvoi à un article inexistant (COJ, art. R. 562-31-3).
Décr. n° 2024-1073, 28 nov. 2024, JO 29 nov.
© Lefebvre Dalloz