Climat : les grandes entreprises ne sont pas sur la bonne voie
Négligeant une partie de leurs activités ou misant de manière excessive sur les mécanismes de compensation, vingt-quatre grands groupes industriels sont pointés du doigt par une étude. Au-delà de ces cas particuliers, définir une politique climatique sincère demande à être vigilant sur ses émissions indirectes et sur la confiance dans des technologies qui n'ont pas fait leurs preuves et qui ne verront peut-être jamais le jour (techno-solutionnisme).
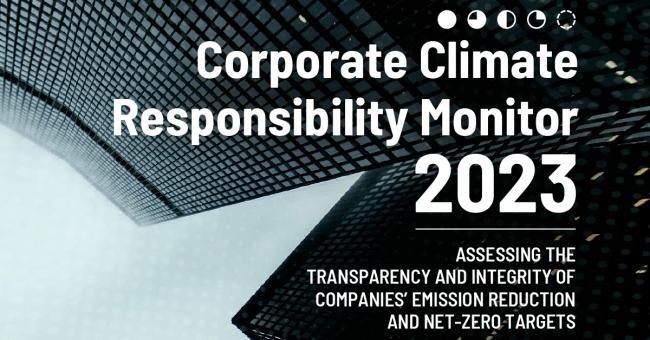
Les résultats ne sont pas bons. Dans un rapport publié lundi 13 février, les groupes de réflexion New climate institute et Carbon market watch ne sont pas tendres avec les vingt-quatre entreprises multinationales dont elles ont analysé les engagements climatiques. Et qui représentent 4 % des émissions mondiales si l’on tient compte de leur empreinte indirecte (que l’on qualifie de Scope 3 dans le jargon carbone). Le rapport dénonce des « engagements ambigus » et « un manque de crédibilité » de politiques qui sont pourtant présentées comme exemplaires par ces mêmes entreprises. Toutes promettent sur le papier d’atteindre des niveaux d’émissions compatibles avec l’accord de Paris. Mais les promesses n’engagent que ceux qui y croient. De l’industrie à la tech et à la grande distribution, aucun secteur n’est épargné.
Scope 3 oublié
Davantage que les bons et mauvais points que délivre le rapport, son intérêt est d’attirer l’attention sur des problématiques que l’ensemble des structures engagées vers la neutralité carbone doivent apprendre à mieux prendre en compte. Attention en particulier à ne pas reporter à demain les engagements les plus structurants sous prétexte qu’il faut avancer pas à pas. Si dans le panel des vingt-quatre, les entreprises se fixent des objectifs à 2030, elles ont trop tendance à minorer leurs enjeux, insiste l’étude. Se focalisant beaucoup trop, en particulier, sur leurs émissions directes. Or le Scope 3 représente 90 % des émissions de gaz à effet de serre de la plupart des entreprises étudiées.
Quelques calculs montrent que la somme des engagements permettra de réduire de 15 à 21 % des émissions sur la chaîne de valeur étudiée entre 2019 et 2030 s’ils sont tenus. Il faudrait atteindre -43 voire -48 % à l’échelle mondiale afin de plafonner la température de la planète à 1,5 degré au-dessus des températures qui étaient celles de l’ère préindustrielle.
Bonnet d’âne pour Carrefour
Plus ennuyeux encore, la majorité des entreprises ne semblent pas se donner les moyens de décarboner leur activité. À l’instar de Carrefour ou Walmart, 17 groupes sont accusés d’afficher des ambitions malhonnêtes sur le long terme. Le géant français de la grande distribution est notamment pointé du doigt car non seulement il exclut de ses calculs sa chaîne d’approvisionnement en produits et en emballages, mais surtout 80 % de ses sites ! En France, seuls 11 % des 5 799 magasins apparaissent ainsi dans le périmètre du groupe. Les autres sont considérés comme des franchises indépendantes et priés de faire leurs propres calculs.
Si le cas est extrême, le rapport souligne un autre écueil bien plus répandu : la grande place laissée aux technologies de séquestration du carbone (CCUS pour Carbon Capture, Utilization and Storage), et plus globalement aux mécanismes de compensation. Le rapport émet des doutes sur l’additionnalité des mesures envisagées par les uns et les autres et qui pourraient laisser croire que les objectifs peuvent être tenus sans grands efforts d’atténuation.
Bons élèves
A contrario, le rapport met en exergue cinq groupes qui affichent des ambitions à la hauteur des attentes afin de réduire sensiblement leurs émissions d’ici 2030 et d’en effacer 90 % en 2040 de l’amont à l’aval de leur activité… montrant ainsi que le combat n’est pas perdu d’avance. Même les entreprises qui n’ont pas encore pris la mesure des enjeux ont heureusement encore la possibilité de rattraper en suivant leur exemple !
Le combat n’est pas perdu, mais il n’est pas gagné non plus. Parmi ces bons élèves, le spécialiste des textiles H&M demeure ainsi très dépendant à des paris technologiques visant à maximiser l’efficacité des matériaux utilisés dans la fabrication d’habits, ainsi qu’à sa capacité à mobiliser une grande quantité de biomasse pour atteindre ses objectifs de production d’énergie décarbonée. Or en matière de transition, tout est question d’équilibre. La forêt est une source d’approvisionnement durable en bois si elle est utilisée raisonnablement. Elle ne l’est plus lorsque tout le monde retient les mêmes options et que la consommation bondit au-delà du raisonnable.
© Lefebvre Dalloz