Comparution forcée de la victime devant le tribunal correctionnel
Aucune disposition du code de procédure pénale ne permet de contraindre la partie civile à comparaître devant la juridiction correctionnelle. Cependant, à défaut d’une confrontation entre la plaignante et la personne qu’elle met en cause, en phase pré-sentencielle, il appartient aux juges d’envisager l’ensemble des moyens procéduraux à leur disposition pour permettre cette confrontation et de vérifier si l’absence de la partie civile était justifiée par une excuse légitime.
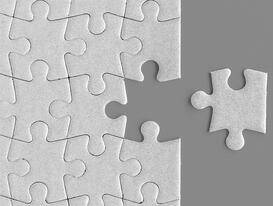
Contexte de l’affaire
Le 2 juillet 2016, une jeune femme alors âgée de dix-sept ans déposait plainte contre un homme pour agression sexuelle sur personne dont la vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de son auteur, infraction réprimée par les articles 222-27 et suivants du code pénal.
Le Tribunal correctionnel de Sens, par un jugement du 1er octobre 2020, condamna le mis en cause à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, prononça une confiscation et se prononça sur les intérêts civils. Ce jugement était frappé d’appel par l’ensemble des parties.
La Cour d’appel de Paris, par un premier arrêt du 12 janvier 2022 annula le jugement du Tribunal correctionnel de Sens pour défaut de motivation, rejeta une exception de nullité et renvoya l’examen de l’affaire.
Par un arrêt du 23 mars 2022, la cour d’appel faisait droit à la demande de renvoi formée par la défense « dans le but de permettre l’exercice des droits de la défense ». En d’autres termes, elle acceptait la demande de renvoi de la défense mais rejetait l’argument formulé par celle-ci tenant en la recherche de la comparution forcée de la victime. La Cour estimait en effet que « lorsqu’elle examinera le fond, la cour aura à rechercher, à supposer que la victime persiste dans sa volonté de ne pas se présenter, s’il existe à la procédure des éléments compensateurs permettant de pallier l’absence de toute confrontation avec le prévenu et, à défaut, d’en tirer toutes les conséquences »
Enfin, par un arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris condamna le mis en cause à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, prononça une confiscation et se prononça sur les intérêts civils.
Trois pourvois étaient alors soulevés : le premier contre l’arrêt du 12 janvier 2022 que la Cour de cassation n’admettra pas, se fondant sur l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ; le second contre l’arrêt du 23 mars 2022 et plus précisément contre le rejet de la demande de comparution forcée de la partie civile par la défense ; et enfin le troisième contre l’arrêt du 26 janvier 2023 condamnant le mis en cause et se prononçant sur les intérêts civils.
Il ressort des différents moyens envisagés dans le pourvoi en cassation formé contre les arrêts du 23 mars 2022 et du 26 janvier 2023 que la plaignante a systématiquement refusé de se confronter à son prétendu agresseur, tant au cours de la procédure, en ne participant pas à la confrontation organisée pendant l’enquête, que devant les juges, en refusant de comparaître devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel malgré la citation adressée par la défense à la plaignante et à ses parents. Se posait alors la question, soulevée par la défense dans ses pourvois, de savoir si une partie civile pouvait être contrainte à comparaître devant un tribunal correctionnel.
Rappel de la distinction entre les notions de victime et de témoin en droit interne
L’une des premières difficultés à laquelle la Cour de cassation a dû répondre dans le cadre de ces trois pourvois tenait en la confusion entre la notion de « témoin » au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et celle de témoin au sens du code de procédure pénale.
En effet, la notion de témoin revêt un sens autonome au sein du système de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme l’a elle-même souligné à plusieurs reprises (CEDH 20 nov. 1989, Kostovski c/ Pays-Bas, n° 11454/85, § 40, RSC 1990. 149, obs. L.-E. Pettiti ![]() ; ibid. 388, obs. L.-E. Pettiti
; ibid. 388, obs. L.-E. Pettiti ![]() ; 24 avr. 2012, Damir Sibgatullin c/ Russie, n° 1413/05, § 45 ; 27 janv. 2011, Krivoshapkin c/ Russie, n° 42224/02, § 56). Ainsi, peuvent être considérés comme témoins devant cette cour les coaccusés, les experts, les policiers ou encore les victimes (Rép. dr. eur., v° Conv. EDH, art. 6 : La protection du droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, par A. Sicilianos et M.-A. Kostopoulou).
; 24 avr. 2012, Damir Sibgatullin c/ Russie, n° 1413/05, § 45 ; 27 janv. 2011, Krivoshapkin c/ Russie, n° 42224/02, § 56). Ainsi, peuvent être considérés comme témoins devant cette cour les coaccusés, les experts, les policiers ou encore les victimes (Rép. dr. eur., v° Conv. EDH, art. 6 : La protection du droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, par A. Sicilianos et M.-A. Kostopoulou).
En droit interne, la distinction entre les témoins et les parties civiles est davantage marquée. En effet, malgré l’absence de définition légale, il est admis que la partie civile désigne la personne qui se prétend victime d’une infraction pénale lorsqu’elle entend, à ce titre, être présente au procès pénal (Rép. pén., v° Partie civile, par P. Bonfils). Elle est donc une partie à part entière du procès pénal et se distingue à ce titre du témoin à différents égards, notamment en ce qu’elle dispose du droit de rester dans la salle pendant tous les débats, en ce qu’elle est dispensée de prêter serment, etc.
Dans un précédent arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation avait déjà eu à se prononcer sur la frontière entre la partie civile et le témoin (Crim. 29 mars 2017, n° 15-86.434, Dalloz actualité, 20 avr. 2017, obs. W. Azoulay ; D. 2017. 763, obs. N. explicative de la Cour de cassation ![]() ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier
; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ![]() ; AJ pénal 2017. 288, obs. G. Pitti
; AJ pénal 2017. 288, obs. G. Pitti ![]() ; RSC 2017. 342, obs. F. Cordier
; RSC 2017. 342, obs. F. Cordier ![]() ). En l’espèce, la partie civile avait en effet perdu sa qualité à la suite de l’appel unique du ministère public et devait donc, selon la chambre criminelle, être considérée comme un simple témoin et entendue comme tel sans pouvoir bénéficier d’un avocat.
). En l’espèce, la partie civile avait en effet perdu sa qualité à la suite de l’appel unique du ministère public et devait donc, selon la chambre criminelle, être considérée comme un simple témoin et entendue comme tel sans pouvoir bénéficier d’un avocat.
Par l’utilisation de guillemets dans ses moyens, entourant le terme de témoin, la défense prouve en l’espèce que la partie civile au sens du droit pénal français ne peut être considérée comme tel.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 23 mars 2022, tranche en faveur du maintien de la notion restrictive du témoin en droit français en jugeant que « en l’état actuel du droit positif et des articles 422 et 424 du code de procédure pénale, la comparution forcée de la partie civile citée comme témoin est proscrite ». En effet, selon ces deux dispositions combinées, force est de constater que la victime devenue partie civile ne peut plus être considérée comme témoin et qu’à ce titre, contrairement à ce dernier, elle peut toujours se faire représenter par son avocat.
De cette distinction découle une conséquence déterminante en l’espèce : a contrario du témoin qui, conformément à l’article 439 du code de procédure pénale, peut être contraint par la juridiction de comparaître pour témoigner, aucune disposition du code de procédure pénale n’impose à la victime de se présenter après avoir été citée à comparaître. Telle est la position rappelée par la Cour de cassation lorsqu’elle rejette le moyen formé contre l’arrêt du 23 mars 2022, en ce qu’il critique le refus d’ordonner la comparution forcée de la partie civile.
Précision sur les conditions de la dispense de comparution de la victime face à la demande du prévenu non confronté à elle durant la procédure
La confrontation entre une plaignante et la personne qu’elle met en cause peut se faire à deux stades distincts de la procédure pénale. Soit dans le cadre de l’enquête de police ou de l’information judiciaire, soit dans le cadre de l’audience devant la juridiction compétente.
Pour rappel, s’agissant de la confrontation pré-sentencielle, il s’agit d’un acte d’enquête ayant pour objectif la manifestation de la vérité en comparant deux versions des faits a priori discordantes. Initialement laissée à l’appréciation souveraine du magistrat instructeur, la confrontation est aujourd’hui un acte d’enquête susceptible d’être sollicité par les parties dans le cadre d’une information judiciaire (C. pr. pén., art. 82-1, al. 11 ; C. Guéry, Droit et pratique de l’instruction préparatoire, Dalloz Action, 2022).
S’agissant de la confrontation dans le cadre de l’audience pénale, il est important de rappeler que la présence des parties civiles au procès pénal a fait l’objet de nombreuses et vives critiques (P. Bonfils, préc.). L’argument principal tenait/tient au fait que, en France, le procès pénal est avant tout le procès du délinquant contre la société représentée par le ministère public.
Toutefois, il est indéniable que la victime est, mieux que personne, bien placée pour connaître les détails de la commission de l’infraction. Ainsi, sa présence tout au long du procès constitue bien souvent une source d’information non négligeable pour les magistrats et, dans le cadre d’un procès criminel, pour le jury populaire.
Outre pour l’apport d’éléments essentiels sur le déroulement des faits, la présence de la victime sera également déterminante dans l’appréciation, par les juridictions, de la personnalité de l’auteur et donc dans la détermination du quantum de la peine qui doit être adaptée à cette dernière.
Le présumé coupable d’une infraction aura ainsi parfois intérêt à faire citer la victime devant la juridiction qui a à juger de son affaire. Plus encore, l’article 6, § 3, d), de la Convention européenne prévoit qu’il a le droit « d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». C’est une garantie du droit à un procès équitable. Et la victime représente, comme évoqué ci-dessous, un tel témoin au sens de la jurisprudence européenne (CEDH 14 juin 2016, Riahi c/ Belgique, n° 65400/10, § 39)
La chambre criminelle a ainsi saisi l’occasion, en l’espèce, de venir préciser les obligations des juges du fond confrontés, d’un côté, aux déclarations incriminantes d’une plaignante et, de l’autre, à l’absence de confrontation entre cette dernière et la personne qu’elle incrimine. Pour ce faire, la Cour de cassation s’est principalement fondée sur la jurisprudence européenne en vigueur et plus précisément sur le droit à un procès équitable au sens de cette dernière.
Ainsi, elle affirme que, d’une part, les juges du fond doivent mettre en œuvre tous les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de la partie civile à l’audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l’interroger.
Si l’anonymat, technique déjà prévue pour protéger les témoins (C. pr. pén., art. 706-62-2 et art. R. 53-27 s.), pourrait être envisagé, les magistrats pourront en outre avoir recours aux nouvelles technologies pour tenter d’assurer cette confrontation. L’épidémie du covid-19 a plus que jamais démocratisé le recours à la visioconférence dans le monde judiciaire et la Cour de cassation estime ici que le recours à ce moyen de télécommunication audiovisuel était offert aux juges du fond par le code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 706-71, al. 3) et aurait donc dû être envisagé.
S’agissant plus particulièrement des victimes d’infractions sexuelles, la Cour de cassation rappelle d’ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà affirmé que le juge doit vérifier si toutes les autres possibilités, telles que l’anonymat ou d’autres mesures spéciales, étaient inadaptées ou impossibles à mettre en œuvre (CEDH 27 févr. 2014, Lucic c/ Croatie, n° 5699/11, § 75).
D’autre part, les juges du fond doivent s’assurer de l’existence d’une excuse légitime de la partie civile pour justifier son absence à la confrontation sollicitée par la défense.
La principale excuse généralement alléguée par les victimes est sans aucun doute la peur. La peur de venir déposer devant un tribunal ou une cour remplie d’inconnus, la peur des représailles, la peur de ne pas être crue (N. Devouèze, Droit au procès équitable et témoin non comparant, Dalloz actualité, 7 nov. 2017) …
En l’espèce, la défense argue dans son moyen que cette peur doit toutefois être démontrée par des éléments objectifs pour être considérée comme une excuse légitime. Position suivie par la Cour de cassation qui, pour casser l’arrêt d’appel, juge que si les avocats de la partie civile ont fait état du lourd handicap de cette dernière et du traumatisme important causé par les faits pour justifier son absence lors des différents procès, aucun certificat médical ne permettait d’en attester de façon objective. La chambre criminelle reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir ordonné d’expertise de la victime pour démontrer que cette peur rendait absolument impossible la comparution de cette dernière à l’audience.
In fine l’arrêt d’espèce se rapproche de celui déjà rendu par la Cour de cassation le 1er juin 2016 dans lequel la chambre criminelle avait reproché aux juges du fond de ne pas avoir fait état de « difficultés matérielles rendant impossible l’audition » de la victime, citée comme témoin en l’espèce (Crim. 1er juin 2016, n° 15-83.059, Dalloz actualité, 15 juin 2016, obs. D. Goetz ; D. 2016. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého ![]() ; AJ pénal 2016. 545, obs. J. Lasserre Capdeville
; AJ pénal 2016. 545, obs. J. Lasserre Capdeville ![]() ). La chambre criminelle va toutefois plus loin aujourd’hui et impose dorénavant aux juges du fond, comme l’exigeait déjà la Cour européenne des droits de l’homme, de rechercher tous les moyens possibles pour assurer une confrontation entre la victime et le prévenu (CEDH 10 avr. 2012, Tseber c/ République tchèque, n° 46203/08, § 48). Seul « un obstacle insurmontable », a priori établi de façon objective, étant susceptible de dispenser la victime d’une confrontation avec son agresseur présumé.
). La chambre criminelle va toutefois plus loin aujourd’hui et impose dorénavant aux juges du fond, comme l’exigeait déjà la Cour européenne des droits de l’homme, de rechercher tous les moyens possibles pour assurer une confrontation entre la victime et le prévenu (CEDH 10 avr. 2012, Tseber c/ République tchèque, n° 46203/08, § 48). Seul « un obstacle insurmontable », a priori établi de façon objective, étant susceptible de dispenser la victime d’une confrontation avec son agresseur présumé.
À noter que, conformément à une précédente décision sur laquelle la chambre criminelle ne semble pas revenir dans cet arrêt, les déclarations de la partie civile, quand bien même une confrontation serait réalisée, ne sauraient être suffisantes pour permettre aux magistrats d’entrer en voie de condamnation « faute d’être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être soumis à la discussion des parties » et ce au nom du principe de la présomption d’innocence (Crim. 19 févr. 2002, n° 01-83.383).
Crim. 4 avr. 2024, FS-B, n° 22-80.417
© Lefebvre Dalloz