Conditions de la rectification de l’erreur matérielle par le JLD : la chasse aux faux espoirs
Le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant par là même sur les attributions que la chambre de l’instruction exerce sous le contrôle de la Cour de cassation.
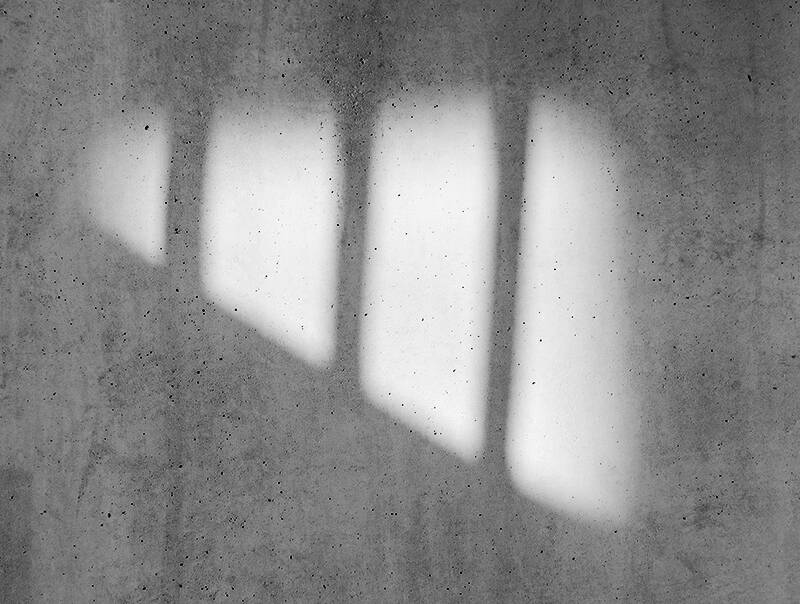
Mis en examen le 16 mai 2023 des chefs d’infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, un homme était placé en détention provisoire. Le 29 août de l’année suivante, le juge des libertés et de la détention rendait une ordonnance intitulée « ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire à l’expiration du mandat de dépôt ». Toutefois, le dispositif de cette décision ne mentionnait nullement que la remise en liberté de l’intéressé devait attendre l’expiration du mandat de dépôt.
Prenant conscience de cette incohérence, le JLD rendait, dès le lendemain, une ordonnance rectificative d’erreur matérielle précisant que la libération devrait encore attendre.
Le mis en cause saisissait alors la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle confirmait que l’incident contentieux résultant de cette difficulté autorisait le juge ayant rendu l’ordonnance initiale à lui adjoindre une ordonnance rectificative afin de l’interpréter. En tout état de cause, les juges déclaraient le débat sans objet puisqu’il leur incombait seulement, à leur sens, d’examiner le bien-fondé du refus de la prolongation. L’intéressé formait ainsi un pourvoi en cassation.
La possibilité pour le JLD de rectifier une erreur matérielle
Aux termes de l’article 710 du code de procédure pénale, la juridiction qui a prononcé une sentence peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans sa décision.
Si la lettre de ce texte restreint, à première vue, son champ d’application, il est à relever que la jurisprudence s’est engouffrée dans les notions peu définies de cet article afin d’en élargir le cadre. Partant, la procédure de rectification n’est plus seulement ouverte aux juridictions ayant prononcé une sentence pénale, mais également aux juridictions de l’instruction. C’est ainsi que la chambre criminelle a admis qu’un JLD puisse lui-même rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans ses ordonnances (Crim. 26 juin 2001, n° 01-82.923). Bien que cette décision ouvre, sans conteste, la voie à la rectification des ordonnances de placement ou de prolongation de la détention, il convient de relever qu’elle n’était pas rendue au visa de l’article 710 du code de procédure pénale – bien que largement inspirée par la procédure qu’il prévoit (v. not., C. pr. pén., art. 711) – sans doute par crainte d’interpréter de manière trop flagrante une disposition qui ne manque pourtant pas de clarté.
La jurisprudence de la chambre criminelle a subi quelques étonnantes fluctuations sur ce point, jugeant tantôt au visa de l’article 710 du code de procédure pénale que l’ordonnance de prolongation rendue par un JLD pouvait être rectifiée (Crim. 4 déc. 2002, n° 02-86.456), tantôt que cette même procédure n’était pas applicable à la rectification des ordonnances rendues par ce magistrat (Crim. 3 juin 2003, n° 03-81.482, AJ pénal 2003. 71, obs. J. C. ![]() ; JCP 2003. IV. 2367). Le fin mot de l’histoire semblait être donné en 2007, lorsque la Cour énonçait « qu’en application de l’article 710 du code de procédure pénale, les chambres de l’instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions » (Crim. 2 mai 2007, n° 06-88.306, D. 2007. 1597
; JCP 2003. IV. 2367). Le fin mot de l’histoire semblait être donné en 2007, lorsque la Cour énonçait « qu’en application de l’article 710 du code de procédure pénale, les chambres de l’instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions » (Crim. 2 mai 2007, n° 06-88.306, D. 2007. 1597 ![]() ).
).
Une part de la doctrine lit, dans ces décisions, la création prétorienne d’un régime sui generis « inspiré mais pourtant distinct de celui prévu aux articles 710 et suivants du code de procédure pénale » (J.-Cl. Proc. pén., v° Exécution des sentences pénales – Incidents contentieux, erreurs matérielles et interprétation des sentences pénales, par É. Grandchamp, fasc. 20), ce qui pourrait permettre de comprendre, postérieurement à la décision de 2007, des arrêts reconnaissant cette faculté pour le JLD sans pour autant l’adosser aux articles 710 et suivants (Crim. 23 nov. 2011, n° 11-86.675 ; 7 févr. 2012, n° 11-88.041 et n° 11-88.056). Il en est de même dans l’arrêt du 15 janvier 2025 à l’étude, si bien que l’on peut s’interroger sur l’opportunité d’une intervention législative destinée à mettre en corrélation le cadre légal avec l’interprétation que la jurisprudence en a fait, a minima dans un souci de sécurité juridique.
La latitude du JLD, restreinte aux erreurs purement matérielles
Si le JLD jouit désormais d’un pouvoir que les textes ne semblaient pas lui attribuer, notons que sa latitude demeure restreinte. Ainsi qu’on le comprend aisément, les conséquences qu’emportent une décision de justice, notamment quand elle revêt l’autorité de la chose jugée, peuvent être si lourdes que la faculté de rectification doit être rigoureusement encadrée.
Partant, le critère posé est celui de l’erreur purement matérielle. La chambre criminelle donne quelques éléments supplémentaires pour appréhender utilement cette notion en indiquant que la rectification d’une erreur purement matérielle est celle qui ne modifie ni le sens, ni la portée de la décision rectifiée.
En l’espèce, la Cour devait dire si une ordonnance ayant pour effet de différer la libération d’un justiciable écroué opérait ou non une simple rectification d’erreur purement matérielle. Si la question, posée en l’état, paraît trouver une réponse évidente, on rappellera que le titre de la première ordonnance, contrairement à son contenu et à son dispositif, mentionnait une libération ajournée à l’expiration du mandat de dépôt.
Qui du titre ou du dispositif représente le mieux l’intention du magistrat et, plus encore, quelle lisibilité offre une décision de justice qui suppose qu’on en fasse l’exégèse ?
S’agissant de cette ordonnance du JLD, la chambre criminelle a déjà pu énoncer qu’aucune obligation légale n’impose que le juge prescrive la mise en liberté immédiate de la personne dont il refuse de prolonger la détention (Crim. 7 juin 2006, n° 06-82.339, Dalloz actualité, 5 juill. 2006, obs. E. Allain ; D. 2006. 1989 ![]() ; AJ pénal 2006. 410, obs. C. Saas
; AJ pénal 2006. 410, obs. C. Saas ![]() ). Il lui est ainsi loisible de différer les effets de sa décision à l’expiration des délais prévus par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale (Crim. 8 oct. 2013, n° 13-85.098, Dalloz actualité, 29 oct. 2013, obs. F. Winckelmuller ; D. 2013. 2400
). Il lui est ainsi loisible de différer les effets de sa décision à l’expiration des délais prévus par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale (Crim. 8 oct. 2013, n° 13-85.098, Dalloz actualité, 29 oct. 2013, obs. F. Winckelmuller ; D. 2013. 2400 ![]() ; AJ pénal 2013. 681, obs. C. Girault
; AJ pénal 2013. 681, obs. C. Girault ![]() ). Toutefois, s’il ne prononce pas cette libération différée et sauf à ce que soit mise en œuvre la procédure de référé-détention de l’article 148-1-1 par le procureur de la République, celui qui est détenu provisoirement doit être immédiatement libéré. Nulle disposition n’impose du juge qu’il prononce explicitement la libération immédiate de l’intéressé : celle-ci est le principe, là où l’ajournement est l’exception.
). Toutefois, s’il ne prononce pas cette libération différée et sauf à ce que soit mise en œuvre la procédure de référé-détention de l’article 148-1-1 par le procureur de la République, celui qui est détenu provisoirement doit être immédiatement libéré. Nulle disposition n’impose du juge qu’il prononce explicitement la libération immédiate de l’intéressé : celle-ci est le principe, là où l’ajournement est l’exception.
Le dispositif de la décision de refus de prolongation rendue ici par le JLD le 29 août 2023 ne mentionnait aucun délai. Le fait que seul son titre en dispose autrement était inopérant, si bien que la rectification opérée le lendemain par le même magistrat venait corriger bien davantage qu’une erreur purement matérielle : elle avait pour effet de modifier le sens et la portée de la décision.
En 1878, dans Humain trop humain, Friedrich Nietzsche écrivait que l’espérance « est en vérité le pire des maux, parce qu’elle prolonge la torture des hommes ». Force est de constater que la chambre criminelle, par sa décision, consacre cette vérité en faisant la chasse aux faux espoirs.
Crim. 15 janv. 2025, F-B, n° 24-85.977 et n° 24-85.978
© Lefebvre Dalloz