Confiscation : champ de contestation du tiers et uniformisation de la définition de la bonne foi
Le tiers est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée. Par ailleurs, le juge qui envisage de confisquer un bien doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente, y compris dans l’hypothèse où la confiscation frappe l’instrument de l’infraction.
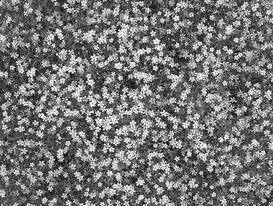
Par trois arrêts très importants rendus le 4 septembre 2024, tous publiés au Bulletin et diffusés sur internet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affiné – sur le terrain du droit pénal de fond – sa jurisprudence relative à l’intervention du tiers de bonne foi souhaitant récupérer un bien déjà confisqué (requête en incident contentieux d’exécution pour deux affaires, portant respectivement sur des immeubles et des véhicules) ou risquant de l’être (requête en restitution d’un véhicule pour l’autre).
L’absence d’intervention à l’audience pénale ne suffit pas à elle seule à justifier la restitution dans le cadre d’une requête en incident d’exécution
La chambre criminelle précise, sans surprise, qu’une requête en incident d’exécution formulée postérieurement à une confiscation, faisant valoir que la société tierce propriétaire des immeubles confisqués n’a pas été appelée à comparaître ni à intervenir ne suffit pas à entraîner la restitution à son bénéfice. La critique venant au soutien du pourvoi trouvait un fondement conventionnel (Conv. EDH, art. 6 et 13, dès lors que l’arrêt de condamnation datait de 2020, à une époque où l’alinéa de l’art. 131-21 c. pén., imposant dans la mesure du possible la participation du tiers à l’audience pénale, n’était pas encore entré en vigueur, puisque résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022).
Quels sont les arguments susceptibles d’être développés par le tiers au soutien de sa demande ?
Dans son arrêt portant sur la demande de restitution d’immeubles postcondamnation définitive (n° 23-81.981), la société propriétaire faisait notamment valoir au soutien de son pourvoi que les immeubles avaient été considérés à tort comme le produit des infractions poursuivies.
La Cour de cassation juge le grief inopérant, et affirme que le tiers « est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée ». Car « en effet, la qualification d’un bien en tant qu’objet, instrument ou produit de l’infraction au titre de laquelle la confiscation est prononcée résultant de la caractérisation par les juges du fond des éléments de l’infraction et des circonstances de sa commission, elle ne concerne que les intérêts de la personne condamnée de ce chef ».
Ainsi, seuls les critères se rattachant directement à la position du tiers (libre disposition du bien et bonne foi) sont susceptibles d’être discutés par lui.
Cette position apparaît discutable, dans la mesure où le tiers subit indirectement les effets d’une peine dont les conditions sont posées par la loi. En vertu du droit au respect des biens (dont l’atteinte doit reposer sur une base légale), ce tiers devrait pouvoir être amené à revendiquer que le bien n’est pas confiscable au sens de l’article 131-21 du code pénal et des autres textes encadrant cette peine, ce sans limitation, et sans égard au fait que la personne condamnée se soit ou non elle-même défendue sur ce terrain. On pourrait seulement et éventuellement lui opposer l’autorité de la chose jugée dans l’hypothèse où ces questions auraient été définitivement tranchées par la décision de confiscation.
Comment s’apprécie la bonne foi de la personne morale propriétaire du bien confisqué ayant servi à commettre l’infraction ?
Dans les deux affaires qui concernaient des véhicules, ces biens constituaient les instruments d’infractions routières.
Dans un premier arrêt de principe (n° 23-81.110, D. 2024. 1527 ![]() ), la chambre criminelle uniformise la notion de bonne foi de la personne morale propriétaire d’un bien aux termes d’une page entière de motivation. Elle commence par rappeler que le tiers qui sollicite la restitution sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de confiscation devenue définitive (Crim. 4 nov. 2021, n° 21-80.487), et précise qu’il est admis dans le cadre de ce recours à critiquer la libre disposition du bien par le condamné et à faire valoir sa bonne foi.
), la chambre criminelle uniformise la notion de bonne foi de la personne morale propriétaire d’un bien aux termes d’une page entière de motivation. Elle commence par rappeler que le tiers qui sollicite la restitution sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de confiscation devenue définitive (Crim. 4 nov. 2021, n° 21-80.487), et précise qu’il est admis dans le cadre de ce recours à critiquer la libre disposition du bien par le condamné et à faire valoir sa bonne foi.
La Cour de cassation fait ensuite un rappel de sa propre jurisprudence, devenue dichotomique (entre, d’un côté, l’instrument de l’infraction et, de l’autre côté, les autres hypothèses), pour l’uniformiser – nous précisons que les jurisprudences citées ci-après le sont expressément dans l’arrêt commenté.
S’agissant de la confiscation d’un bien n’appartenant pas au condamné mais dont il a seulement la libre disposition, la cour rappelle que cette peine existe depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, qui l’avait uniquement instituée pour le cas où le bien était l’instrument potentiel ou avéré de commission de l’infraction. Sous ce régime, la Cour de cassation retenait que la libre disposition s’entendait du libre usage du bien par le condamné, et que la bonne foi du propriétaire résidait dans son ignorance des faits commis par ce dernier (Crim. 15 janv. 2014, n° 13-81.874 P, Dalloz actualité, 3 févr. 2014, obs. C. Fonteix ; D. 2014. 211 ![]() ; Procédures 2014. 78, note A.-S. Chavent-Leclère).
; Procédures 2014. 78, note A.-S. Chavent-Leclère).
L’hypothèse de confiscation du bien laissé à la libre disposition du condamné s’est par la suite propagée à quasiment tous les alinéas de l’article 131-21 du code pénal : aux confiscations de patrimoine prévues aux alinéas 5 et 6 (Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012) puis à la confiscation en valeur de l’alinéa 9 (Loi n° 2013-1117 du 6 déc. 2013). La chambre criminelle se réfère aux travaux parlementaires de 2012, dont il ressort que l’objectif de l’extension était de lutter contre le recours à des prête-noms ou à des structures sociales, « pratique permettant au condamné de ne pas apparaître comme juridiquement propriétaire de biens dont il a la libre disposition et dont il est le propriétaire économique réel ».
Se fondant sur la ratio legis de la loi, et dans ces hypothèses légales, la Cour de cassation avait dès lors mis en œuvre la notion de libre disposition comme étant la propriété économique réelle du condamné sur un bien sous la fausse apparence de la propriété juridique d’un tiers (Crim. 25 nov. 2020, n° 19-86.979 P, D. 2020. 2346 ![]() ; AJ fam. 2021. 57, obs. L. Mary
; AJ fam. 2021. 57, obs. L. Mary ![]() ; AJ pénal 2021. 39, obs. M. Hy
; AJ pénal 2021. 39, obs. M. Hy ![]() ; JCP 2021. 227, note G. Beaussonie et J. Laurent ; Crim. 24 janv. 2024, n° 22-87.468). Se plaçant davantage du point de vue du propriétaire juridique, la chambre criminelle avait encore jugé en 2023 qu’il convenait d’approuver un arrêt de cour d’appel dans lequel les juges avaient exclu la bonne foi des tiers au motif que ceux-ci « savaient » que le prévenu était le propriétaire économique réel des biens confisqués (Crim. 28 juin 2023, n° 22-85.091 P, D. 2023. 1546, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, B. Joly, L. Guerrini et P. Mallard
; JCP 2021. 227, note G. Beaussonie et J. Laurent ; Crim. 24 janv. 2024, n° 22-87.468). Se plaçant davantage du point de vue du propriétaire juridique, la chambre criminelle avait encore jugé en 2023 qu’il convenait d’approuver un arrêt de cour d’appel dans lequel les juges avaient exclu la bonne foi des tiers au motif que ceux-ci « savaient » que le prévenu était le propriétaire économique réel des biens confisqués (Crim. 28 juin 2023, n° 22-85.091 P, D. 2023. 1546, chron. L. Ascensi, M. Fouquet, B. Joly, L. Guerrini et P. Mallard ![]() ; AJ pénal 2023. 410, obs. M. Hy
; AJ pénal 2023. 410, obs. M. Hy ![]() ).
).
La Cour de cassation aboutit à la conclusion qu’« il convient d’infléchir la jurisprudence en retenant que le juge qui envisage de confisquer un bien [comme instrument de l’infraction] doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente ». Elle s’en explique en considérant que, d’une part, cette position est conforme à l’article 6 de la directive européenne 2014/42/UE intitulé « confiscation des avoirs des tiers », celle-ci étant considérée comme une mesure nécessaire « dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation ». Et que d’autre part, « cette évolution permet de mettre fin à la coexistence, au sein même de l’article 131-21 du code pénal, de deux conceptions différentes de la libre disposition et de la bonne foi selon le fondement ou la modalité de la confiscation, là où le législateur n’a pas entendu introduire de distinction ». Enfin, elle relève que « le tiers, propriétaire économique réel d’un bien qu’il a mis à la disposition du condamné en connaissance de son utilisation de commission d’une infraction, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée et la confiscation dudit bien prononcée dans son patrimoine au titre de la complicité ». Ainsi, s’établit une gradation entre le tiers qui sait qu’il a prêté son identité pour n’avoir qu’une propriété apparente, et celui – responsable pénalement – qui sait en outre qu’une infraction a été commise avec le bien mis à disposition de l’auteur d’une infraction.
Application aux trois cas d’espèce
S’agissant de l’arrêt d’appel statuant postconfiscation relativement à un véhicule (n° 23-81.110), il est cassé au double motif que la cour d’appel n’a pas recherché si l’auteur du refus d’obtempérer était « le propriétaire économique réel du véhicule confisqué », la chambre criminelle précisant que l’utilisation libre d’un véhicule loué par la société qu’il dirige n’était pas suffisante, et qu’elle n’a pas recherché si la société ayant mis le véhicule en location avait connaissance de ce qu’il était le propriétaire économique réel du véhicule. Ni la libre disposition ni la mauvaise foi n’étaient ainsi suffisamment caractérisées.
Dans l’arrêt qui concernait les immeubles (n° 23-81.981), le pourvoi est rejeté dès lors que « le condamné était le propriétaire économique réel des immeubles confisqués en valeur au titre du produit de l’infraction, ce que la société ne pouvait ignorer, dès lors qu’elle était indirectement détenue par le condamné, effectivement contrôlée par lui et que ce dernier décidait seul de l’aliénation des immeubles litigieux composant son patrimoine ». Dès lors, selon la chambre criminelle, « l’absence de bonne foi de la société résulte de la seule circonstance qu’elle savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués ».
Enfin, l’arrêt d’appel ayant refusé la restitution du véhicule est confirmé (n° 23-85.217) dès lors que la cour d’appel avait bien établi que le condamné ne bénéficiait pas seulement d’un droit d’usage mais était le propriétaire économique réel du véhicule et n’en avait laissé la propriété juridique à la société dont il était le dirigeant (ses associés étant ses enfants) qu’afin de le faire échapper à la confiscation.
Crim. 4 sept. 2024, FS-B, n° 23-81.110
Crim. 4 sept. 2024, F-B, n° 23-81.981
Crim. 4 sept. 2024, F-B, n° 23-85.217
Lefebvre Dalloz