Constitutionnalité de l’absence de prestation de serment des témoins auditionnés lors d’une enquête de police
e Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité interrogeant, au regard notamment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, la différence de régime instituée entre les auditions de témoins dans le cadre d’une information judiciaire, d’une part, et dans le cadre d’une enquête de police, d’autre part. En se fondant sur l’objet de l’audition dans chacun de ces cadres, les Sages déclarent les dispositions de l’article 62, alinéa 1, du code de procédure pénale conformes à la Constitution.
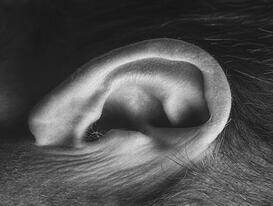
Par un arrêt du 13 mai 2025 (Crim. 13 mai 2025, n° 770), la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : « Les dispositions de l’article 62, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en ce qu’elles n’imposent pas aux témoins entendus dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance de prêter serment, contrairement aux témoins entendus sur commission rogatoire ou devant une juridiction, exposant ces derniers à des poursuites pénales dans l’hypothèse où il serait établi que leur témoignage est mensonger tandis que les premiers en seraient prémunis, sont-elles entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le principe d’égalité devant la loi ainsi que le principe de responsabilité pour faute ? ». Le requérant et les parties intervenantes faisaient d’abord valoir la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, étant donné que le cadre dans lequel intervient cette audition serait différent mais que l’objet de l’acte demeurerait identique : il s’agit d’œuvrer pour la « manifestation de la vérité ». Ils soulevaient ensuite la méconnaissance du principe de responsabilité en ce que l’absence de prestation de serment des témoins ferait obstacle aux poursuites pénales dans l’hypothèse de déclarations mensongères. Faute pour le législateur d’avoir étendu la prestation de serment à l’enquête de police, les dispositions visées seraient entachées d’incompétence négative et seraient ainsi non conformes aux exigences constitutionnelles.
Réfutant le caractère sérieux de la question portant sur la conformité au principe de la responsabilité pour faute, la chambre criminelle admettait cependant de transmettre la disposition litigieuse au Conseil constitutionnel, au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.
Une différence de régime justifiée par l’objet de l’audition
Le Conseil rappelle d’abord que le principe d’égalité devant la loi est garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 (consid. 8). Ce texte proclame que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », mais il n’empêche nullement le législateur de régir différemment des situations différentes ou de contourner le principe d’égalité au nom de l’intérêt général, à la condition que cette différence de traitement « soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Cons. const. 9 avr. 1996, n° 1996-375 DC ; 1er déc. 2023, n° 2023-1072 QPC, Dalloz actualité, 14 déc. 2023, obs. T. Scherer ; D. 2023. 2137 ![]() ). Ainsi, il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le standard du principe d’égalité devant la loi n’est pas absolu et inconditionnel, mais relatif.
). Ainsi, il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le standard du principe d’égalité devant la loi n’est pas absolu et inconditionnel, mais relatif.
Il rappelle ensuite qu’en vertu des articles 109 et 153 du code de procédure pénale, les témoins doivent prêter serment de dire « toute la vérité, rien que la vérité » lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction ou par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire. À l’inverse, les articles 62 et 78 du même code disposent que les personnes à l’égard desquelles il n’existe aucun soupçon, donc les témoins, ne prêtent pas serment lorsqu’elles sont entendues par les enquêteurs, aussi bien dans le cadre d’une enquête préliminaire que dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, la conformité de cette différence de régime est subordonnée à l’appréciation de l’objet des textes l’instituant. L’article 14 du code de procédure pénale dispose que l’enquête de police a pour objet « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ». Il en résulte qu’à cette étape de la procédure, les enquêteurs auditionnant les témoins ne cherchent qu’à rassembler des éléments de preuve afin de les soumettre à l’appréciation du procureur de la République qui décidera seul de l’engagement des poursuites. À l’inverse, lorsque le juge d’instruction a été saisi par un réquisitoire introductif, l’action publique a déjà été mise en mouvement. Le Conseil constitutionnel en déduit ainsi que « la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi » et écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité (consid. 15). « En tout état de cause », le Conseil précise qu’il revient au juge d’apprécier la force probante des éléments de preuve qui lui sont présentés, en prenant notamment en considération les conditions entourant l’audition des témoins (consid. 16). Cette précision peut toutefois sembler superfétatoire dans la mesure où l’appréciation subjective du juge est immuable et qu’elle n’éclaire pas davantage la constitutionnalité des dispositions légales marquant une nette différence de régime.
Discussion sur l’objet de l’audition
La conformité de cette différence de régime doit donc se déduire de l’objet de l’audition qui diffèrerait entre l’enquête de police et l’information judiciaire.
Au regard des dispositions légales, il apparaît en effet que le législateur a souhaité lier la prestation de serment des témoins à la mise en mouvement de l’action publique. Ainsi, le témoin auditionné dans le cadre d’une information judiciaire doit prêter serment, au même titre que le témoin qui comparaît devant la juridiction de jugement saisie par le procureur de la République, à l’issue d’une enquête de police (C. pr. pén., art. 437 s.). La différence de régime entre l’enquête et l’audience se justifie assez naturellement par l’objet de l’audition d’un témoin qui, au stade de l’enquête, consiste à apprécier la suffisance des éléments de culpabilité pour saisir la juridiction de jugement, alors qu’elle consiste, au stade de l’audience, à apprécier la suffisance des preuves pour prononcer la culpabilité.
La différence apparaît en revanche moins évidente entre l’audition d’un témoin réalisée par les enquêteurs dans le cadre d’une enquête de police et l’audition d’un témoin réalisée dans le cadre d’une information judiciaire. S’il est indéniable que l’ouverture d’une information judiciaire a pour effet le déclenchement des poursuites, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction a pour office de rechercher la vérité judiciaire et de rassembler les éléments de preuve, en vue de renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement (C. pr. pén., art. 81). Dans les deux cadres d’investigation, il est en réalité question de rassembler des éléments à charge et à décharge et donc d’œuvrer pour la manifestation de la vérité. Indépendamment du cadre, les déclarations d’un témoin sont toujours recueillies dans une même finalité qui est celle d’éclairer la vérité sur les faits objet de l’enquête ou de l’instruction.
Il est vrai qu’il y a une gradation dans la vraisemblance de culpabilité au fil de la procédure et que le déclenchement des poursuites témoigne d’une suffisance des charges de culpabilité à l’encontre de la personne mise en cause. Cependant, le témoignage recueilli par les enquêteurs lors de l’enquête de police, même indépendamment de l’ouverture d’une information judiciaire, est susceptible d’être déterminant dans l’établissement ultérieur de la culpabilité. Lorsque le témoignage à charge ou à décharge s’avère particulièrement utile à la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’il s’accompagne de peu d’éléments matériels, le témoin peut à nouveau être entendu par la juridiction de jugement ; il sera, cette fois-ci, tenu de prêter serment. Si la prestation de serment devant la juridiction s’entend du fait des poursuites engagées et de l’imminence de la déclaration de culpabilité, le témoignage, à supposer qu’il n’ait pas évolué au cours de la procédure, a la même teneur et les mêmes effets sur l’accusation de la personne mise en cause. Par conséquent, il a pu motiver le déclenchement des poursuites au stade de l’enquête de police et, en ce sens, porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie.
Les conséquences d’un témoignage réalisé en dehors de toute prestation de serment n’ont pas manqué d’être précisées par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Si le défaut de prestation de serment n’est pas légalement sanctionné, il doit l’être néanmoins par le prononcé d’une nullité lorsque le témoignage a été déterminant dans la mise en cause du mis en examen et qu’il a, de ce fait, porté atteinte à ses intérêts (Crim. 10 mai 2016, n° 15-87.713, Dalloz actualité, 25 mai 2016, obs. D. Aubert ; AJ pénal 2016. 499, obs. J. Lasserre Capdeville ![]() ; 31 mars 1981, n° 80-94.773 P ; 22 mars 1983, n° 83-90.217 P ; 2 oct. 1990, n° 90-84.412 P). Il s’agit ici de protéger les intérêts de la personne mise en cause et la prestation de serment en est l’une des garanties, car elle contraint le témoin à ne dire que la vérité sous peine de voir sa responsabilité engagée pour faux témoignage (C. pén., art. 434-13).
; 31 mars 1981, n° 80-94.773 P ; 22 mars 1983, n° 83-90.217 P ; 2 oct. 1990, n° 90-84.412 P). Il s’agit ici de protéger les intérêts de la personne mise en cause et la prestation de serment en est l’une des garanties, car elle contraint le témoin à ne dire que la vérité sous peine de voir sa responsabilité engagée pour faux témoignage (C. pén., art. 434-13).
Ainsi, si la différence de régime entre l’enquête de police et l’instruction peut se concevoir à bien des égards, l’on peut en revanche s’interroger sur le critère de l’objet de l’audition du témoin mobilisé par le Conseil pour déclarer les dispositions conformes à la Constitution.
Cons. const. 25 juill. 2025, n° 2025-1151 QPC
par Carole-Anne Vaz-Fernandez, Docteure en droit, Aix-Marseille Université, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles
© Lefebvre Dalloz