ContrûÇle juridictionnel des opûˋrations administratives rûˋalisûˋes par lãadministration fiscale : rûˋaffirmation du caractû´re restrictif de lãoffice du juge pûˋnal
La chambre criminelle rûˋaffirme le principe ancien dãindûˋpendance des procûˋdures administrative et rûˋpressive, en dûˋterminant que lãomission dãinformer le contribuable de son droit dãûˆtre assistûˋ dãun conseil et lãabsence de dûˋbat oral et contradictoire avec le vûˋrificateur sont les seuls vices affectant les opûˋrations administratives fiscales prûˋalables û lãengagement de poursuites pûˋnales susceptibles dãûˆtre contrûÇlûˋs par le juge pûˋnal.
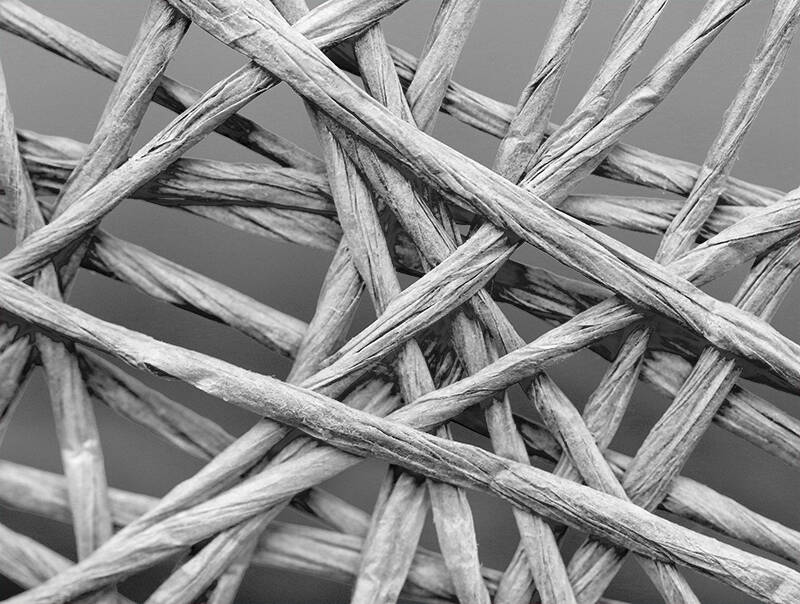
Bien que délimitées par un principe d’indépendance et ne poursuivant pas les mêmes fins, les procédures fiscale et pénale charrient fréquemment un ensemble factuel partiellement ou totalement commun, qui expose mécaniquement le contribuable/justiciable à un risque de contrariété de jugement. L’élaboration progressive d’un droit pénal fiscal a donc conduit le Conseil d’État comme la Cour de cassation à devoir délimiter les contours de l’office du juge de l’impôt comme du juge répressif. La succession ou la superposition des procédures fiscale et pénale suppose notamment que soit clairement défini le juge compétent pour contrôler la régularité procédurale des opérations administratives conduites par l’administration fiscale avant l’engagement de poursuites pénales, et les conséquences d’éventuelles irrégularités constatées sur la procédure pénale.
Dans quelle mesure le juge pénal peut-il examiner la régularité des opérations administratives menées par l’administration fiscale avant l’engagement des poursuites et quels sont les vices susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure judiciaire ? L’arrêt commenté, publié au Bulletin, apporte des réponses à ces questions en réaffirmant une solution ancienne qui cantonne les débats judiciaires aux questions du droit du contribuable d’être informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil et de disposer d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
En l’espèce, une société exerçant une activité de brasserie/restauration et évènementiel a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les trois exercices clos de 2012 à 2014, à la suite d’un contrôle inopiné réalisé le 2 avril 2015. En 2017, à l’issue de ses diligences, la direction départementale des finances publiques territorialement compétente a déposé plainte à l’encontre de la société et de son gérant associé unique.
Le gérant personne physique a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d’omission d’écritures dans un document comptable et de fraude fiscale. De manière assez surprenante, la décision ne mentionne pas le sort qui a été réservé à la société elle-même, la plainte ayant pourtant pour objet la régularité fiscale de son activité.
Devant le tribunal correctionnel, le gérant a fait valoir plusieurs exceptions de nullité, fondées notamment sur :
- l’imprécision de la citation devant le tribunal correctionnel dont il avait fait l’objet ;
- un défaut d’information suffisante quant aux éléments permettant de connaître la nature des traitements informatiques envisagés par l’administration fiscale au stade des opérations de contrôle préalables à la procédure pénale, en violation des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la privation du droit d’option prévu par l’article L. 47 A, II, du livre des procédures fiscales : pour rappel, ces dispositions prévoient, dans le cadre d’une vérification de comptabilité portant sur une comptabilité tenue par un moyen informatisé, l’obligation pour les agents de l’administration fiscale d’indiquer par écrit la nature des traitements informatiques souhaités, et un droit d’option au bénéfice du contribuable entre plusieurs modalités de contrôle ;
- l’inobservation des prescriptions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en lien avec l’obligation d’instaurer un débat contradictoire préalable à toute décision administrative individuelle défavorable ;
- l’irrégularité de la conservation des données par l’administration fiscale.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel a fait droit à la nullité soulevée par le prévenu sur le second fondement mentionné. La juridiction a par conséquent prononcé la nullité de la plainte de l’administration fiscale et la nullité de l’ensemble de la procédure pénale, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir.
Saisie des appels interjetés par le ministère public et l’administration fiscale, partie civile, la Cour d’appel de Grenoble a condamné le gérant à six mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale.
Pour écarter les nullités soulevées, la cour d’appel a tout d’abord jugé un certain nombre d’entre elles irrecevables et a écarté l’exception qui avait conduit à l’annulation de la procédure en première instance, au motif que « les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire tiennent à la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ».
Rejetant le pourvoi formé par le gérant, la chambre criminelle a confirmé la restriction de l’office du juge judiciaire s’agissant du contrôle des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale préalablement à l’engagement des poursuites. Elle a en effet considéré que « l’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil et l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire.
Il en résulte que le respect des prescriptions des articles L. 47 A du livre des procédures fiscales et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’entre pas dans le champ de contrôle restreint exercé par le juge pénal ».
La Haute juridiction a néanmoins rappelé quelques règles applicables au régime de présentation des nullités devant le juge pénal, qui ne sont pas l’objet du présent commentaire.
Cet arrêt permet d’évoquer, à l’aune du principe d’indépendance des procédures administrative et répressive réaffirmé par la chambre criminelle, les contours de l’office du juge pénal en matière de contrôle des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale.
Rappels préalables sur le principe d’indépendance des procédures administrative et répressive
Les diligences réalisées par l’administration fiscale à l’occasion de vérifications de comptabilité ou d’enquêtes fiscales peuvent permettre de découvrir des faits susceptibles de faire l’objet d’une procédure administrative et, parallèlement, d’une procédure pénale déclenchée selon les modalités prévues par l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Cette coexistence est avant tout permise par les finalités distinctes de ces procédures. Dans le premier cas, le juge administratif a la charge de faire respecter les règles applicables pour assurer la correcte détermination et le recouvrement effectif de l’impôt. Dans le second cas, le juge pénal a pour mission de constater si la personne poursuivie s’est rendue coupable d’un délit et, le cas échéant, de le réprimer à juste proportion.
Il est néanmoins très fréquent que les faits objet de la saisine du juge pénal aient été constatés et rapportés par les agents de l’administration fiscale grâce à l’exercice des pouvoirs de contrôle et d’enquête qui leurs sont dévolus. Il n’est donc pas inepte d’envisager que le juge pénal, dans le cadre de son office, puisse contrôler la régularité des diligences réalisées par ces agents aux termes des textes qui leurs sont applicables, comme il a la charge de le faire lorsque les éléments de preuve soumis à son appréciation sont le fruit d’un travail de police judiciaire.
Le principe d’indépendance et d’autonomie des procédures administrative et répressive fait toutefois, depuis longue date, obstacle à un tel raisonnement. Souvent saisie d’exceptions de nullité tenant à la méconnaissance des règles applicables aux diligences conduites par les agents de l’administration, la chambre criminelle n’a jamais autorisé un contrôle étendu du juge pénal. Par principe, un contribuable/justiciable ne peut se prévaloir devant le juge répressif des irrégularités commises par l’administration (pour une solution ancienne sur ce point, Crim. 6 juin 1977, n° 76-92.108 ; ou encore, Crim. 1er oct. 1984, n° 83-94.693).
Une première brèche a cependant été ouverte par la chambre criminelle en 1978 dans le célèbre arrêt Venutolo, puisqu’elle a reconnu la possibilité pour le contribuable de se prévaloir de la violation de l’article 1649 septies du code général des impôts, transféré à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, prescrivant l’obligation pour l’administration d’informer le contribuable, dans l’avis de vérification, de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix (Crim. 4 déc. 1978, n° 77-93.42 ; v. égal., Crim. 1er oct. 1984, n° 83-94.693, préc.).
En 1992, la Haute juridiction a également reconnu la possibilité pour le contribuable de se prévaloir de l’absence de débat contradictoire et oral au cours du contrôle, une telle violation entraînant la nullité de la procédure administrative comme de la procédure pénale subséquente (Crim. 23 nov. 1992, n° 90-86.657, RSC 1993. 788, obs. G. Giudicelli-Delage ![]() ).
).
Ces deux irrégularités sont depuis lors perçues par les juges du quai de l’Horloge comme les seules susceptibles d’entraîner une atteinte aux droits de la défense et, par conséquent, d’être intégrées à l’office de contrôle du juge pénal.
Ne sont, par exemple, pas reconnues comme des irrégularités susceptibles de justifier l’annulation de la procédure judiciaire : l’atteinte au secret professionnel commise par des agents de l’administration (Crim. 25 janv. 2017, n° 16-90.028) ; le non-respect des règles encadrant la compétence des agents de l’administration (Crim. 4 juin 1998, n° 97-80.620, RTD com. 1999. 522, obs. B. Bouloc ![]() ) ; l’absence de versement de l’avis de mise en recouvrement au dossier pénal dans le cadre d’une dénonciation automatique fondée sur l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (Crim. 13 sept. 2023, n° 22-82.288, Dalloz actualité, 6 oct. 2023, obs. N. Monnerie ; AJ pénal 2023. 467 et les obs.
) ; l’absence de versement de l’avis de mise en recouvrement au dossier pénal dans le cadre d’une dénonciation automatique fondée sur l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (Crim. 13 sept. 2023, n° 22-82.288, Dalloz actualité, 6 oct. 2023, obs. N. Monnerie ; AJ pénal 2023. 467 et les obs. ![]() ; v. sur ce point, le commentaire paru dans la chronique de A. Rousseau et G. Pellegrin, Droit pénal fiscal – Chronique de droit pénal fiscal, RD fisc. 14 déc. 2023, n° 50) ; l’absence de communication de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, garantie également exigée par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales (Crim. 19 janv. 2000, n° 98-87.886).
; v. sur ce point, le commentaire paru dans la chronique de A. Rousseau et G. Pellegrin, Droit pénal fiscal – Chronique de droit pénal fiscal, RD fisc. 14 déc. 2023, n° 50) ; l’absence de communication de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, garantie également exigée par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales (Crim. 19 janv. 2000, n° 98-87.886).
Enfin, il convient de préciser que le dirigeant de fait d’une société, quant à lui, ne peut se prévaloir de l’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil et de l’absence de débat oral et contradictoire (Crim. 6 oct. 2010, n° 09-87.879). Sur ce dernier point, l’explication est peut-être chronologique dès lors qu’il apparaît nécessaire que la qualité de dirigeant de fait soit reconnue par le juge pénal pour que celui-ci soit effectivement reconnu redevable de l’impôt.
Réaffirmation d’une conception restrictive du contrôle du juge pénal sur la régularité des opérations administratives conduites par l’administration fiscale avant l’engagement des poursuites
L’arrêt commenté constitue une nouvelle réaffirmation de ces principes puisque, à nouveau saisie de l’examen de moyens de nullités fondées sur de potentielles irrégularités commises dans le cadre des opérations administratives menées par les agents de l’administration fiscale, la chambre criminelle affirme que « l’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil et l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire. Il en résulte que le respect des prescriptions des articles L. 47 A du livre des procédures fiscales et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’entre pas dans le champ de contrôle restreint exercé par le juge pénal ».
Ce faisant, la chambre criminelle adopte une position plus restrictive que celle de la Cour d’appel de Grenoble qui s’était contentée d’indiquer que « les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire tiennent à la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales », n’excluant pas de fait, dans sa formulation, la prise en compte d’éventuelles irrégularités en lien avec la transmission de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévue par le même article.
La solution adoptée par la chambre criminelle perpétue donc une jurisprudence bien établie, qui laisse au juge administratif l’entière responsabilité du contrôle juridictionnel de la régularité des opérations diligentées par l’administration fiscale avant l’engagement de poursuites pénales.
Cette conception rigoriste du principe d’indépendance des procédures administrative et répressive nous semble néanmoins soulever de sérieuses difficultés, au préjudice du justiciable prévenu d’infractions fiscales devant les juridictions pénales.
Sous l’angle du droit au recours effectif d’abord, puisque ledit principe pourra être opposé par le juge pénal au justiciable pour rejeter une demande de sursis à statuer ayant pour objet de permettre l’exercice d’un recours à l’encontre d’une mesure d’enquête fiscale devant le juge administratif. Une telle situation priverait le justiciable de tout recours effectif dans le cadre de la procédure pénale pour contester la régularité d’actes et d’éléments de preuve qui pourront être retenus à charge. Situation qui, du reste, ne pourra pas être rééquilibrée par une éventuelle révision de la condamnation pénale a posteriori, la décision du juge administratif n’étant pas considérée comme un « fait nouveau » susceptible de conduire à l’application de l’article 622 du code de procédure pénale et, ainsi, de « faire échec à une condamnation définitive prononcée par le juge répressif sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts » (Crim. 4 juin 1970, n° 69-93.414).
Sous l’angle de la protection de l’office du juge judiciaire ensuite, puisque à l’issue d’une enquête préliminaire, dans de telles conditions, la régularité d’éléments de preuves centraux figurant au dossier pénal n’aura, à aucun stade de la procédure pénale diligentée, pu être examiné par un juge judiciaire.
Eu égard aux potentielles violations de droits des personnes vérifiées au cours des opérations administratives conduites antérieurement à l’ouverture de toute procédure pénale, qui doivent à notre sens s’analyser comme le germe des droits de la défense qui se matérialiseront au cours de la procédures pénale subséquente, la chambre criminelle a peut-être manqué une occasion d’adopter une position plus protectrice de ces derniers.
Cette conception rigoriste et singulière du principe d’indépendance nous semble opérer au détriment des droits de la défense et, par conséquent, d’une bonne administration de la justice. Cette position pourrait interroger jusqu’à la nature de la matière pénale puisqu’elle démarque également le droit français de nombre de juridictions étrangères dans lesquelles la matière répressive est envisagée comme une branche du droit public.
Crim. 15 janv. 2025, FS-B, n° 22-85.638
© Lefebvre Dalloz