Crédit affecté et créance de restitution de la banque : quand l’équivalence des conditions s’en mêle
Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024, la première chambre civile opère une précision de sa jurisprudence de droit de la consommation sur la conséquence de l’annulation d’un crédit affecté consécutive à celle du contrat principal quand le vendeur est placé dans une situation d’insolvabilité.
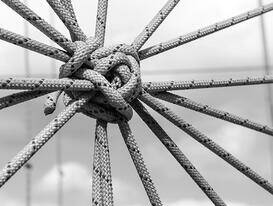
Le contentieux des crédits affectés fait partie des questions habituelles présentées devant les juges du fond en matière de droit de la consommation. C’est donc sans grande surprise que la première chambre civile rend régulièrement, d’années en années, des arrêts publiés au Bulletin sur ces thématiques.
Le 10 juillet 2024, trois décisions explorant la trame de fond des installations photovoltaïques financées par des crédits affectés ont été mises à disposition sur le site internet de la Cour de cassation. Un premier arrêt a pu préciser les contours de la faute commise par la banque débloquant les fonds sans un contrôle précis de l’attestation de livraison (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-12.122, à paraître au Dalloz actualité ; D. 2024. 1326 ![]() ) tandis que le deuxième a rappelé l’importance du lien causal entre ladite faute et le préjudice subi par l’emprunteur qui souhaite échapper à la restitution du capital prêté (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-11.751, à paraître également au Dalloz actualité ; D. 2024. 1326
) tandis que le deuxième a rappelé l’importance du lien causal entre ladite faute et le préjudice subi par l’emprunteur qui souhaite échapper à la restitution du capital prêté (Civ. 1re, 10 juill. 2024, n° 23-11.751, à paraître également au Dalloz actualité ; D. 2024. 1326 ![]() ). Le troisième arrêt rendu le 10 juillet tranche une interrogation délicate ayant suscité une certaine division des ressorts saisis.
). Le troisième arrêt rendu le 10 juillet tranche une interrogation délicate ayant suscité une certaine division des ressorts saisis.
C’est l’affaire sur laquelle notre attention se portera aujourd’hui. Rédigé dans une motivation (très) enrichie, cet arrêt tranche donc une véritable problématique d’interprétation des juges du fond. Ces derniers étaient, en effet, fort divisés sur la question de l’autonomie d’un préjudice subi concernant l’impossibilité pour l’emprunteur de récupérer le prix de l’installation qu’il a pu acheter quand le vendeur est en liquidation judiciaire.
Reprenons les faits pour comprendre le nœud du problème. Le 25 juin 2024, un contrat hors établissement est conclu entre un consommateur et une société professionnelle pour la fourniture et la mise en place de plusieurs installations photovoltaïques (des panneaux solaires et un ballon thermodynamique). Afin de financer l’opération, le consommateur souscrit un crédit le 16 juillet 2014 auprès d’une banque. Estimant que le bon de commande comporte plusieurs irrégularités, l’emprunteur assigne le vendeur ainsi que la banque afin d’obtenir l’annulation du contrat principal et de celui ayant permis son financement. Le consommateur souhaite également obtenir la restitution des sommes versées en remboursement du contrat de crédit. Peu de temps plus tard, le 17 décembre 2015, le vendeur est placé en liquidation judiciaire.
En cause d’appel, la banque est condamnée à régler à l’emprunteur, à titre de dommages et intérêts, une certaine somme qui équivaut au capital emprunté. L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en estimant que le consommateur n’a pas subi de préjudice particulier, l’insolvabilité du vendeur de l’installation photovoltaïque n’étant pas, selon lui, un préjudice ayant un lien causal avec la faute commise par ses services dans la libération des fonds.
L’arrêt du 10 juillet 2024 aboutit à un rejet du pourvoi en venant apporter une orientation encore inédite en droit positif. La première chambre civile de la Cour de cassation précise, en effet, qu’« il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal » (pt n° 19).
Nous allons examiner pourquoi une telle solution est importante pour les praticiens du droit de la consommation.
Une unification attendue
Notons, à titre préliminaire, la forme tout à fait remarquable de la décision que nous étudions aujourd’hui. La motivation y est très développée avec notamment le recours à la technique rare de la citation des décisions rendues par les cours d’appel (pour d’autres ex., v. not., Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 21-50.042, Dalloz actualité, 7 oct. 2022, obs. E. Supiot ; D. 2022. 2134 ![]() , note M. Barba et G. Millerioux
, note M. Barba et G. Millerioux ![]() ; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot ![]() ; ibid. 807, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 807, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; AJ fam. 2023. 223
; AJ fam. 2023. 223 ![]() ; Rev. crit. DIP 2023. 227, note S. Chaillé de Néré
; Rev. crit. DIP 2023. 227, note S. Chaillé de Néré ![]() ; RTD civ. 2022. 877, obs. A.-M. Leroyer
; RTD civ. 2022. 877, obs. A.-M. Leroyer ![]() ; ibid. 2023. 63, obs. P. Deumier
; ibid. 2023. 63, obs. P. Deumier ![]() ; 24 janv. 2024, n° 22-16.115 FS-B, Dalloz actualité, 29 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 665
; 24 janv. 2024, n° 22-16.115 FS-B, Dalloz actualité, 29 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 665 ![]() , note M. Zaffagnini
, note M. Zaffagnini ![]() ; ibid. 500, chron. E. Buat-Ménard, C. de Cabarrus, A. Daniel, A. Feydeau-Thieffry et S. Robin-Raschel
; ibid. 500, chron. E. Buat-Ménard, C. de Cabarrus, A. Daniel, A. Feydeau-Thieffry et S. Robin-Raschel ![]() ; RTD civ. 2024. 387, obs. H. Barbier
; RTD civ. 2024. 387, obs. H. Barbier ![]() ).
).
La première chambre civile commence, dans cette optique, par recontextualiser la difficulté (pts nos 6 à 9). Quand un contrat de crédit affecté est annulé, l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital prêté. Il n’y a ici guère que l’application de la théorie générale du contrat. Or, le consommateur n’a bien souvent pas encaissé la somme litigieuse puisque celle-ci a été versée directement au vendeur. Pour éviter que l’emprunteur rembourse tout ou partie du capital prêté dans une situation où la banque a commis une faute lors de la libération des fonds, la jurisprudence a alors progressivement retenu un système fondé sur le droit de la responsabilité civile. Le consommateur ne peut être déchargé de son obligation de remboursement que si la banque a commis une faute et que celle-ci provoque un préjudice en « lien causal » à l’emprunteur. Ces éléments de base sont au cœur des deux autres arrêts rendus le 10 juillet 2024 (Civ. 1re, 10 juill. 2024, nos 23-12.122 et 23-11.751, préc.).
On observe dans l’arrêt étudié aujourd’hui une référence discrète mais utile à la doctrine laquelle « s’est montrée favorable à cette évolution en relevant qu’une faute ne pouvait être sanctionnée qu’en cas de preuve d’un préjudice en résultant et qu’une telle approche permettait l’adoption de solutions équilibrées entre les intérêts en présence » (pt n° 13, nous soulignons). L’usage des références aux commentaires doctrinaux est rare mais en développement ces derniers mois comme en témoigne le guide de rédaction la motivation enrichie des arrêts de la Cour de cassation (spéc. p. 26 ; v. pour un ex. commenté dans ces colonnes, Com. 15 mars 2023, n° 21-20.399 FB, spéc. pt n° 11, Dalloz actualité, 21 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 985 ![]() , note S. Tisseyre
, note S. Tisseyre ![]() ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ![]() ; Rev. sociétés 2023. 517, note G. Pillet
; Rev. sociétés 2023. 517, note G. Pillet ![]() ; Rev. prat. rec. 2023. 19, chron. O. Salati
; Rev. prat. rec. 2023. 19, chron. O. Salati ![]() ; RTD civ. 2023. 345, obs. H. Barbier
; RTD civ. 2023. 345, obs. H. Barbier ![]() ). Il faut toutefois admettre qu’ici la référence à la doctrine ne permet finalement que d’asseoir la jurisprudence désormais constante sans servir un dessein plus important. L’argument n’est donc que peu déterminant car la difficulté propre du pourvoi est ailleurs.
). Il faut toutefois admettre qu’ici la référence à la doctrine ne permet finalement que d’asseoir la jurisprudence désormais constante sans servir un dessein plus important. L’argument n’est donc que peu déterminant car la difficulté propre du pourvoi est ailleurs.
Ce n’est finalement qu’assez tard dans la décision qu’apparaît le cœur du problème (pt n° 14). La véritable clef de voûte de l’arrêt du 10 juillet 2024 repose sur la division des différents ressorts saisis concernant l’impossibilité pour l’emprunteur de pouvoir récupérer le prix de l’installation en raison de l’insolvabilité du vendeur, notamment si celui-ci est sous le joug d’une liquidation judiciaire. Faut-il voir dans une telle impossibilité un préjudice autonome lié causalement à la faute de la banque ayant libéré les fonds de manière précoce sans vérifier le contrat principal ? La question pose réellement difficulté car la causalité est, en effet, assez éloignée. Ce n’est pas parce que la banque a libéré les fonds de manière contraire aux textes du code de la consommation que ce préjudice précis subi par le consommateur existe. Mais, en tout état de cause, la question ne se serait pas posée si la banque avait respecté ses obligations. En somme, aucune réponse claire ne s’impose.
La première chambre civile livre ainsi un travail précis de comparaison entre les ressorts en interrogeant les décisions rendues à ce jour :
- les Cours d’appel d’Aix-en-Provence, de Bordeaux, de Grenoble, de Paris, d’Amiens et de Dijon jugent ainsi qu’un tel préjudice est caractérisé en pareille situation ;
- les Cours d’appel de Toulouse, de Caen, de Nancy, de Colmar, de Metz et de Reims jugent au contraire qu’une telle impossibilité ne permet pas de caractériser un préjudice autonome puisque la faute de la banque n’est « pas en lien causal avec la liquidation judiciaire » du vendeur (pt n° 14).
Il nous paraît assez peu risqué d’écrire que la recherche jurisprudentielle à laquelle s’est livrée la première chambre civile est particulièrement exhaustive. Les autres arrêts référencés en accès libre sur les différentes bases de données ne font pas apparaître de décisions pouvant compléter la liste établie sans créer de doublons, du moins à notre connaissance. S’il faut louer un tel effort d’analyse, nous reprendrons nos observations déjà opérées dans d’autres commentaires de décisions utilisant la technique de la citation des arrêts d’appel (Dalloz actualité, 21 mars 2023, obs. C. Hélaine, préc.). Cet outil dans l’arsenal de la motivation enrichie vient alourdir de manière assez importante la rédaction de la décision justice.
Mais ce désavantage est balancé bien rapidement par un élément important qui est la mise en valeur évidente et très efficace d’une véritable difficulté d’interprétation qui appelait un arrêt de la Cour de cassation y mettant fin.
C’est ce que nous allons voir maintenant.
L’équivalence des conditions, une solution à nuancer
La première chambre civile commence par poser une règle simple formulée ainsi : « Si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire » (pt n° 16, nous soulignons). Ce faisant, elle érige la situation de l’insolvabilité du vendeur principal résultant de sa liquidation judiciaire comme un cas particulier. L’arrêt du 10 juillet 2024 conclut qu’en vertu du principe d’équivalence des conditions, c’est la faute de la banque qui n’a pas correctement examiné le contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques qui a conduit in fine à l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir sa créance de restitution du prix (pt n° 18).
Un tel énoncé pourra surprendre eu égard à l’importance de la théorie de la causalité adéquate en droit positif (v. les développements suivants à ce sujet, F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1214, n° 1091). Soyons, à ce titre, prudents sur les expressions choisies par la première chambre civile. Si la faute de la banque a bien causé divers préjudices à l’emprunteur, il n’a certainement pas impliqué que le vendeur se retrouve en situation de cessation des paiements. L’arrêt du 10 juillet 2024 ne vient pas énoncer le contraire. Il ne fait que de lier l’impossibilité pour le vendeur d’obtenir sa créance de prix à la faute initiale de la banque dans sa libération des fonds. L’admission d’une telle causalité éloignée peut toutefois laisser songeur sur les enjeux d’une telle solution. N’est-ce pas là pousser dans ses extrêmes limites le principe d’équivalence des conditions ?
La première chambre civile fait donc triompher une conception souple du lien de causalité au détriment d’une causalité adéquate pour permettre à l’emprunteur de ne pas se retrouver dans une situation où il ne peut concrètement pas retrouver la somme empruntée. Le vendeur étant placé en liquidation judiciaire, le consommateur se retrouverait sinon dans une situation de blocage où l’espoir d’être réglé dans la procédure collective relève bien souvent plus de l’onirique que de la réalité. Mais, en tout état de cause, il est très délicat de voir un lien de causalité entre l’absence de vérification par la banque du contrat principal d’une part et l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir sa créance de restitution du prix en raison de l’insolvabilité du vendeur d’autre part.
La décision vient, en outre, créer une situation assez paradoxale où la Cour de cassation évoque spécifiquement la liquidation judiciaire (pt n° 16) avant de citer plus généralement l’insolvabilité du vendeur (pt n° 19). N’aurait-il pas fallu parler d’insolvabilité dès le début du raisonnement (au pt n° 16, donc) pour éviter toute hésitation sur la portée exacte de la décision ? La question peut, là-encore, se discuter.
Voici donc une décision assurément importante en droit de la consommation. Elle vient régler une difficulté d’interprétation n’ayant pas abouti à une position unanime des ressorts saisis de la question. Dans un contentieux aussi important que celui des conséquences de l’annulation d’un crédit affecté, un tel alignement est louable même si l’orientation choisie fera couler de l’encre en doctrine.
Civ. 1re, 10 juill. 2024, FS-B, n° 22-24.754
© Lefebvre Dalloz