Criminalité environnementale et nouvelle directive UE : vers une nouvelle politique pénale européenne ?
Annoncé dès le 15 décembre 2021 dans le cadre plus global du Pacte vert pour l’Europe, le projet de directive visant à lutter contre la criminalité environnementale et remplaçant la directive 2008/99/CE est en voie de trouver une issue favorable. En effet, le 16 novembre 2023, le Parlement et le Conseil ont annoncé avoir conclu un accord provisoire sur la base de la dernière version du texte.
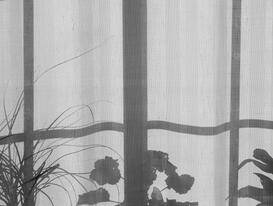
Le passé récent : l’injonction internationale de d’avantage pénaliser les atteintes à l’environnement
Avant toute chose, il convient de rappeler que le renforcement de la pénalisation des atteintes à l’environnement par l’Union européenne s’inscrit d’abord dans un contexte international. En effet, alors que cette forme de criminalité est devenue la troisième sur le plan mondial en termes de profit, et qu’elle est souvent liée à d’autres formes de criminalité comme la corruption et le blanchiment, de multiples initiatives encourageant une réponse adaptée des États ont fleuri ces dernières années.
La France a ainsi porté en décembre 2019, une résolution « Prévenir et combattre la corruption liée aux crimes qui ont une incidence sur l’environnement » à l’occasion de la 8e conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption. Moins d’un an après, le 16 octobre 2020, une résolution des Nations unies a incité les États membres de la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée à enquêter sur le blanchiment du crime organisé transnational affectant l’environnement, tandis que la Déclaration de Kyoto du 12 mars 2021 invite les États à « lutter contre la criminalité transnationale organisée, la corruption et le blanchiment d’argent liés à ces formes de criminalité, ainsi que contre les flux financiers illicites qui en découlent ». Enfin, une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 2021, a rappelé « le rôle central que jouent les États dans la prévention de la corruption en rapport avec de tels crimes [environnementaux] et dans la lutte contre ce phénomène ».
Par ailleurs, le mouvement de pénalisation renforcée a également été largement suivi en France, comme en témoigne la loi dite « résilience » de 2021, ayant créé de nouvelles infractions et aggravé d’autres, alors qu’un nouveau « contentieux climatique » s’est considérablement développé devant les juridictions administratives et judiciaires françaises.
En France encore, la politique pénale n’est pas en reste, une circulaire du 9 octobre 2023 rappelant aux procureurs l’importance d’une réponse pénale « ferme et adaptée » en matière d’atteintes à l’environnement, en encourageant notamment la conclusion de conventions judiciaires d’intérêt public environnementales.
Le présent à venir : vers un nouveau droit pénal européen de l’environnement
Faisant déjà le constat de la « progression des infractions au détriment de l’environnement et par leurs effets, qui s’étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises », la directive 2008/99/CE a fixé un certain nombre d’infractions minimales d’atteintes à l’environnement.
En réponse à une évaluation en 2020 de cette directive, constatant une certaine inefficacité de cette dernière (peu de procédures engagées, sanctions faibles, coopération internationale résiduelle), et face à l’accroissement de cette forme de criminalité, le projet de directive tel que présenté il y a presque deux ans par la Commission a voulu apporter des avancées majeures par rapport au texte de 2008 :
- clarification des définitions existantes et définition de nouveaux délits environnementaux (18 au total) comme le commerce illicite de bois, le recyclage illégal des navires, et le captage illégal de l’eau (art. 2 à 4) ;
- fixation d’un niveau minimal pour les peines applicables aux personnes physiques, et liste de sanctions complémentaires comme les mesures de remise en état et l’exclusion des marchés publics, ou l’exclusion de financements publics (art. 5) ;
- responsabilité (pénale ou non pénale) des personnes morales quand les infractions ont été commises pour leur compte, y compris en cas de défaut de surveillance ou de contrôle ayant rendu possible la commission de l’infraction (art. 6) ;
- prise en compte du chiffre d’affaires mondial de la personne morale pour déterminer le montant de l’amende (art. 7) ;
- circonstances aggravantes notamment en cas de destruction ou de dommages substantiels irréversibles ou durables à un écosystème (art. 8) ;
- encouragement du signalement d’infractions environnementales, par la protection des lanceurs d’alerte et autres personnes qui communiquent des informations ou fournissent des preuves dans le cadre d’une enquête relative à des infractions pénales liées à l’environnement (art. 13) ;
- renforcement de l’efficacité de la répression, à travers des actions de coordination et de coopération pénale internationale (en lien également avec Eurojust, Europol, l’OLAF et le parquet européen), de formation des enquêteurs et magistrats (art. 16 à 19) ;
- collecte de données statistiques et élaboration de stratégies nationales (art. 20 et 21).
L’accord obtenu le 16 novembre 2023 entre le Parlement et le Conseil modifie la proposition initiale de la Commission sur plusieurs points et notamment :
- élargissement des comportements considérés comme illicites, et peines encourues plus sévères pour les personnes physiques (gradation des peines de 3 à 10 ans d’emprisonnement selon la gravité des faits) comme les personnes morales (pour les infractions les plus graves, une amende maximale d’au moins 5 % du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale ou, à défaut, de 40 M€ ; pour toutes les autres infractions, une amende maximale d’au moins 3 % du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale ou, à défaut, de 24 M€) ;
- les infractions prévues dans la directive sont qualifiées d’« atteintes graves à l’environnement » (et plus sévèrement punies) si elles causent des destructions ou dommages étendus et substantiels irréversibles ou durables, conduisant à des conséquences environnementales majeures.
Le futur désirable : vers une nouvelle répression européenne des atteintes à l’environnement
L’accord politique devrait être formellement validé par le Parlement et le Conseil début 2024, et la directive formellement adoptée devra ensuite être transposée par les États membres.
Cette nouvelle directive remet particulièrement en lumière la dimension européenne de la répression pénale des atteintes à l’environnement, et l’intérêt d’une éventuelle extension du champ de compétence du parquet européen en matière d’atteintes graves à l’environnement.
Un rapport récent d’un groupe de travail réuni sous l’égide du parquet général de la Cour de cassation sur le droit pénal de l’environnement a ainsi rappelé qu’une politique cohérente ne consiste pas seulement à davantage à pénaliser, mais également à organiser plus efficacement l’organisation judiciaire en la matière – l’extension du champ de compétence du parquet européen à la criminalité environnementale étant l’une des recommandations émises en ce sens.
Tout d’abord, une telle extension de la compétence matérielle du parquet européen serait plus que légitime en raison de sa mission de protection des intérêts financiers de l’Union, laquelle consacre actuellement 30 % de son budget à la protection de l’environnement et du climat (pour un montant total de 356 Md€ sur la période 2021-2027), ainsi que 37 % du montant total du plan de relance (soit plus de 275 Md€), notamment par le versement de subventions.
Ce parquet supranational est, en outre, particulièrement efficace dans la coordination des enquêtes dans les dossiers multilatéraux qu’il a les moyens de traiter « en interne », si l’on peut dire. Sans compter sa capacité à définir une véritable politique pénale au niveau européen dans les domaines relevant de sa compétence.
Mais surtout, transférer au parquet européen le pouvoir de poursuivre les infractions environnementales les plus graves marquerait la volonté des États membres de s’engager tous ensemble, et de manière résolue, dans une politique commune de défense de l’environnement. La réponse judiciaire dans ce domaine est inscrite aujourd’hui encore dans un cadre de coopération intergouvernementale qui trouve immédiatement ses limites lorsqu’elle vient se heurter à des intérêts économiques majeurs. Le dossier de la fraude aux moteurs diesel de la marque Volkswagen est une illustration parfaite des difficultés rencontrées par les autorités judiciaires des États membres qui étaient concernés par cette fraude massive, alors même que l’agence Eurojust en était saisie.
Le seul moyen de surmonter les obstacles à la coopération dans ce type de dossiers est de transférer cette compétence au parquet européen qui aura les moyens d’agir en toute indépendance et hors de toute influence nationale. Cette extension de compétence n’est pas un simple aménagement technique, c’est un véritable transfert de souveraineté qui devra être approuvé à l’unanimité par le Conseil européen. Comme tout ce qui touche à la justice en Europe, la création d’un « parquet vert européen » sera une question éminemment politique. Et sans doute faudra-t-il avancer par étapes pour la rendre acceptable au niveau des États membres en limitant cette extension dans un premier temps à la lutte contre la criminalité organisée environnementale.
Mieux protéger l’environnement passe par une action renforcée des États à travers la mise en œuvre à venir de la future directive, mais sans doute également, par une action au niveau de l’Union elle-même. Ce qui est vrai pour les annonces récentes en matière de corruption, l’est également pour le droit pénal de l’environnement.
© Lefebvre Dalloz