Dignité en détention : la validité des mesures équivalentes aux injonctions ordonnées en référé
De manière inédite, le Conseil d'État juge que l'exécution des injonctions ordonnées par le juge des référés peut être regardée comme acquise, dès lors que l'administration pénitentiaire a adopté des mesures alternatives et au moins équivalentes aux mesures prononcées.
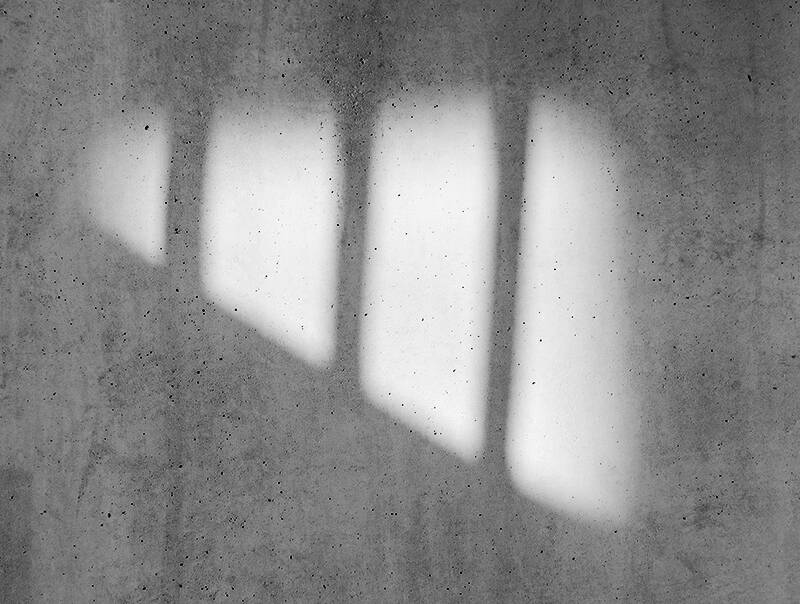
Les établissements pénitentiaires ultramarins sont notoirement réputés pour leurs conditions de détention indignes, leur surpopulation et leur vétusté (v. CNCDH, La question pénitentiaire dans les outre-mer, 2017, 39 p., spéc. p. 6). Pour preuve, parmi les trente-deux requérants à l’initiative de l’arrêt pilote J.M.B. c/ France, la plupart d’entre eux avaient été détenus dans les établissements de Ducos (en Martinique), de Baie-Mahaut (en Guadeloupe), et de Faa’a Nuutania, en Polynésie (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c/ France, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ![]() ; ibid. 1064
; ibid. 1064 ![]() , note H. Avvenire
, note H. Avvenire ![]() ; D. 2020. 753, et les obs.
; D. 2020. 753, et les obs. ![]() , note J.-F. Renucci
, note J.-F. Renucci ![]() ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ![]() ; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; ibid. 1643, obs. J. Pradel ![]() ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud
; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ![]() ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud
; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ![]() ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré
; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ![]() ; v. égal. CEDH 21 mai 2015, n° 50494/12, Yengo c/ France, Dalloz actualité, 26 mai 2015, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché
; v. égal. CEDH 21 mai 2015, n° 50494/12, Yengo c/ France, Dalloz actualité, 26 mai 2015, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché ![]() ; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ![]() ; AJ pénal 2015. 450, obs. E. Senna
; AJ pénal 2015. 450, obs. E. Senna ![]() ). À l’échelle nationale, c’est à l’Observatoire international des prisons (OIP) que nous devons une jurisprudence riche et sans cesse renouvelée sur les conditions de détention ultramarines (TA Fort-de-France, ord., 17 oct. 2014, n° 1400673, Dalloz actualité, 29 oct. 2014, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché
). À l’échelle nationale, c’est à l’Observatoire international des prisons (OIP) que nous devons une jurisprudence riche et sans cesse renouvelée sur les conditions de détention ultramarines (TA Fort-de-France, ord., 17 oct. 2014, n° 1400673, Dalloz actualité, 29 oct. 2014, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché ![]() ; TA Guyane, 12 déc. 2019, n° 1901763 ; CE 25 nov. 2020, n° 428002 ; CAA Bordeaux, 17 févr. 2015, nos 14XB01988, 4XB01989, 4XB01991, Dalloz zctualité, 25 févr. 2015, obs. C. Fleuriot ; CE, ord., 7 mai 2020, n° 440151, Ordre des avocats au barreau de Martinique, Dalloz actualité, 19 mai 2020, obs. P. Lingibé ; Lebon
; TA Guyane, 12 déc. 2019, n° 1901763 ; CE 25 nov. 2020, n° 428002 ; CAA Bordeaux, 17 févr. 2015, nos 14XB01988, 4XB01989, 4XB01991, Dalloz zctualité, 25 févr. 2015, obs. C. Fleuriot ; CE, ord., 7 mai 2020, n° 440151, Ordre des avocats au barreau de Martinique, Dalloz actualité, 19 mai 2020, obs. P. Lingibé ; Lebon ![]() ; AJDA 2020. 976
; AJDA 2020. 976 ![]() ; ibid. 1298
; ibid. 1298 ![]() , note J. Schmitz
, note J. Schmitz ![]() ; TA Guyane, ord., 23 févr. 2019, n° 1900211, Dalloz actualité, 29 mars 2019, obs. J. Mucchielli ; CE 4 avr. 2019, n° 428747, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Section française de l’Observatoire international des prisons, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, obs. J. Mucchielli ; AJ pénal 2019. 342, obs. C. Otero
; TA Guyane, ord., 23 févr. 2019, n° 1900211, Dalloz actualité, 29 mars 2019, obs. J. Mucchielli ; CE 4 avr. 2019, n° 428747, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Section française de l’Observatoire international des prisons, Dalloz actualité, 8 avr. 2019, obs. J. Mucchielli ; AJ pénal 2019. 342, obs. C. Otero ![]() ; TA Guyane 14 déc. 2022, n° 2201749 ; CE 6 févr. 2023, n° 470228, Dalloz actualité 20 févr. 2023, obs. M. Dominati).
; TA Guyane 14 déc. 2022, n° 2201749 ; CE 6 févr. 2023, n° 470228, Dalloz actualité 20 févr. 2023, obs. M. Dominati).
Le contexte
Parmi les établissements pénitentiaires ultramarins, celui de Nouméa Camp-Est (Nouvelle-Calédonie) paraît être l’un des plus vétustes. En 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) y constatait « l’état répugnant » et « l’imbroglio actuel, qui […] se traduit par la poursuite de violations graves des droits fondamentaux des personnes détenues » (CGLPL, Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Nouméa, 30 nov. 2011). En 2019, il observait que ses recommandations avaient été insuffisamment suivies, et que le peu de mesures exécutées se révélaient inadaptées. En outre, selon lui, « la situation […] perdure dans l’indifférence générale. L’effet des conditions matériellement indignes et attentatoires aux droits s’agissant de la prise en charge est minimisé par des relations humaines sereines qui en permettent, de façon paradoxale, la perpétuation » (CGLPL, Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Nouméa, 19 nov. 2019, JORF 18 déc. 2019).
Suite à ces recommandations, et au retentissant arrêt J.M.B. c/ France, précité, l’OIP avait usé de sa stratégie de « recours massifs » pour saisir le juge administratif de Nouvelle-Calédonie, afin de faire cesser l’indignité qui régnait dans l’établissement pénitentiaire nouméen (v. D. Costa, Retour sur dix ans de jurisprudences suscitées par l’OIP sur la défense de la dignité et des droits fondamentaux des détenus, in CNCDH, Défendre en justice la cause des personnes détenues, Doc. fr., 2014, p. 35). Par une ordonnance du 19 février 2020, le juge des référés avait reconnu l’existence de conditions de détention indignes au sein de l’établissement. Il avait notamment prescrit à l’administration de prendre plusieurs mesures afin de faciliter l’accès des personnes détenues aux téléphones mis à leur disposition, que soit résorbée l’insalubrité des points d’eau et des sanitaires du quartier des mineurs, que le suivi des personnes détenues par un médecin addictologue soit assuré, que des produits répulsifs soient distribués, à titre gratuit, aux personnes détenues dans les cellules infestées et que soient installées des moustiquaires dans les salles d’enseignement et les cellules infestées (TA Nouvelle-Calédonie, 19 févr. 2020, n° 2000048).
Le 19 octobre 2020, le Conseil d’État y ajoutait l’obligation de remplacer les fenêtres cassées ou défectueuses (CE 19 oct. 2020, nos 439372 et 439444, Garde des sceaux, ministre de la justice, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ![]() ; AJDA 2021. 694
; AJDA 2021. 694 ![]() , note J. Schmitz
, note J. Schmitz ![]() ; ibid. 2020. 1991
; ibid. 2020. 1991 ![]() ; D. 2020. 2121, obs. M.-C. de Montecler
; D. 2020. 2121, obs. M.-C. de Montecler ![]() ; AJ pénal 2020. 593, obs. J.-P. Céré
; AJ pénal 2020. 593, obs. J.-P. Céré ![]() ). Il refusait toutefois, et comme à son habitude, de prononcer des mesures d’ordre structurel (CE 28 juill. 2017, n° 410677, Dalloz actualité, 31 juill. 2017, obs. M. B ; Lebon avec les concl.
). Il refusait toutefois, et comme à son habitude, de prononcer des mesures d’ordre structurel (CE 28 juill. 2017, n° 410677, Dalloz actualité, 31 juill. 2017, obs. M. B ; Lebon avec les concl. ![]() ; AJDA 2017. 1589
; AJDA 2017. 1589 ![]() ; ibid. 2540
; ibid. 2540 ![]() , note O. Le Bot
, note O. Le Bot ![]() ; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ![]() ; AJ pénal 2017. 456, obs. J.-P. Céré
; AJ pénal 2017. 456, obs. J.-P. Céré ![]() ). Considérant que le Conseil d’État faisait alors « pâle figure » face à l’entérinement de la décision J.M.B. c/ France par la Cour de cassation, l’OIP saisissait de nouveau le juge administratif (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383
). Considérant que le Conseil d’État faisait alors « pâle figure » face à l’entérinement de la décision J.M.B. c/ France par la Cour de cassation, l’OIP saisissait de nouveau le juge administratif (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383 ![]() ; ibid. 1383
; ibid. 1383 ![]() ; D. 2020. 1774
; D. 2020. 1774 ![]() , note J. Falxa
, note J. Falxa ![]() ; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; ibid. 1643, obs. J. Pradel ![]() ; ibid. 2021. 1564, obs. J.-B. Perrier
; ibid. 2021. 1564, obs. J.-B. Perrier ![]() ; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary
; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary ![]() ; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy
; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy ![]() ; RFDA 2021. 87, note J.-B. Perrier
; RFDA 2021. 87, note J.-B. Perrier ![]() ; RSC 2021. 517, obs. D. Zerouki-Cottin
; RSC 2021. 517, obs. D. Zerouki-Cottin ![]() ; RTD civ. 2021. 83, obs. P. Deumier
; RTD civ. 2021. 83, obs. P. Deumier ![]() ). Le 11 février 2022, il constatait que plusieurs mesures n’avaient pas encore été mises en œuvre, près de deux ans après avoir été ordonnées (CE 11 févr. 2022, n° 452354, D. 2022. 1061, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
). Le 11 février 2022, il constatait que plusieurs mesures n’avaient pas encore été mises en œuvre, près de deux ans après avoir été ordonnées (CE 11 févr. 2022, n° 452354, D. 2022. 1061, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ![]() ). Pour faire cesser cette saga administrative, il prononçait alors une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans l’exécution des décisions précédemment rendues. En mars 2023, l’OIP sollicitait le juge du Conseil d’État, afin de vérifier la bonne exécution des mesures d’urgence précédemment ordonnées.
). Pour faire cesser cette saga administrative, il prononçait alors une astreinte de 1 000 € par jour de retard dans l’exécution des décisions précédemment rendues. En mars 2023, l’OIP sollicitait le juge du Conseil d’État, afin de vérifier la bonne exécution des mesures d’urgence précédemment ordonnées.
La solution
Tout d’abord, le Conseil d’État rappelle quelles étaient les injonctions prononcées à l’occasion des décisions du 19 février 2020 et du 11 février 2022 (§§ 4-5). Il constate dans un premier temps que la plupart des mesures ont été exécutées ou sont en cours d’exécution (§ 4).
Toutefois, dans un second temps, il note que le juge des référés avait enjoint l’administration d’installer des moustiquaires dans les salles d’enseignement. Il observe à ce titre que l’administration n’a pas procédé à l’exécution de cette mesure au jour de son examen, mais qu’elle a fait équiper les salles d’enseignement « d’une climatisation mise en marche un quart d’heure avant le début des cours et fonctionnant durant toute la durée de la classe » (§ 5). Et c’est là, semble-t-il, que la décision du 27 mars 2023 trouve son intérêt. Le juge du Conseil d’État offre une approche inédite de ce qu’il admet comme étant une voie d’exécution réussie des injonctions prononcées par le juge des référés : « si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée » (§ 3). En outre, il assimile l’exécution de mesures équivalentes aux injonctions à l’exécution de celles-ci. Toutefois, en l’espèce, le juge des référés refuse d’assimiler l’installation d’une climatisation à celle d’une moustiquaire, car « le ministre […] n’apporte pas d’éléments établissant que celle-ci a des effets au moins équivalents aux mesures que l’ordonnance du 19 février du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa lui a enjoint de mettre en œuvre » (§ 5). Dans ces conditions, le juge du Conseil d’État estime que l’administration pénitentiaire n’a pas exécuté les mesures auxquelles elle avait été enjointe, et liquide donc l’astreinte, en la modérant à hauteur de 10 000 € (§ 6).
Cette solution inédite consacre donc une nouvelle approche dans le contentieux de l’indignité pénitentiaire. D’un côté, en offrant à l’administration pénitentiaire la possibilité d’adopter des mesures alternatives. De l’autre, en établissant un régime probatoire souple, où il revient à cette même administration de démontrer le caractère « équivalent » des mesures alternatives mises en œuvre. Mais la portée de cette décision interroge, et nous permet déjà d’entrevoir les difficultés qui pourraient naître d’une telle souplesse.
D’une part, concernant la substance de la solution. L’administration pénitentiaire, dont l’inertie est manifeste, pourrait désormais se départir de l’injonction ordonnée par le juge des référés en choisissant librement d’adopter une mesure alternative, à charge pour elle d’établir son caractère équivalent devant le juge de l’exécution. Quel serait alors le sens de l’office du juge des référés, si la partie condamnée peut choisir elle-même les mesures qu’elle exécute et sous quelle forme ? De plus, si l’administration choisit d’exécuter une mesure alternative, on imagine assez facilement qu’elle y aurait surtout un intérêt économique. Or le juge des référés ordonne déjà, et de plus en plus souvent, des mesures d’une absolue précarité (v. par ex., lorsque la distribution de pièges à cafards aux détenus suffit à lutter contre les nuisibles, CE 6 févr. 2023, n° 470228, préc.). Offrir au chef de l’établissement indigne le contrôle de l’exécution des mesures qui lui incombent reviendrait à lui donner la possibilité d’exécuter des simulacres d’injonctions, mais conduirait aussi à des condamnations massives, à la pérennisation des conditions de détention indignes et au dépérissement du référé-liberté (B. Pastre-Belda, L’amélioration des conditions de détention grâce au juge administratif, D. 2022. 1744 ![]() ; v. égal., J. Falxa, Effectivité des mesures de lutte contre l’indignité des conditions de détention in Chronique de droit pénal, procédure pénale, droit pénitentiaire, politique criminelle, RSC 2022. 905
; v. égal., J. Falxa, Effectivité des mesures de lutte contre l’indignité des conditions de détention in Chronique de droit pénal, procédure pénale, droit pénitentiaire, politique criminelle, RSC 2022. 905 ![]() ).
).
D’autre part, concernant le régime probatoire de l’effet équivalent. On pourrait penser qu’il s’agit d’un barrage procédural à la liberté totale de l’administration. Mais, au contraire, il ne peut que conduire à la perpétuation de l’indignité pénitentiaire. La décision du 27 mars en est d’ailleurs l’exemple typique. Après deux ans et quatre recours, et même si le juge du Conseil d’État a observé que le chef d’établissement a pris une mesure insatisfaisante et inefficace, les détenus auront continué de subir, durant ce laps de temps, des traitements contraires à leurs droits fondamentaux. Encore une fois, c’est ici dévoyer, si ce n’est anéantir, la figure même du référé-liberté, dont la célérité semble en conditionner l’existence. Si l’œuvre louable de l’OIP permet de mettre en lumière les dysfonctionnements pénitentiaires, la décision ici commentée nous montre que le seul recours ne permet pas d’en assurer le remède. Il faut donc espérer, et nous n’en doutons pas, que l’OIP poursuivra sa démarche dynamique, même s’il ne peut toujours pas contraindre l’administration à l’informer de l’exécution des injonctions ou, désormais, de ce qu’il en reste.
© Lefebvre Dalloz