Dispositif, concentration, moyens et prétentions : la grande illusion
L'appelant qui, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, mentionne ses prétentions tendant au débouté de l'intimé au dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 dudit code, peut soulever ultérieurement un moyen de déchéance, l'article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.
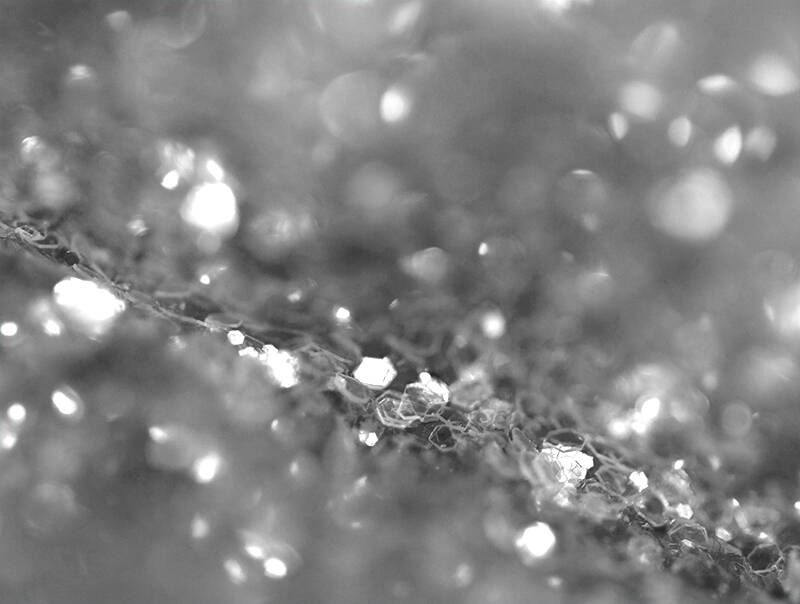
Condamné par le tribunal de commerce en tant que caution à verser différentes sommes, une partie relève appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle confirme le jugement par arrêt du 7 avril 2021 en estimant irrecevable la demande de l’appelant visant à obtenir une condamnation de la banque et du fonds commun de titrisation. Les juges d’appel considèrent que si le dispositif des premières conclusions sollicite bien le débouté des demandes de la banque, aucune motivation n’apparaît dans les conclusions, cette demande de débouté ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces. Pour la cour, est donc irrecevable le moyen de défense de la caution appelante, fondé sur l’article L. 332-1 du code de la consommation, soulevé pour la première fois dans des conclusions ultérieures et dans le dispositif. La caution forme un pourvoi pour violation des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile afin de soutenir que le principe de concentration des prétentions se comprend non au regard de la motivation contenue dans le corps des premières écritures mais bien du dispositif qui contenait la prétention. La deuxième chambre civile répond au visa des articles 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 dudit code :
« 3. Selon le premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
4. En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
5. Il en résulte que le respect des diligences imparties par l’article 910-4 du même code s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954.
6. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, retient que l’engagement disproportionné ouvre à la caution un moyen de défense au fond lui permettant de faire rejeter, selon l’article 71, la demande de son adversaire. Il ajoute que l’article 564 autorisant les nouvelles prétentions dès lors qu’elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses, la demande tirée de la disposition n’est pas irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. Il relève que, dans ses conclusions du 10 mai 2019, M. [J] n’a pas sollicité la déchéance de la banque dans sa motivation, la demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l’exige l’article 564. Il retient qu’est irrecevable ce moyen de défense soulevé pour la première fois par conclusion du 26 septembre 2019 et dans son dispositif, déclare irrecevable la demande de l’appelant fondée sur l’article L. 332-1 du code de la consommation.
7. En statuant ainsi, alors que l’appelant avait, conformément à l’article 954 précité, mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et que l’article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Moyens et prétentions, la confusion des genres
Le moyen unique au soutien du pourvoi était laconique et pour être encore plus bref, on pourrait dire qu’il visait à soutenir que le principe de concentration des prétentions s’exprime au regard du dispositif des conclusions, non pas de la motivation contenue dans les conclusions. La question qui pourrait surgir pourrait être de savoir si, finalement, une partie peut s’abstenir de motiver une prétention dans le corps de ses premières écritures dès lors que le dispositif, qui seul saisit la cour, mentionne cette prétention ? Mais à regarder de plus près, la réponse n’est pas livrée sur ce terrain-là. L’arrêt n’est pas, loin s’en faut, une dispense de motivation et de discussion des moyens dans les conclusions des parties. Déjà, car le dispositif des premières conclusions visait un débouté, puis, dans un second temps, une déchéance. En outre, la deuxième chambre civile rappelle dans sa solution que « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée » (4). Enfin, le contraire eut été surprenant alors que la Cour de cassation estime qu’une cour d’appel n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention (Civ. 2e , 6 sept. 2018, n° 17-19.657, Dalloz actualité, 28 sept. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1752 ![]() ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero
; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero ![]() ; JA 2018, n° 586, p. 11, obs. X. Delpech
; JA 2018, n° 586, p. 11, obs. X. Delpech ![]() ; RTD com. 2018. 973, obs. D. Hiez
; RTD com. 2018. 973, obs. D. Hiez ![]() ). Et encore, la cour d’appel ne doit porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conclusions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-17.910, Dalloz actualité, 5 juill. 2019, obs. R. Laffly). La cassation intervient pour une autre raison, celle de la confusion par les juges d’appel du moyen et de la prétention.
). Et encore, la cour d’appel ne doit porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conclusions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-17.910, Dalloz actualité, 5 juill. 2019, obs. R. Laffly). La cassation intervient pour une autre raison, celle de la confusion par les juges d’appel du moyen et de la prétention.
Se souvenir des choses simples
Les premières conclusions de l’appelant, caution, avaient été notifiées le 10 mai 2019. Elles devaient donc, par application de l’article 910-4 applicable pour toutes déclarations d’appel postérieures au 1er septembre 2017, concentrer l’ensemble des prétentions dans le délai de trois mois imparti pour conclure. Or, bien qu’une demande de débouté figurât au dispositif des premières écritures, l’appelant, se prévalant, par application de l’article L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur, d’un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, avait opposé une déchéance seulement dans ses conclusions déposées le 26 septembre 2019. La cour d’appel de Paris avait observé que, faute de discussion sur la déchéance dans la motivation des conclusions du 10 mai 2019, la demande de débouté qui figurait au dispositif ne renvoyait à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces comme l’exige l’article 564, de sorte que devait être déclaré irrecevable le moyen de défense au fond soulevé pour la première fois dans des conclusions postérieures et le dispositif (sic).
Première erreur, si l’article 564 dispose qu’« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait », aucune exigence d’explicitation et de justification par des pièces n’est posée par cette disposition légale. C’est au contraire l’article 954, alinéa 1er, qui figure cette exigence : les conclusions d’appel « doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ». La question des demandes nouvelles en cause d’appel ne se posait pas.
Deuxième erreur, la cour d’appel assimilait la déchéance, non discutée dans le corps des premières conclusions, à un moyen de défense au fond qu’elle jugeait irrecevable comme soutenu pour la première fois au-delà du délai de trois mois imparti pour conclure. Or, l’article 910-4 ne pose une exigence de concentration qu’à l’égard des prétentions, pas des moyens. Et pour cause, l’appel restant une voie d’achèvement, l’article 563 dispose que « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Troisième erreur, qui découle de la précédente, le moyen de défense tiré de la déchéance en raison de la disproportion de l’engagement de caution était donc un moyen, pas une prétention. Or, si l’article 910-4 vise seulement la concentration des prétentions, l’article 954 précise encore que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Aussi, l’appelant non seulement pouvait, au regard de ces deux dispositions, développer ultérieurement dans la discussion de nouveaux moyens non soutenus dans ses premières écritures, mais la cour se devait de prendre en compte les prétentions figurant au dispositif qui la saisissait.
Ainsi, la cassation intervient non pas parce que la concentration des prétentions ne s’apprécie qu’au regard du dispositif des premières conclusions sans égard à la motivation dans la discussion, mais parce que l’appelant pouvait parfaitement fixer ses prétentions au dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 puis, dans second temps, développer un moyen de défense au fond, en l’occurrence son moyen nouveau de déchéance. C’est la qualification de moyen plutôt que de prétention qui sauve ici l’appelant. Si l’on aborde l’arrêt sous cet angle, les choses paraissent simples. Le sont-elles véritablement ? Et bien pas du tout !
Les illusions perdues
Pas de confusion, pas de fausse apparence entre le moyen et la prétention, les choses sont en place. L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, les prétentions constituant l’objet de la demande, laquelle constitue le cadre voulu par les parties aux litiges. De leur côté, les moyens sont les raisons de fait ou de droit dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétentions ou leurs défenses. Mais au risque de perdre toute illusion, l’appréciation du moyen et de la prétention est en train de devenir, en procédure civile, de plus en plus délicate à aborder. Cette différenciation serait chose aisée si la Cour de cassation elle-même ne venait, parfois, les assimiler, pour ne pas dire les confondre, sans même évoquer ce courant jurisprudentiel qui s’émeut de retrouver trop de moyens dans les dispositifs des conclusions des avocats alors que seules devraient y figurer les prétentions. Mais peut-on leur en vouloir ? En effet, même si elle a sollicité la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la partie qui poursuit l’infirmation du chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure doit aussi formuler une prétention en ce sens dans son dispositif (Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 19-23.615, Dalloz actualité, 16 févr. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 291 ![]() ; ibid. 543, obs. N. Fricero
; ibid. 543, obs. N. Fricero ![]() ; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. D. Cholet, O. Cousin, E. Jullien et R. Laher
; Rev. prat. rec. 2021. 7, chron. D. Cholet, O. Cousin, E. Jullien et R. Laher ![]() ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol
; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ![]() ). Peu de temps après, la deuxième chambre civile, toujours par arrêt publié, jugeait que si une partie demandait la réformation de la décision mais « ne faisait état que dans le corps de ses écritures de la nullité de la requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes, dès lors qu’elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque, la cour d’appel a, à bon droit, dit qu’elle n’était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions » (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-12.244, Dalloz actualité, 21 oct. 2021, obs. C. Lhermitte ; Rev. prat. rec. 2021. 5, chron. E. Jullien et C. Simon
). Peu de temps après, la deuxième chambre civile, toujours par arrêt publié, jugeait que si une partie demandait la réformation de la décision mais « ne faisait état que dans le corps de ses écritures de la nullité de la requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes, dès lors qu’elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque, la cour d’appel a, à bon droit, dit qu’elle n’était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n’étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions » (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-12.244, Dalloz actualité, 21 oct. 2021, obs. C. Lhermitte ; Rev. prat. rec. 2021. 5, chron. E. Jullien et C. Simon ![]() ; Procédures, déc. 2021, Comm. 313, obs. R. Laffly). Quant à la fin de non-recevoir, définie pourtant comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond » par application de l’article 122 du code de procédure civile, sa mention dans les dernières conclusions, mais non au dispositif des conclusions, ne permet pas à la cour d’appel de la prendre en compte, ni bien sûr de la relever d’office si elle n’est pas d’ordre public (Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-15.871).
; Procédures, déc. 2021, Comm. 313, obs. R. Laffly). Quant à la fin de non-recevoir, définie pourtant comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond » par application de l’article 122 du code de procédure civile, sa mention dans les dernières conclusions, mais non au dispositif des conclusions, ne permet pas à la cour d’appel de la prendre en compte, ni bien sûr de la relever d’office si elle n’est pas d’ordre public (Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-15.871).
La distinction ne saute pas vraiment aux yeux, et la confusion du moyen et de la prétention a de quoi brouiller la vision si le critère différenciant est que le moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes s’évince devant la prétention qui mérite qu’elle soit prononcée. On questionnera encore cette déchéance en tant que moyen de défense et non de prétention qui n’aurait pas besoin d’être prononcée ; la prétention de débouté concentrée dès les premières écritures suffit, par anticipation, à sauver le moyen de déchéance… qui donc n’a pas besoin d’être prononcé.
La lecture du code de procédure civile a de quoi aussi interroger. Car lorsque la Cour de cassation dit, a contrario, que la nullité ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l’adversaire de ses demandes dès lors qu’elle implique que cette nullité soit prononcée, que faire de l’article 71 qui précise que « constitue un moyen de défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, la prétention de l’adversaire ». L’exception de nullité qualifiée ici de prétention reste un moyen de défense, l’exception de procédure étant, conformément à l’article 73 du code de procédure civile, « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Et que dire du séquençage du code de procédure civile, qui n’est pas une illusion d’optique et qui fait apparaître ces articles immédiatement sous le Titre V du Livre 1er du code de procédure civile « Les moyens de défense », sous un chapitre I « Les défenses au fond », et qui se poursuit avec les exceptions de nullité des articles 114 et suivants sous un chapitre II libellé « les exceptions de procédure ».
Alors, si la cour d’appel de Paris ne pouvait, à l’évidence, dire que la déchéance est un moyen de défense qui ne saurait être ajouté au second jeu d’écritures déposé au-delà du délai imparti par l’article 908 en violation du principe de concentration des prétentions puisqu’il n’est qu’un principe de concentration des prétentions et non des moyens, on se réjouira, mais c’est éphémère, que ce moyen ne soit pas, avec cet arrêt du 2 février 2023, une prétention. En attendant, on se bercera d’illusions.
© Lefebvre Dalloz