Distribution de dividendes hors AGOA : un arrêt déconcertant
Il résulte de la combinaison des articles L. 232-11, alinéa 1er et L. 232-12, alinéa 1er, du code de commerce, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.
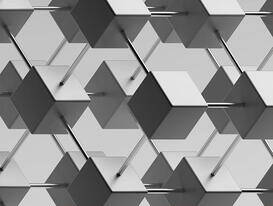
1. Le moins qu’on puisse dire est que l’arrêt rendu le 12 février 2025 par la chambre commerciale a surpris, voire déconcerté.
En substance, et pour la première fois, la Cour de cassation énonce qu’encourt la nullité la délibération de « l’assemblée générale » d’une société par actions simplifiée, qui décide de distribuer des bénéfices prélevés en partie sur le report bénéficiaire de l’exercice précédent, dès lors que cette assemblée n’est pas celle de l’approbation des comptes de l’exercice clos. La solution est clairement conçue comme énonçant un principe général, qui dépasse le cas d’espèce.
2. Quelques mots rapides sur les données factuelles sont nécessaires pour éclairer la portée de l’arrêt.
En avril 2017, l’assemblée générale d’une SAS Midi Plage approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décide de placer les bénéfices en « report à nouveau ». Trois semaines après, en mai, l’intégralité des actions de la SAS fait l’objet d’une promesse de cession, promesse qui sera exécutée le 28 juillet suivant. Mais entre-temps (le 3 juillet), une nouvelle assemblée se tient au cours de laquelle est décidée la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidé en avril.
Pour des raisons qui ne sont pas indiquées dans l’arrêt, la mise en paiement des dividendes n’est pas réalisée avant le transfert des actions au cessionnaire. Sans doute ce dernier se fait-il un peu prier avant de verser les sommes, puisqu’en mars 2019 le cédant est contraint d’assigner la SAS en paiement de sa créance de dividendes.
3. Demande rejetée en cause d’appel, les juges condamnant même le cédant à payer à la SAS la somme correspondant aux prélèvements sociaux qu’elle avait dû acquitter en raison de la décision de distribution. En substance, la cour d’appel avait jugé irrégulière la distribution, au motif que le montant des capitaux propres de la société était, avant la décision de distribution des dividendes du 3 juillet 2017, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables.
La décision est cassée au double visa de l’article 1103 du code civil (« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ») et de l’article L. 235-1 du code de commerce définissant les causes de nullité, en particulier celles touchant les « actes ou délibérations » des sociétés commerciales. Est critiquée la décision de la cour d’appel ayant refusé de faire produire effet à la délibération de la SAS (de distribuer les dividendes), alors que celle-ci, « bien qu’encourant la nullité […], s’imposait tant que la nullité n’en avait pas été prononcée ».
4. Une fois n’est pas coutume ce n’est pas tant la cassation, en elle-même, qui mérite un commentaire.
En effet, la Cour de cassation reprend une solution bien connue en droit des contrats (Civ. 1re, 15 juin 2004, n° 00-16.392 F-D, RTD civ. 2004. 508, obs. J. Mestre et B. Fages ![]() ), appliquée en droit de la copropriété (en dernier lieu, Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 18-20.368 F-D, AJDI 2021. 56
), appliquée en droit de la copropriété (en dernier lieu, Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 18-20.368 F-D, AJDI 2021. 56 ![]() , obs. N. Le Rudulier
, obs. N. Le Rudulier ![]() ; réaffirmant que les décisions d’assemblées générales des copropriétaires s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée) et plus récemment étendue aux clauses statutaires des sociétés (Com. 24 oct. 2018, n° 15-27.911 FS-D, Rev. sociétés 2019. 534, note N. Morelli
; réaffirmant que les décisions d’assemblées générales des copropriétaires s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée) et plus récemment étendue aux clauses statutaires des sociétés (Com. 24 oct. 2018, n° 15-27.911 FS-D, Rev. sociétés 2019. 534, note N. Morelli ![]() ; énonçant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour prévenir un dommage imminent, de prescrire, en vue de sa mise en œuvre par l’assemblée générale d’une société, une règle d’adoption d’une résolution différente de celle prévue par les statuts, celle-ci serait-elle illicite ; 12 oct. 2022, n° 20-16.009 F-D, Rev. sociétés 2023. 155, note E. Guégan
; énonçant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour prévenir un dommage imminent, de prescrire, en vue de sa mise en œuvre par l’assemblée générale d’une société, une règle d’adoption d’une résolution différente de celle prévue par les statuts, celle-ci serait-elle illicite ; 12 oct. 2022, n° 20-16.009 F-D, Rev. sociétés 2023. 155, note E. Guégan ![]() ; en ce sens que les délibérations d’une société civile s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée).
; en ce sens que les délibérations d’une société civile s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée).
Mais précisément, la Cour de cassation ne s’en tient pas là, ce qu’elle aurait pu parfaitement faire dans sa fonction de cour régulatrice. À la faveur d’un obiter dictum, reposant sur la combinaison d’un double fondement textuel (C. com., art. L. 232-11 et L. 232-12), elle vient indiquer en quoi et pourquoi « seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation [le report à nouveau bénéficiaire] et, le cas échéant, sa distribution ».
5. Disons-le immédiatement, cet énoncé aux fondements textuels fragiles nous paraît contestable. Au-delà de l’accrochage incertain aux deux articles qui viennent d’être cités, on peine à en saisir la justification substantielle. Ce qui invite, après mise en examen des fondements invoqués au soutien de la nullité, à tenter d’en explorer la portée.
Fondements de la nullité
6. Les termes du débat sont maintenant connus. Ils ont été très récemment réactivés à la suite d’un autre contentieux similaire par certains côtés à celui traité dans l’arrêt commenté et aux termes duquel la Cour d’appel de Paris a conclu à l’absence de compétence exclusive de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes (qu’on désignera ci-après sous l’acronyme AGOA) pour décider de la distribution du dividende prélevé sur les réserves et/ou le report à nouveau bénéficiaire (Paris, 30 janv. 2025, n° 22/17478, infirmant T. com. Paris, 23 sept. 2022, n° J2021000542, BRDA 7/23. Inf. 21, note R. Mortier ; BJS janv. 2023. 22 note B. Dondero ; B. Dondero, La distribution des bénéfices en dehors de l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice, RJDA mai 2023. 13).
Dans l’arrêt du 12 février 2025, il est seulement question de la possibilité de décider, hors AGOA, la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent.
7. L’échafaudage construit par la Haute juridiction, pour conclure négativement à cette question, repose sur l’énoncé d’une première règle considérée comme impérative : le report bénéficiaire d’un exercice serait nécessairement inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant. Il faut entendre ici non pas seulement que le report à nouveau est un élément du bénéfice distribuable, mais aussi que, lorsqu’une assemblée approuvant les comptes de l’exercice a décidé d’affecter en report à nouveau bénéficiaire tout ou partie des bénéfices distribuables, ce report à nouveau serait intangible jusqu’à la prochaine AGOA. Le législateur aurait ainsi, implicitement, attribué une compétence exclusive à l’AGOA pour connaître du sort des sommes portées en report à nouveau.
8. Pour notre part, ce premier élément de raisonnement nous semble assez fragile. Deux raisons à cela.
D’abord, la Cour raisonne comme si l’assemblée générale d’approbation des comptes était un organe légalement défini et doté d’un statut spécifique, à l’image (dans les sociétés anonymes) de l’assemblée générale extraordinaire (C. com., art. L. 225-96) et de l’assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-98) ou encore des assemblées spéciales de l’article L. 225-99. Or, tel n’est manifestement pas le cas à considérer l’article L. 225-100, qui traite l’assemblée d’approbation des comptes comme une « simple » assemblée générale ordinaire. Et on ne voit pas comment il pourrait en aller différemment dans les SAS, qui ne connaissent pas ces « assemblées générales », pas plus d’ailleurs que dans les autres formes sociales.
Ensuite, on peine à comprendre pourquoi une décision d’affectation de tout ou partie des bénéfices en report à nouveau impliquerait nécessairement de rendre les sommes indisponibles jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes. Ce n’est pas ainsi, nous semble-t-il, qu’il faut comprendre l’article L. 232-11, alinéa 1er. Lorsqu’il y est dit que le bénéfice distribuable de l’exercice « n » est non seulement « constitué » par les bénéfices constatés de cet exercice « n », mais aussi par le « report bénéficiaire », c’est-à-dire les bénéfices constatés, et non affectés, au titre de l’exercice « n - 1 », la lecture la plus naturelle du texte est de considérer que le report à nouveau a vocation à se fondre dans le bénéfice distribuable de l’exercice n constaté en n + 1. En d’autres termes, le texte autorise à distribuer, au-delà du bénéfice de l’exercice « n - 1 », les reports à nouveau d’exercices antérieurs sans autre contrainte, en particulier sans avoir à respecter l’exigence inscrite à l’alinéa 2 concernant la distribution de réserves, qui prescrit que les dividendes soient prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Rien ne suggère donc dans cet énoncé que, implicitement mais nécessairement, les sommes parce que portées en report à nouveau deviendraient ipso facto indisponibles, jusqu’à la prochaine AGOA, pour tout autre affectation.
Certes, le raisonnement est déroulé en combinant la lecture des deux premiers alinéas des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce. Mais l’articulation de ces textes ne rend pas, à notre sens, plus certaine l’interprétation qui en est donnée.
9. Poursuivant sa construction, la Haute juridiction infère, « par voie de conséquence », de la première règle qu’elle formule une seconde règle tout aussi marquée du sceau de l’impérativité : seule l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice suivant (« n + 1 ») pourra décider de l’affectation du report à nouveau bénéficiaire et, le cas échéant, sa distribution.
La solution s’appuie ici plus directement sur l’article L. 232-12, alinéa 1er, selon lequel « après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». L’analyse de cet article retenue par l’arrêt commenté est parfaitement possible, au prix toutefois d’une approche étroitement littérale des termes de celui-ci. Le texte enfermerait dans une chronologie contrainte, au sein de la seule AGOA, l’enchaînement suivant : approbation des comptes annuels, constatation de l’existence et du montant des sommes distribuables et détermination des dividendes attribués aux associés.
10. Il est vrai que cette position, défendue par certains auteurs (D. Gallois-Cochet et C. Barrillon, Les distributions aux associés en dehors de l’assemblée d’approbation des comptes, D. 2023. 1227 ![]() ), fut aussi celle figurant dans le plan comptable général de 1982 (p. I. 40), qui définissait ainsi le « Report à nouveau (solde créditeur) » : « bénéfice dont l’affectation est renvoyée par l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice à la décision de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l’exercice suivant ».
), fut aussi celle figurant dans le plan comptable général de 1982 (p. I. 40), qui définissait ainsi le « Report à nouveau (solde créditeur) » : « bénéfice dont l’affectation est renvoyée par l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice à la décision de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l’exercice suivant ».
Mais d’une part, cette formule n’avait jamais été comprise comme interdisant les décisions intercalaires (autres que les acomptes sur dividendes prévus à l’art. L. 232-12, al. 2), d’autre part le plan comptable général dans sa version actualisée au 1er janvier 2024 ne contient plus aucune indication en ce sens. La norme énonce désormais plus sobrement que, « dans les sociétés, les montants non distribués et non affectés à un compte de réserves sont virés au compte 11 "Report à nouveau" : au compte 110, en cas de report bénéficiaire, et au compte 119, en cas de report déficitaire, si ces comptes sont ouverts » (Règl. ANC n° 2014-03, art. 941-12).
11. On pourrait donc objecter que l’article L. 232-12, alinéa 1er, décrit le séquencement des décisions conduisant ordinairement à une distribution de dividendes, mais constitue une base trop incertaine pour fonder une compétence exclusive, surtout si la sanction en est la nullité d’une distribution hors AGOA de sommes inscrites en report à nouveau.
12. On relèvera aussi que la Cour de cassation ne reprend pas, à l’appui de sa thèse, un argument figurant dans le jugement du Tribunal de commerce de Paris précité, selon lequel la seule possibilité de distribuer hors AGOA une « somme distribuable » serait de sacrifier à la procédure plus contraignante de l’acompte sur dividendes décrite à l’article L. 232-12, alinéa 2, du code de commerce. Façon de suggérer qu’une distribution hors AGOA court-circuiterait et donc viderait de toute substance le dispositif spécial de paiement des acomptes sur dividendes.
On peut comprendre que cette considération ne figure pas sous la plume de la Haute juridiction. La commission juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en avait fort bien désactivé la pertinence (Avis EJ 2007-09, Bull. CNCC, mars 2009, p. 265). Il est logique que, lorsqu’il s’agit de distribuer un bénéfice au titre de la période intermédiaire ayant commencé après le dernier exercice clos, le montant susceptible d’être distribué à titre d’acompte nécessite l’établissement d’un bilan certifié. En revanche, cette exigence perd toute pertinence lorsque la distribution concerne le report à nouveau, dont le montant est précisément connu, puisqu’il a fait l’objet d’une décision lors de la dernière AGOA. Ce qui devrait permettre de le distribuer de manière « autonome », donc en dehors de toute AGOA.
13. Plus fondamentalement encore, on peine à comprendre ce qui justifie la lecture, incertaine on l’a vu des textes, retenue par la Cour de cassation.
Il est légitime que, dans son rôle d’unification du droit, la Cour régulatrice construise certaines interprétations des normes en vue de définir un ordre public sociétaire fondé sur de solides motivations. Par exemple, doit être approuvée la règle jurisprudentielle selon laquelle les statuts d’une SAS ne sauraient stipuler qu’une décision collective pourra être adoptée à une « majorité minoritaire » car est en jeu de façon sous-jacente le droit fondamental de tout associé « de participer aux décisions collectives » énoncé à l’article 1844 du code civil (Cass., ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670 BR, Dalloz actualité, 29 nov. 2024, obs. J. Delvallée ; D. 2024. 2224 ![]() , note J.-B. Barbièri
, note J.-B. Barbièri ![]() ; Rev. sociétés 2025. 51, note L. Godon
; Rev. sociétés 2025. 51, note L. Godon ![]() ; RTD com. 2024. 945, obs. J. Moury
; RTD com. 2024. 945, obs. J. Moury ![]() ). Pareillement, peut-on admettre sans difficulté que, s’agissant toujours des SAS, ait été affirmé à titre de principe et par « combinaison » de plusieurs articles, qu’un acte extrastatutaire peut compléter les statuts mais non les contredire et qu’en cas de conflit, les statuts prévalent (Com. 12 oct. 2022, n° 21-15.382 F-B, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Delvallée ; D. 2022. 2086
). Pareillement, peut-on admettre sans difficulté que, s’agissant toujours des SAS, ait été affirmé à titre de principe et par « combinaison » de plusieurs articles, qu’un acte extrastatutaire peut compléter les statuts mais non les contredire et qu’en cas de conflit, les statuts prévalent (Com. 12 oct. 2022, n° 21-15.382 F-B, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Delvallée ; D. 2022. 2086 ![]() , note J.-B. Barbièri
, note J.-B. Barbièri ![]() ; ibid. 2023. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; ibid. 2023. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ![]() ; Rev. sociétés 2023. 92, note A. Reygrobellet
; Rev. sociétés 2023. 92, note A. Reygrobellet ![]() ; RTD com. 2023. 156, obs. A. Lecourt
; RTD com. 2023. 156, obs. A. Lecourt ![]() ; ibid. 165, obs. J. Moury
; ibid. 165, obs. J. Moury ![]() ) ou encore qu’encourent la nullité les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 671
) ou encore qu’encourent la nullité les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 671 ![]() , note A. Couret
, note A. Couret ![]() ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ![]() ; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon
; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon ![]() ; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt
; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt ![]() ; ibid. 391, obs. J. Moury
; ibid. 391, obs. J. Moury ![]() ).
).
14. S’agissant de la nullité des distributions hors AGOA, nulle indication dans l’arrêt de la règle fondamentale méconnue, au-delà de la lecture combinée, et assez incertaine, des articles précités. Et on peine à identifier ce qui pourrait être en jeu pour justifier une telle sanction.
D’abord, la décision régulièrement prise par la collectivité des associés (quelles qu’en soient les modalités d’ailleurs, s’agissant d’une SAS) de distribuer des dividendes hors AGOA n’est pas moins légitime, faute pour cette dernière d’être dotée d’une compétence exclusive claire.
Ensuite, on ne voit pas quel intérêt pourrait être lésé par une telle décision de distribution hors AGOA. Sans doute pas l’intérêt social, pas plus que celui des tiers qui n’a pas à être pris en compte ici et moins encore celui des associés. Plus précisément, l’intérêt social n’est pas plus en risque que la distribution soit décidée par une AGOA ou par une autre assemblée. Dans les deux hypothèses, il importera de s’assurer d’une part, préalablement à la distribution, que les capitaux propres ne sont pas, ou ne deviendraient pas à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (C. com., art. L. 232-11, al. 3) ; d’autre part, qu’une distribution mal calibrée n’obère pas les besoins de développement et d’investissements de la société (sur la responsabilité des dirigeants en cas de distribution massive de dividendes, v. not., Com. 8 avr. 2021, n° 19-23.669 F-D, Rev. sociétés 2021. 657, note A. Couret ![]() ).
).
15. Observons que, dans l’espèce commentée, les juges du fond avaient relevé que le montant des capitaux propres de la société était, avant la distribution des dividendes décidée le 3 juillet 2017, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables.
Les dirigeants prennent donc un risque en distribuant hors AGOA, mais au fond guère plus important que celui qu’ils prennent lorsqu’ils proposent une distribution dans le cadre d’une AGOA, même si, dans ce dernier cas, à suivre la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017, c’est à la date de clôture du dernier exercice qu’il convient de se placer pour s’assurer si l’actif net permet ou non de distribuer (art. 56, 1).
16. En d’autres termes, pour assurer la police des articles L. 232-10 et suivants du code de commerce, dont il n’est pas question de nier tout caractère impératif, le débat n’aurait pas dû être tout entier construit autour de l’affirmation de la compétence exclusive de l’AGOA. Si la distribution n’enfreint pas la règle inscrite au troisième alinéa de l’article L. 232-11, ni n’obère l’intérêt social, elle devrait être considérée comme irréprochable. Si, à l’inverse, elle méconnaît ces exigences, outre la nullité, d’autres sanctions redoutables seront applicables et possiblement de façon cumulative : la responsabilité (civile) des membres des organes de gestion, motif pris de ce que les dividendes distribués seraient fictifs au sens de l’article L. 232-12, alinéa 3 ; la répétition de ces dividendes à la société, si les conditions énoncées à l’article L. 232-17 étaient réunies.
Ce qui invite à envisager maintenant les conséquences de la nullité.
Portée de la nullité
17. Commençons par envisager les conséquences de la règle forgée par la Cour de cassation au cas particulier du litige qui lui était soumis, avant de tenter, dans un second temps, d’en mesurer les incidences potentielles au-delà.
18. L’arrêt d’appel, censuré comme on l’a vu en ce qu’il avait refusé d’enjoindre à la société de procéder à la distribution des sommes prélevées sur le report bénéficiaire, alors que la nullité de la délibération litigieuse n’avait été ni prononcée ni même demandée, était une décision réformant celle des premiers juges : la cour avait donc été saisie par la SAS (ainsi que le cessionnaire des actions).
Si la juridiction de renvoi est saisie par la partie la plus diligente (Rép. pr. civ., v° Pourvoi en cassation, par J. et L. Boré, n° 968), c’est la SAS qui, ayant succombé en première instance, aura intérêt à accomplir la déclaration de saisine. Dans la mesure où, devant la cour de renvoi, « les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions » (C. pr. civ., art. 632), il nous semble que, sans former une prétention nouvelle car il s’agira toujours pour la SAS de s’opposer au versement des sommes litigieuses, la SAS pourra invoquer, à la suite de la cassation, la nullité de la délibération prise par une assemblée « incompétente ».
Quant aux dirigeants, outre la responsabilité civile qu’ils encourent pour avoir fautivement provoqué une décision collective (en particulier, convoqué une « assemblée générale »), le risque le plus grave pour eux réside dans l’incrimination pénale de répartition de dividendes fictifs (C. com., art. L. 242-6, 1°, applicable aux SAS sur renvoi de l’art. L. 244-1). Risque, en réalité relativement faible à consulter les recueils de jurisprudence, qui, pour se réaliser, supposerait d’établir, outre la mauvaise foi du dirigeant (la connaissance de la fictivité des dividendes), une répartition de dividendes fictifs en l’absence d’inventaire – entendu aujourd’hui comme l’absence de bilan – ou au moyen d’un inventaire/bilan frauduleux. Or, il ne nous semble pas que, motif pris de ce que la distribution aurait procédé d’une décision collective qui n’est pas celle qui a approuvé les comptes annuels, il puisse être raisonnablement soutenu que cette distribution a été faite « en l’absence d’inventaire ».
19. Autre situation : celle d’une société qui, en application d’une similaire délibération, aurait cette fois assuré la mise en paiement des sommes prélevées sur le report à nouveau bénéficiaire. Ce qui suscite une série d’interrogations.
20. Une première question est celle de savoir qui aurait intérêt à agir en nullité. L’arrêt commenté ne donne aucune indication à ce sujet, mais il semble bien que l’action ne serait pas réservée à la seule société. On peut imaginer que d’autres personnes y auraient intérêt : un associé entré dans la société après la décision de distribution (comme au cas traité par l’arrêt commenté), un nu-propriétaire d’actions, voire un créancier de la société (pourquoi pas l’administration fiscale).
21. Deuxième question : nullité de droit ou nullité facultative supposant la démonstration d’un grief ? Dans la mesure où le raisonnement déroulé par la Cour de cassation repose sur l’idée implicite d’une compétence exclusive de l’AGOA, le plus vraisemblable est de considérer que la nullité devrait être prononcée sans autre démonstration que la constatation que la distribution procède d’une résolution adoptée par une assemblée « autre que celle approuvant les comptes de l’exercice ».
22. Troisième question : à supposer que la nullité soit demandée et obtenue, la société pourrait-elle exiger la répétition des dividendes dans les conditions prévues à l’article L. 232-17 du code de commerce ? La première condition étant remplie – à suivre la Cour de cassation : une distribution effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 et L. 232-12 –, encore faudrait-il que la société établisse que « les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances ».
Peut-être, d’ailleurs, faudrait-il distinguer entre la qualité des actionnaires bénéficiaires des distributions, la situation de celui qui est « seulement » actionnaire devant être appréciée différemment de celle du dirigeant-actionnaire ? Surtout, en raison de la diversité des analyses qui prévalaient avant l’arrêt du 12 février 2025, la majorité des auteurs soutenant – on l’a dit – une position différente de celle exposée dans cet arrêt, la probabilité paraît faible qu’il soit considéré que les bénéficiaires avaient parfaitement conscience du caractère irrégulier d’une distribution hors AGOA prélevée sur le report bénéficiaire. Cela bien sûr, hors configuration caricaturale dont la jurisprudence émanée des juridictions du fond ne donne que quelques rarissimes illustrations.
Deux autres obstacles pourraient être opposés à une demande de répétition formée par la société. Celui de la prescription, d’abord, de la prescription de l’action en nullité enfermée dans la prescription triennale de l’article L. 235-9 du code de commerce ; celui ensuite de la prescription, sans doute quinquennale faute de disposition enfermant cette répétition dans un autre délai (v. en ce sens, Lyon, 31 mai 2018, n° 16/09102), de l’action en paiement de la créance de restitution née consécutivement au prononcé de la nullité. Ensuite, mais l’objection interviendrait pour neutraliser l’action en nullité, il reste possible de régulariser la décision de distribution potentiellement annulable lors de la prochaine AGOA ; la régularisation pouvant intervenir jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le fond en première instance (C. com., art. L. 235-3), sans que le juge puisse prononcer la nullité avant l’expiration d’un délai deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance (C. com., art. L. 235-4).
23. Cette possibilité de régularisation constitue un dernier argument pour démonétiser largement la règle énoncée dans l’arrêt du 12 février 2025. Elle témoigne à nouveau de ce qu’il est peu pertinent d’annuler, par principe, toute décision collective de distribution de dividendes, qui serait prise hors AGOA. Puisqu’il « suffit » de régulariser, la nullité ne sera guère encourue effectivement que dans le cas où, comme dans l’espèce commentée, les associés ayant décidé la distribution, créanciers des sommes correspondantes, ne sont plus majoritaires dans la société lors de l’AGOA suivante.
Aussi, faut-il espérer que ne sera pas remise en cause la solution retenue par la Cour d’appel de Paris en janvier dernier, dans l’arrêt signalé plus haut, selon lequel une assemblée générale peut librement distribuer des réserves dès l’instant que celles-ci ont été approuvées par une AGOA tenue antérieurement à la distribution.
par Arnaud Reygrobellet, Professeur à l’Université Paris Nanterre - Avocat associé CMS Francis Lefebvre Avocats
Com. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-11.410
© Lefebvre Dalloz