Données issues de matériel biologique détaché : comparaison autorisée mais conservation prohibée
En cas d’impossibilité de réaliser un prélèvement sur un suspect, laquelle impossibilité peut être établie par tout moyen, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps. Toutefois, les données issues de l’identification ne pourront pas être conservées.
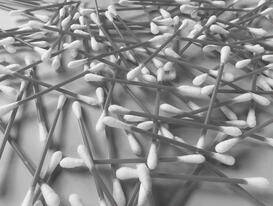
Dans cette affaire, un homme était soupçonné d’avoir incendié des véhicules stationnés sur le parking d’une caserne de gendarmerie. Les enquêteurs avaient pu recueillir du matériel biologique sur les lieux de l’infraction, mais ils ne pouvaient pas le relier au suspect, faute d’avoir établi son profil génétique. Le 15 novembre 2017, dans le cadre d’une information judiciaire, des officiers de police judiciaire ont passé un écouvillon sur les poignées de son vélo pour recueillir un peu de sueur. L’échantillon récolté a permis d’établir le profil génétique de l’individu, qui concordait avec les traces précédemment relevées. Le suspect a ensuite été placé en garde à vue. Au cours de la mesure, il a refusé de se soumettre à un prélèvement biologique et aux opérations de relevés signalétiques. Une perquisition a ensuite été réalisée à son domicile. Certains objets ont été saisis afin d’être exploités pour confirmer l’identification de son empreinte génétique.
Après avoir été mis en examen, l’homme a présenté une requête en nullité du prélèvement de matériel biologique sur sa bicyclette et des actes subséquents. Elle a été rejetée par un arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Limoges et le président de la chambre criminelle n’a pas fait droit à la demande d’examen immédiat du pourvoi. L’affaire a donc suivi son cours jusqu’à un jugement de condamnation par un tribunal correctionnel, le 17 mars 2023. En appel, le prévenu a notamment été condamné à trente mois d’emprisonnement sans sursis pour les faits de destruction de biens et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques. La confiscation des scellés a aussi été ordonnée à titre de peine. La Cour de cassation, en raison du refus d’examen immédiat, a eu à connaître d’un double pourvoi : l’un portant sur l’arrêt de la chambre de l’instruction et relatif à la validité des actes d’investigation, l’autre étant dirigé contre l’arrêt de la chambre correctionnelle et relatif aux peines prononcées.
Conditions de l’identification génétique à partir de matériel biologique détaché
Le Fichier national automatique des empreintes génétiques (FNAEG) est le système utilisé pour faire des rapprochements entre des traces retrouvées sur les lieux des infractions et des profils génétiques identifiés. D’un côté, il contient donc des empreintes génétiques non identifiées issues de traces biologiques retrouvées lors d’investigations relatives aux infractions listées à l’article 706-55 du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. R. 53-10, I, 1°) ou à une recherche des causes de la mort ou d’une disparition (C. pr. pén., art. R. 53-10, I, 1° bis). De l’autre, il contient des profils génétiques identifiés : ceux de personnes condamnées pour ces mêmes infractions (C. pr. pén., art. R. 53-10, II, 1°), de personnes déclarées irresponsables pénalement (C. pr. pén., art. R. 53-10, II, 2°), de personnes à l’encontre de qui il existe des indices graves ou concordants (C. pr. pén., art. R. 53-10, I, 2°), mais aussi de personnes disparues (C. pr. pén., art. R. 53-10, I, 4°). Le système fonctionne dans les deux sens : on peut ainsi rechercher si une trace non identifiée correspond à un profil génétique enregistré. Mais parfois, c’est l’inverse : une trace non identifiée est enregistrée et pour corroborer un soupçon, il est permis de comparer le profil génétique d’un suspect aux données inscrites dans le FNAEG (C. pr. pén., art. 706-54, al. 3). Le cas échéant, il faut être en mesure de réaliser le profil génétique. En principe, celui-ci est établi à partir de matériel biologique récupéré auprès de la personne concernée : on parle alors de prélèvement biologique. En cas d’impossibilité, le code de procédure pénale prévoit qu’il est possible de dresser le profil à partir de « matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé » (C. pr. pén., art. 706-56, al. 4) : sont ici visés les cheveux, les poils, les peaux mortes, mais aussi la salive, le sang ou encore la sueur.
Pour le pourvoi, la réalisation d’un profil génétique à partir de ce matériel biologique ne pouvait avoir lieu que si l’intéressé avait manifesté son refus de prélèvement dans la procédure en cours et qu’il était nécessaire de préalablement l’informer de l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il ajoute par ailleurs que l’objet support du dépôt de matériel biologique (en l’espèce, les poignées de vélos) devait avoir préalablement été saisi ou remis volontairement. Aucune des branches du premier moyen n’a convaincu les magistrats de la chambre criminelle. Après avoir repris le contenu de l’article 706-56 du code de procédure pénale, la Haute juridiction rappelle que l’examen du matériel biologique qui s’est détaché n’est possible qu’en cas d’impossibilité de réaliser le prélèvement, cette impossibilité pouvant être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l’intéressé dans la procédure en cours. Elle précise en outre que le prélèvement peut être réalisé sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors « qu’il n’en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes ».
Une des justifications du caractère subsidiaire de l’examen de matériel détaché au prélèvement lorsqu’il est question d’établir le profil génétique d’un suspect déjà identifié réside dans la fiabilité du processus. En effet, le matériel détaché peut se trouver sur un support déjà contaminé avec le matériel biologique d’un tiers. Pour autant, elle est parfois la seule solution pour établir un profil génétique. Hormis pour les infractions les plus graves (C. pr. pén., art. 706-56, al. 5), tout suspect peut refuser le prélèvement, même si, le cas échéant, il éveille des soupçons et engage sa responsabilité pénale (C. pr. pén., art. 706-56, II). Il arrive aussi que le suspect soit introuvable, ou en fuite, ou à l’étranger, dans un pays qui fait peu de cas des demandes de coopération judiciaire française. Aussi, face à la diversité des situations, il semble primordial que la possibilité de recourir à un examen d’éléments détachés ne soit pas cantonnée à la seule hypothèse d’un refus. L’avantage de cette solution est qu’elle permet de maintenir un effet de surprise dans certains cas particuliers. Le fait de demander à une personne l’autorisation d’effectuer un prélèvement lui permet de comprendre qu’elle est soupçonnée, ce qui peut engendrer des conséquences particulièrement néfastes. Étant donné que l’examen du matériel détaché n’est pas contradictoire et que, comme l’indique la Cour de cassation, aucun texte n’exige une notification préalable, il est donc possible de réaliser un profil génétique à l’insu d’un suspect, lorsque la nécessité l’exige. La Haute juridiction laisse les juges du fond souverainement apprécier de « l’impossibilité de procéder au prélèvement sur l’intéressé et de la nécessité d’identifier son empreinte génétique à son insu, au regard de la gravité des faits objet de l’enquête ou de l’information ». En l’espèce, la chambre de l’instruction avait estimé que les trois précédentes condamnations du suspect prononcées pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique caractérisaient l’impossibilité de se soumettre à un prélèvement. On peut ne pas être convaincu par cet argument, mais l’arrêt étant motivé et dépourvu de contradiction, la Cour de cassation a estimé que le moyen devait être écarté.
En indiquant que le matériel biologique pouvait être récupéré seulement si le procédé employé n’était ni douloureux, ni intrusif, ni attentatoire à la dignité des personnes, la Cour de cassation ajoute à la lettre de l’article 706-56 du code de procédure pénale. Pour les caractères douloureux ou intrusif, on voit mal comment ils pourraient être compatibles avec un détachement naturel ; les procédés visés étaient déjà exclus à ce titre. Mais l’ajout d’une référence à la dignité est particulièrement bienvenu, car on peut imaginer des hypothèses de détachement naturel dans des conditions dégradantes. Ce serait par exemple le cas si les conditions de privation de liberté tendent délibérément à provoquer miction ou sudation dans un but de récolte de matériel biologique. Il n’en reste pas moins que la Cour de cassation n’interdit pas de recourir à des stratagèmes, notamment en laissant fumer une personne entendue pour ensuite analyser le mégot (Crim. 30 avr. 1998, n° 98-80.741, RSC 2001. 607, obs. A. Giudicelli ![]() ).
).
Prohibition de l’enregistrement du profil génétique des simples suspects
Dans son second moyen, l’auteur du pourvoi relevait que le profil génétique qui avait été réalisé à partir du matériel biologique récolté sur les poignées de vélo avait fait l’objet d’un enregistrement au FNAEG. La chambre de l’instruction déniait la réalité de cet enregistrement, mais le pourvoi exprimait des doutes en raison des résultats du rapprochement des empreintes génétiques issues de sa brosse à dents avec les données incluses dans le FNAEG. Après vérification, la Cour de cassation a été en mesure d’établir que le profil génétique avait bien été transmis au FNAEG pour comparaison et enregistrement. Or, s’il est possible de réaliser une comparaison du profil d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, la conservation de ce profil est interdite. C’est ce que prévoit expressément le troisième alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale. La Cour de cassation ajoute que cette prohibition vaut aussi lorsque le profil a été établi à partir de matériel biologique s’étant naturellement détaché. On pourrait même dire que cette prohibition s’impose a fortiori, car lorsque le profil a été réalisé à partir de matériel détaché, le suspect n’est pas informé de son existence et n’est donc pas en mesure de demander l’effacement. La chambre de l’instruction aurait donc dû prononcer l’annulation de l’enregistrement au FNAEG du profil.
Toutefois, la Cour de cassation estime que l’arrêt n’encourt pas la censure, car cet enregistrement n’a pas été déterminant dans la construction du dossier. En effet, si l’enregistrement était irrégulier, le rapprochement était quant à lui tout à fait valable. Or, c’est au regard des résultats du rapprochement que les autres actes d’investigation ont été réalisés. De même, si les rapprochements effectués à partir du matériel biologique prélevé lors de la perquisition du domicile du mis en cause ont fait état du profil indûment enregistré, il conduisait avant tout à établir une correspondance avec le profil génétique non identifié réalisé à partir des éléments retrouvés sur les lieux de l’infraction, qui pouvaient être valablement conservés au FNAEG. En dépit du défaut de cassation, l’enregistrement du profil était illicite. Si le mis en cause veut qu’il soit supprimé, il doit en faire la demande au procureur de la République, qui a un pouvoir d’ordonner l’effacement des données inscrites dans le fichier (C. pr. pén., art. 706-54-1 et R. 53-14-2). Le texte ne vise toutefois pas l’hypothèse d’une conservation irrégulière des données, contrairement à l’article R. 53-17 du code de procédure pénale, qui dispose que le magistrat chargé du contrôle du FNAEG à l’échelle nationale peut ordonner l’effacement d’enregistrements illicites. Toutefois, les dispositions réglementaires du code de procédure pénale ne prévoient pas de possibilité de saisine de ce magistrat hors hiérarchie par les justiciables. Mieux vaut donc privilégier une demande adressée au procureur de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure. La réécriture du code de procédure pénale à venir pourrait être l’occasion de clarifier ce point.
Régime des peines d’emprisonnement et de confiscation
Après avoir été renvoyé en jugement, le prévenu a été condamné à trente mois d’emprisonnement sans sursis pour les faits de destruction de biens et refus de se soumettre aux relevés signalétiques. Or, le prévenu avait déjà effectué une détention provisoire de vingt-deux mois et vingt-et-un jours. Étant donné que la durée de la détention provisoire doit être déduite de la peine d’emprisonnement prononcée (C. pr. pén., art. 716-4), y compris pour apprécier les seuils prévus en matière d’aménagement de peine (C. pr. pén., art. D. 48-1-1), il restait donc moins de huit mois à accomplir, ce qui correspond à une courte peine d’emprisonnement, soumise à un régime spécial. Pour les peines de moins de deux ans d’emprisonnement ferme, ou, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, pour les faits commis depuis le 24 mars 2020 (Crim. 20 oct. 2020, n° 19-84.754, Dalloz actualité, 19 nov. 2020, obs. J. Gallois ; D. 2020. 2379 ![]() , note S. Pellé
, note S. Pellé ![]() ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ![]() ; AJ pénal 2020. 514, note M. Herzog-Evans
; AJ pénal 2020. 514, note M. Herzog-Evans ![]() ) ayant entraîné une condamnation à une peine de moins d’un an d’emprisonnement ferme, la peine doit en principe être aménagée ab initio, et le refus d’aménagement doit être motivé de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. En l’espèce, les juges du fond ne s’étant pas prononcés sur le caractère aménageable de la peine restant à exécuter, la cassation était inévitable. Eu égard à la date des faits, c’est le droit ancien qui s’appliquait, mais la solution aurait été la même en droit positif.
) ayant entraîné une condamnation à une peine de moins d’un an d’emprisonnement ferme, la peine doit en principe être aménagée ab initio, et le refus d’aménagement doit être motivé de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. En l’espèce, les juges du fond ne s’étant pas prononcés sur le caractère aménageable de la peine restant à exécuter, la cassation était inévitable. Eu égard à la date des faits, c’est le droit ancien qui s’appliquait, mais la solution aurait été la même en droit positif.
Les juges du fond avaient aussi condamné le prévenu à la confiscation de scellés, à savoir des biens saisis à son domicile au cours des investigations. La peine de confiscation ne peut être prononcée que pour des biens répondant aux conditions de l’article 131-21 du code pénal. Le deuxième alinéa de ce texte dispose que les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre peuvent être confisqués. En l’espèce, c’est au regard de ce critère que la cour d’appel avait prononcé la confiscation des scellés. Toutefois, elle n’avait pas détaillé pour chaque objet confisqué en quoi il constituait l’instrument de l’infraction. L’appréciation « en bloc » étant proscrite, la cassation était encore encourue. On peut relever que pour les ordinateurs, les juges avaient motivé la confiscation en indiquant qu’ils étaient des pièces à conviction essentielles, que leur cryptage s’opposait à la consultation des données qu’ils contenaient, mais qu’il pourrait s’agir d’informations importantes. Cette motivation, si elle insiste sur le caractère de pièce à conviction des ordinateurs, pour des affaires passées ou à venir, ne démontre en rien leur qualité d’instrument de l’infraction jugée.
Crim. 30 sept. 2025, F-B, n° 19-80.581
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
© Lefebvre Dalloz