Faute de l’architecte entrepreneur puis annulation de la règle d’urbanisme enfreinte : appréciation à la date d’exécution de sa mission
La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.
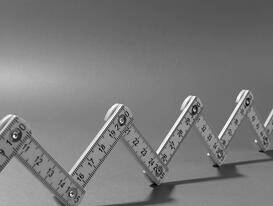
Tout en réévaluant à la baisse le montant de l’indemnisation du maître d’ouvrage pour faute du maître d’œuvre sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, l’arrêt sous étude précise le champ d’application de l’obligation qu’a l’architecte de se fonder uniquement sur les règles urbanistiques en vigueur au moment de la mise en œuvre de son contrat.
Responsabilité du maître d’œuvre engagée en appel
Dans une décision rendue sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-10.021), la Cour d’appel de Rennes (Rennes, 5 avr. 2022, n° 21/05531) a condamné un maître d’œuvre (M. [F.]) à payer 50 000 € de dommages et intérêts à son maître d’ouvrage (Mme [T.]). En effet, le géomètre-expert s’était vu confier une mission incluant le dépôt d’une demande de permis d’aménager un lotissement, ainsi que la maîtrise d’œuvre des VRD jusqu’à réception.
Le contrat prévoyait que les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées, et, de son côté, le plan d’occupation des sols (POS) en vigueur indiquait que le coefficient maximal d’emprise au sol devait être calculé sur la surface de chaque lot et non sur la surface totale.
En 2007, le maître d’œuvre a obtenu son autorisation d’aménager pour six lots prévoyant un calcul différent pour chacun d’eux et donnant lieu à l’exécution des travaux de viabilité.
Le maître d’ouvrage a ensuite confié la commercialisation des lots à différentes agences. Cependant, il en a justifié les difficultés de vente par une faute de son maître d’œuvre dans le calcul de l’emprise au sol maximale des constructions, entraînant la résiliation du contrat par ses soins. Sollicitant alors un autre géomètre-expert, Mme T. a obtenu un permis d’aménager modificatif qui permettait d’augmenter les surfaces d’emprise au sol.
Dès lors M. F., qui l’avait assignée en paiement de ses honoraires, reproche à la cour d’appel d’engager sa responsabilité à la suite de la demande reconventionnelle de réparation du préjudice de Mme T. résultant du retard de commercialisation de ses lots.
Il se pourvoit en cassation, soutenant d’une part que l’annulation ultérieure de la disposition du POS enfreinte suffisait à écarter l’existence d’une faute et, d’autre part que la mise à la charge du débiteur (lui-même) d’une somme excédant la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue a entraîné la violation de l’ancien article 1147 du code civil.
Primauté du respect des clauses contractuelles au détriment de la légalité du document d’urbanisme
Dans un premier temps et par la décision sous étude, le juge du droit s’aligne sur l’arrêt de la cour d’appel. Il lui incombe alors de déterminer le moment auquel il faut apprécier la faute du géomètre dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles ; il commence donc par souligner le manquement à ces dernières.
Selon lui, l’architecte « s’était engagé à concevoir un projet qui épuise au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées » il est ainsi « chargé contractuellement d’établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d’urbanisme ».
Cela lui interdit de se fonder, sans l’accord de son cocontractant, sur d’autres règles d’urbanisme que celles en vigueur au moment de l’exécution du contrat, quand bien même le principe énonce qu’il appartient à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal.
Qualification de l’existence de la faute du géomètre au moment des faits
En outre, les juges de cassation suivent ceux du second degré et retiennent que la demande d’autorisation établie par le maître d’œuvre n’était pas en accord avec l’obligation contractuelle mentionnée supra, en ce qu’à la date à laquelle elle avait été déposée, le POS « permettait de calculer le coefficient d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir ».
En l’espèce, l’article du POS était en vigueur au moment du dépôt du permis d’aménager et le géomètre en a fait une mauvaise application : la violation est qualifiée malgré l’annulation postérieure de la disposition litigieuse qui permettait le calcul. Certes, une fois l’article annulé, la faute n’aurait pas pu être caractérisée, mais il faut l’apprécier à la date à laquelle elle a été commise : tel est le raisonnement de la troisième chambre civile.
Par conséquent, la mauvaise application de documents d’urbanisme pourtant illégaux donne tout de même lieu à l’engagement de la responsabilité d’un maître d’œuvre, et dès lors, au versement de dommages et intérêts en vertu de l’ancien article 1147 du code civil. Si elle rejette la demande du requérant concernant la faute, la Cour censure en revanche le montant de 50 000 € fixé en appel.
Révision du montant de l’indemnisation du maître d’ouvrage réalisée en cassation
Par ailleurs, dans cet arrêt de cassation partielle, la Haute juridiction précise, sans renvoi, la façon dont il faut appliquer aux circonstances d’espèce l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Elle détaille ainsi le processus de calcul du montant des dommages-intérêts que le maître d’œuvre aurait dû verser au maître d’ouvrage.
Selon les juges du quai de l’Horloge, la somme mise à la charge du débiteur en appel excède la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue en méconnaissance des dispositions de l’article 1147 susmentionné. De ce fait, si l’architecte n’avait pas commis de faute dans la détermination des surfaces d’emprise au sol, le maître d’ouvrage aurait eu 40 % de chance d’échapper à la perte de 72 200 €. De cette manière, la somme due par le maître d’œuvre à titre d’indemnisation s’élève, non pas à 50 000, mais à 28 880 €.
Dans le cas étudié, le dommage de Mme T est reconnu, la réparation doit toutefois être égale à l’intégralité du préjudice, sans jamais pouvoir la dépasser (Civ. 2e, 28 oct. 1954 P, RTD civ. 1955. 324, obs. H. Mazeaud et L. Mazeaud ; JCP 1955. II. 8765, note R. Savatier). La solution rapportée infirme donc l’arrêt des juges du second degré uniquement eu égard au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, permettant d’éviter un enrichissement sans cause (v. par ex., Civ. 3e, 27 mars 2012, n° 11-11.798, RDI 2012. 352, obs. P. Malinvaud ![]() ; Crim. 1er sept. 2015, n° 14-84.353, Dalloz actualité, 22 sept. 2015, obs. J. Gallois ; RDI 2015. 533, obs. G. Roujou de Boubée
; Crim. 1er sept. 2015, n° 14-84.353, Dalloz actualité, 22 sept. 2015, obs. J. Gallois ; RDI 2015. 533, obs. G. Roujou de Boubée ![]() ; AJ pénal 2015. 614, obs. R. Leost
; AJ pénal 2015. 614, obs. R. Leost ![]() ; RSC 2015. 872, obs. J.-H. Robert
; RSC 2015. 872, obs. J.-H. Robert ![]() ).
).
Partage des responsabilités opéré par la Haute juridiction
Certes, la troisième chambre civile semble rationaliser la responsabilité du géomètre en allégeant le montant de la somme due à la victime, mais sa faute est tout de même caractérisée. Le maître d’ouvrage a subi un retard dans l’élaboration de son projet, et il en va de protéger ses intérêts afin d’équilibrer sa relation contractuelle avec l’entrepreneur. Celui-ci est un professionnel dont l’expertise outrepasse de loin les connaissances de la majorité des pétitionnaires, généralement profanes.
Cela expliquerait pourquoi, quand bien même l’article du document d’urbanisme appliqué lors de la conception du projet d’aménagement a été annulé postérieurement, cet architecte a tout de même vu sa responsabilité engagée.
En définitive et à travers cet arrêt, les juges procèdent à une piqûre de rappel : il est primordial pour les maîtres d’œuvre d’être attentifs aux normes urbanistiques en vigueur au moment de l’accomplissement de leurs obligations contractuelles, ce, quand bien même ces règles viendraient à devenir illégales.
Civ. 3e, 4 avr. 2024, FS-B, n° 22-18.509
© Lefebvre Dalloz