Fixation de la durée d’une délégation de service public regroupant des services différents
Le Conseil d’État précise, dans un arrêt publié au Lebon, les modalités de fixation de la durée d’une délégation de service public portant sur plusieurs services. Il affirme également que le juge du fond peut rejeter implicitement une demande de médiation, celle-ci n’étant qu’une faculté pour le juge.
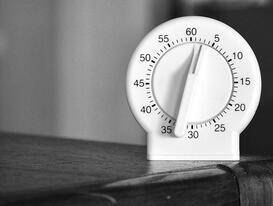
Si une autorité délégante peut regrouper au sein d’un même contrat ou ensemble contractuel des services différents, ce choix ne l’autorise à déroger aux règles de dévolution et d’exploitation de ces services, juge le Conseil d’État. La commune de Béthune avait conclu quatre contrats avec une seule société : un contrat de délégation du service public du stationnement sur voirie, un contrat de concession pour la construction et l’exploitation d’un parc public de stationnement souterrain sous la Grand’Place de la ville, un contrat d’affermage pour la rénovation et l’exploitation du parc public de stationnement souterrain « Georges Clemenceau » et enfin un quatrième contrat dit « commun » comportant des stipulations applicables à l’ensemble de ces contrats. Saisi par la commune d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai rejetant la demande d’annulation de ces contrats, le Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de sa jurisprudence Communauté urbaine du Grand Dijon (CE 21 sept. 2016, n° 399656, Dalloz actualité, 28 sept. 2016, obs. D. Poupeau ; Lebon ![]() ; AJDA 2017. 359
; AJDA 2017. 359 ![]() , note M. Douence
, note M. Douence ![]() ; ibid. 2016. 1775
; ibid. 2016. 1775 ![]() ; AJCT 2017. 47, obs. P. Grimaud et Olivier Villemagne
; AJCT 2017. 47, obs. P. Grimaud et Olivier Villemagne ![]() ; AJ contrat 2016. 494, obs. F. Lepron
; AJ contrat 2016. 494, obs. F. Lepron ![]() ) et juge qu’« aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts ». Celle-ci ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, « donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux ».
) et juge qu’« aucune disposition législative ni aucun principe n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts ». Celle-ci ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, « donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux ».
Cohérence de l’ensemble contractuel
Ainsi, s’il est loisible à l’autorité délégante de regrouper au sein d’un même contrat ou d’un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique, « un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services ». En particulier, il ne peut conduire à méconnaître les dispositions liées à la durée du contrat de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (repris aujourd’hui par CCP, art. R. 3114-1 et 2) dont la portée a déjà été précisée par la Haute juridiction (CE 8 févr. 2010, Commune de Chartres, n° 323158, Lebon ![]() ; AJDA 2010. 240
; AJDA 2010. 240 ![]() ; 31 oct. 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995, Dalloz actualité, 25 nov. 2024, obs. N. Mariappa ; Lebon
; 31 oct. 2024, Commune de Fontainebleau, n° 487995, Dalloz actualité, 25 nov. 2024, obs. N. Mariappa ; Lebon ![]() ; AJDA 2024. 2041
; AJDA 2024. 2041 ![]() ; JT 2025, n° 282, p. 11, obs. C. Devès
; JT 2025, n° 282, p. 11, obs. C. Devès ![]() ). La durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut donc, sauf à méconnaître ces dispositions, « excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers ».
). La durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut donc, sauf à méconnaître ces dispositions, « excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers ».
Le Conseil d’État précise, dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n’apparaît pas justifiée pour chacun d’entre eux, qu’une telle durée unique « ne peut alors être valablement prévue que si l’exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers ».
En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai a retenu que les quatre contrats en litige ont fait l’objet d’une même procédure de passation, ont été conclus à la même date pour une même durée et poursuivent le même objectif de répondre à un besoin de la commune en matière de stationnement, visant à atteindre un équilibre économique tenant compte de façon globale des investissements, des recettes et des charges prévisionnelles de toutes les activités liées au stationnement, sur la voirie et dans les parcs souterrains. En jugeant ainsi qu’ils formaient un ensemble contractuel indissociable, la cour a, sans erreur de droit, exactement qualifié les faits de l’espèce. De plus, pour apprécier si ces contrats avaient pu être valablement conclus pour une durée unique de trente ans, la cour, devant laquelle il n’était pas sérieusement contesté que l’exploitation conjointe des trois services répondait à des objectifs de bonne gestion, a recherché si cette durée unique pouvait être regardée comme n’excédant pas la durée normale d’amortissement de l’ensemble des investissements mis à la charge du délégataire dans le cadre de l’ensemble contractuel portant sur le stationnement sur la voirie et dans les parcs. Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur de droit. Le Conseil d’État précise également que l’appréciation du caractère excessif de la durée de la délégation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le recours à la médiation ne s’impose pas au juge
Par ailleurs, le Conseil d’État apporte des précisions sur les conditions de recours à la médiation en matière administrative. Il affirme ainsi que, si les dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative donnent au juge administratif, saisi d’un litige, la faculté d’ordonner, avec l’accord des parties, une médiation entre elles dans le but de parvenir à un accord sur le règlement du litige, « elles ne l’obligent nullement à engager une telle procédure alors même que les parties le lui demanderaient ». En ne donnant pas suite à une demande en ce sens, le juge la rejette nécessairement, sans être tenu d’y répondre explicitement. Cette appréciation est insusceptible d’être discutée en cassation.
CE 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664
© Lefebvre Dalloz