Garantie des accidents de la vie : tout est une question d’intérêt
Le régulateur constate, au sujet des contrats Garanties accidents de la vie, que l’information transmise aux assurés lors de la phase précontractuelle puis d’indemnisation manque de clarté, et que les restrictions apportées au périmètre du contrat altèrent significativement son intérêt pour l’assuré. De quoi nourrir un important contentieux.
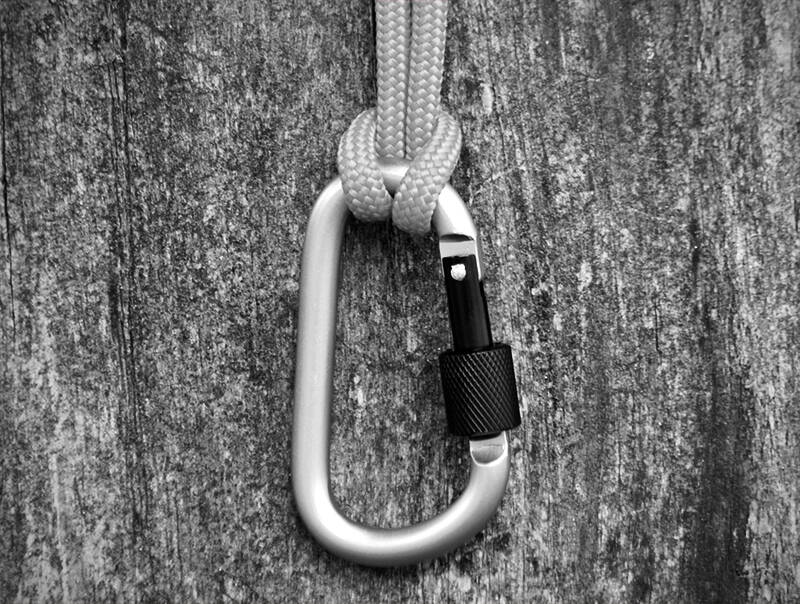
C’est en mai 2000 que la Fédération française des sociétés d’assurance, devenue Fédération française de l’assurance (FFA), élaborait, sur le modèle du contrat d’assurance individuelle de type indemnitaire, le contrat « Garanties accidents de la vie » (GAV). Inspiré de la possibilité offerte par l’article L. 211-25 du code des assurances (art. 33, al. 3, de la loi n° 85-677 du 5 juill. 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, dite « Badinter ») de garantir le dommage non-imputable à une tierce personne identifiée, le contrat GAV s’impose comme un nouveau contrat-socle, permettant à l’assureur de proposer à son assuré des conditions personnalisées de couverture (J. Péchinot, La garantie des accidents de la vie, RCA n° 5, 2000, chron. n° 10 ; G. Thiry, Garantie des accidentés de la vie, Gaz. Pal. 2001, n° 216, p. 2).
Le contrat GAV a pour objet d’indemniser tout accident (c’est-à-dire un événement à caractère fortuit, v. Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 21-22.319 FS-B, Dalloz actualité, 2 avr. 2024, obs. R. Bigot et A. Cayol ; D. 2024. 356 ![]() ; 9 févr. 2023, n° 21-17.681 FS-B, Dalloz actualité, 10 mars 2023, obs. V. Roulet ; D. 2023. 1061
; 9 févr. 2023, n° 21-17.681 FS-B, Dalloz actualité, 10 mars 2023, obs. V. Roulet ; D. 2023. 1061 ![]() , note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia
, note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ![]() ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre
; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ![]() ; Bordeaux, 1re ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/03335 ; Toulouse, 3e ch., 5 avr. 2023, n° 21/04986) de la vie courante survenu dans le cadre de la vie privée de l’assuré, que l’article L. 1171-2 du code de la santé publique définit comme « l’ensemble des traumatismes non intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents du travail ». Le contrat GAV ajoute à ces deux exclusions de principe les dommages résultant des expérimentations biomédicales ou les dommages intentionnellement causés par l’assuré. Il conduit en principe à l’indemnisation des préjudices dont est victime l’assuré âgé de moins de soixante-cinq ans, lorsque l’accident entraîne son décès ou que le taux d’incapacité permanente partielle (dite « IPP ») imputable à l’accident est au moins égal à 30 %, dans la limite d’un million d’euros.
; Bordeaux, 1re ch. civ., 14 déc. 2023, n° 21/03335 ; Toulouse, 3e ch., 5 avr. 2023, n° 21/04986) de la vie courante survenu dans le cadre de la vie privée de l’assuré, que l’article L. 1171-2 du code de la santé publique définit comme « l’ensemble des traumatismes non intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents du travail ». Le contrat GAV ajoute à ces deux exclusions de principe les dommages résultant des expérimentations biomédicales ou les dommages intentionnellement causés par l’assuré. Il conduit en principe à l’indemnisation des préjudices dont est victime l’assuré âgé de moins de soixante-cinq ans, lorsque l’accident entraîne son décès ou que le taux d’incapacité permanente partielle (dite « IPP ») imputable à l’accident est au moins égal à 30 %, dans la limite d’un million d’euros.
En réalité, les assureurs sont libres d’aménager ces contrats comme ils l’entendent et s’en tiennent rarement à ce socle. Le périmètre de couverture, le taux d’IPP requis et les conditions tenant à l’âge de la victime sont variables, ce qui complexifie le travail de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Pourtant c’est sans doute la raison pour laquelle, après s’être longtemps fait attendre (L. Leveneur et Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, n° 1132, p. 892) le succès du contrat GAV s’est confirmé en 2022 à l’aune des trente millions de contrats alors souscrits sur le marché français.
C’est dans ce contexte et au regard d’un contentieux fleuve que l’ACPR s’est donnée pour mission de vérifier la bonne application des dispositions transposées issues de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance (dite « directive DA »), entrée en vigueur le 1er octobre 2018, à la commercialisation du contrat GAV.
Les conclusions du régulateur semblent principalement s’articuler autour de deux axes, chacun se subdivisant en deux branches, avec pour préoccupation centrale l’intérêt de l’assuré.
Information et accompagnement de l’assuré
En ce qui concerne d’abord l’accompagnement de l’assuré, l’ACPR relève qu’au stade de la conclusion du contrat, ce dernier ne dispose pas d’un niveau d’information suffisant pour lui permettre de comprendre ce à quoi correspondent le seuil de prise en charge et les situations couvertes par le contrat. Il s’agit pourtant d’un impératif posé par l’article 20 de la directive DA, aux termes desquels l’assureur doit, dans le cadre de son devoir de conseil, « précise[r], sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fourni[r] au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». Si cet impératif est primordial pour le futur assuré, il l’est aussi pour l’assureur, sur qui pèse le devoir de s’assurer que la distribution du contrat concerné correspond à sa politique de gouvernance et de surveillance des produits, imposée par les articles 29 et 30 de la directive DA.
Au stade de l’exécution du contrat, l’ACPR estime que l’accompagnement de l’assuré est insuffisant, dans la mesure où il « ne dispose pas du même niveau de connaissance et d’information que l’assureur ». Elle semble tant faire référence au devoir de compétence que l’article 10 de la directive DA fait peser sur tout distributeur de produit d’assurance, qu’au devoir plus général de bonne foi contractuelle qu’abrite l’article 1104 du code civil. L’assureur doit à ce titre informer correctement l’assuré lors de la phase d’indemnisation prévue par le contrat GAV (v. par ex., Lyon, 1re ch. civ. B, 6 févr. 2024, n° 22/01815).
Périmètre de couverture du contrat
En ce qui concerne le périmètre de couverture du contrat, l’ACPR pointe le manque de clarté de certaines restrictions de garanties, lesquelles ne sont pas nécessairement mentionnées au contrat et « quantifiées de façon objective et justifiée », notamment lorsqu’elles font référence à un état antérieur ou à une pathologie. Il s’agit pourtant de la source d’un abondant contentieux (v. par ex., Bordeaux, 1re ch. civ., 31 mai 2024 n° 21/06581 ; Nancy, 1re ch., 25 mars 2024, n° 23/01940 ; Pau, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 21/04028).
Quant, enfin, à l’âge de l’assuré, le régulateur constate une certaine cohérence entre les différents contrats GAV, lesquels ont pour « caractéristique commune de réduire, voire de supprimer certaines prestations lorsque l’assuré atteint un certain âge, 65 ans ou plus dans la plupart des cas ». Il n’y a rien d’étonnant à cela dans la mesure où cette particularité était prévue par le contrat-socle élaboré par la FFA. En revanche, de la même manière qu’il doit informer son client sur tous les aspects de leur relation d’assurance, l’assureur est tenu d’informer clairement son assuré à ce sujet. Le régulateur conseille à cet effet l’envoi d’une « information spécifique lors de l’envoi de l’avis d’échéance lorsque l’assuré atteint les âges concernés ». C’est exactement ce que suggère le 5° de l’article 30 de la directive DA, lequel prévoit que les « informations adéquates » que l’assureur doit à son client « sur le service fourni », « consistent notamment en des communications périodiques à ses clients », et « tiennent compte du type et de la complexité des produits d’investissement fondés sur l’assurance concernés et de la nature des services fournis au client ».
Forts de ces conclusions, les assureurs sont mieux armés pour perfectionner leurs contrats et faire taire un contentieux dont la prolifération est tout sauf de leur intérêt.
ACPR, Enseignements des contrôles menés sur les contrats Garanties accidents de la vie, juill. 2024
© Lefebvre Dalloz