GPA : absence de contrariété à l’ordre public substantiel d’une décision étrangère établissant la filiation à l’égard de la mère d’intention qui n’est pas la mère biologique
La Cour de cassation apporte une nouvelle pierre à l’édifice de sa jurisprudence relative aux conditions de régularité des jugements étrangers établissant des liens de filiation pris dans le cadre des conventions de mère porteuse conclues à l’étranger. L’absence de lien biologique entre l’enfant et la mère d’intention ne heurte pas l’ordre public international français.
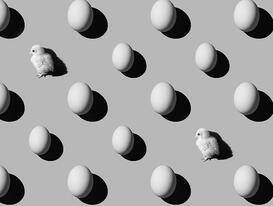
Madame S. a conclu avec Madame U. une convention de gestation pour autrui au Canada. L’enfant, né le 8 décembre 2019, a été conçu avec les gamètes de deux tiers donneurs. Une décision de la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique du 1er février 2021 a affirmé que Madame S. était le seul parent de l’enfant et qu’elle détiendra sa garde exclusive et l’ensemble des droits parentaux à son égard. La mère d’intention a ensuite assigné le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produirait les effets d’une adoption plénière. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 avril 2023, confirme la décision des premiers juges et accède aux demandes de la mère d’intention. L’arrêt déclare exécutoire l’ordonnance canadienne ayant établi la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention et dit que la décision produira en France les effets d’une adoption plénière.
Le procureur forme alors un pourvoi en cassation. Il estime que, eu égard à l’article 16-7 du code civil qui prohibe la gestation pour autrui en droit français, une décision étrangère consacrant la filiation d’un enfant né à la suite d’une convention de gestation pour autrui à l’égard d’une personne n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant n’est pas conforme à l’ordre public international français. Par ailleurs, le procureur estime qu’en considérant que l’exequatur de l’ordonnance canadienne produira les effets d’une adoption plénière en France, la cour d’appel a procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé l’article 509 du code de procédure civile.
Après avoir visé l’article 509 du code de procédure civile, la Cour rappelle de façon pédagogique que « pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement ».
La Cour de cassation répond ensuite en deux temps à la question de savoir si un jugement étranger qui établit la filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui à l’égard d’une personne n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant se heurte à l’ordre public international français. Elle rappelle d’abord qu’eu égard à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, la circonstance que l’enfant soit né d’une gestation pour autrui ne peut à elle seule faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger tant à l’égard du parent biologique qu’à l’égard du parent d’intention. Elle démontre ensuite qu’aucun principe essentiel du droit français n’interdit la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique. Vérifiant ensuite minutieusement l’examen des conditions de régularité de la décision canadienne opérée par la cour d’appel, la Cour de cassation en confirme l’analyse et retient à son tour que les conditions de l’exequatur sont réunies.
En revanche, en ce qui concerne les effets à accorder au jugement revêtu de l’exequatur, elle accueille le moyen du procureur : la décision revêtue de l’exequatur n’étant pas un jugement d’adoption, elle ne saurait produire en France, les effets d’une adoption plénière. La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe qu’elle a elle-même posé quelques semaines auparavant (v. Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 23-50.002, Dalloz actualité, 18 oct. 2024, obs. A. Panet-Marre ; AJ fam. 2024. 485, édito. V. Avena-Robardet ![]() ) casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il dit que l’ordonnance canadienne produira en France les effets d’une adoption plénière. Elle dit n’y avoir lieu à renvoi : la filiation sera reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
) casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il dit que l’ordonnance canadienne produira en France les effets d’une adoption plénière. Elle dit n’y avoir lieu à renvoi : la filiation sera reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.
Deux aspects nous intéresseront pour cette brève analyse de la solution : la question de la contrariété à l’ordre public international, de fond comme de procédure, ainsi que les effets qu’il convient d’accorder à un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui revêtu de l’exequatur.
La décision paraît faussement libérale, et nul doute qu’une partie de la doctrine ne manquera pas de s’en émouvoir. Pourtant, tant par son apport que par ses confirmations, elle ne fait qu’adopter une position équilibrée et respectueuse du droit positif français et des droits fondamentaux, sans pour autant donner son blanc-seing à l’accueil des gestations pour autrui conclues à l’étranger.
Un apport
La Cour de cassation rappelle d’abord que le recours à une gestation pour autrui ne suffit pas à elle seule à faire échec à la reconnaissance du jugement étranger avant d’affirmer que l’existence ou non d’un lien biologique entre l’enfant et son parent d’intention est sans incidence à cet égard.
L’absence de contrariété à l’ordre public international français de la gestation pour autrui pratiqué à l’étranger ?
Qu’il nous soit pardonné, pour la clarté de l’analyse, de revenir sur des éléments bien connus en la matière. La gestation pour autrui est explicitement condamnée dans son principe depuis l’arrêt de l’assemblée plénière du 31 mai 1991 (Cass., ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105, D. 1991. 417 ![]() , rapp. Y. Chartier
, rapp. Y. Chartier ![]() ; ibid. 318, obs. J.-L. Aubert
; ibid. 318, obs. J.-L. Aubert ![]() , note D. Thouvenin
, note D. Thouvenin ![]() ; ibid. 1992. 59, obs. F. Dekeuwer-Défossez
; ibid. 1992. 59, obs. F. Dekeuwer-Défossez ![]() ; RFDA 1991. 395, étude M. Long
; RFDA 1991. 395, étude M. Long ![]() ; Rev. crit. DIP 1991. 711, note C. Labrusse-Riou
; Rev. crit. DIP 1991. 711, note C. Labrusse-Riou ![]() ; RTD civ. 1991. 517, obs. D. Huet-Weiller
; RTD civ. 1991. 517, obs. D. Huet-Weiller ![]() ; ibid. 1992. 88, obs. J. Mestre
; ibid. 1992. 88, obs. J. Mestre ![]() ; ibid. 489, étude M. Gobert
; ibid. 489, étude M. Gobert ![]() ). La solution a ensuite été codifiée en 1994 à l’article 16-7 du code civil, qui prohibe clairement les conventions de gestation pour autrui, et le législateur ne s’est pas aventuré à remettre en cause cette interdiction dans la dernière réforme des lois bioéthiques de 2021. La vigueur du principe de l’indisponibilité du corps humain en droit français conduit à frapper de nullité absolue les conventions de mère porteuse.
). La solution a ensuite été codifiée en 1994 à l’article 16-7 du code civil, qui prohibe clairement les conventions de gestation pour autrui, et le législateur ne s’est pas aventuré à remettre en cause cette interdiction dans la dernière réforme des lois bioéthiques de 2021. La vigueur du principe de l’indisponibilité du corps humain en droit français conduit à frapper de nullité absolue les conventions de mère porteuse.
Incontestablement, dans l’ordre juridique interne, la gestation pour autrui contrevient à l’ordre public.
Pour autant, faut-il en conclure que la pratique des mères porteuses heurte l’ordre public français en matière international, dont on sait qu’il est plus resserré que notre ordre public interne ?
Dans un premier temps la Cour de cassation, avait retenu la contrariété à l’ordre public international français des gestations pour autrui, notamment dans les très célèbres arrêts Mennesson et Labassée (Civ. 1re, 6 avr. 2011, nos 09-66.486 et 10-19.053, Dalloz actualité, 14 avr. 2011, obs. C. Siffrein-Blanc ; D. 2011. 1522 ![]() , note D. Berthiau et L. Brunet
, note D. Berthiau et L. Brunet ![]() ; ibid. 1001, édito. F. Rome
; ibid. 1001, édito. F. Rome ![]() ; ibid. 1064, entretien X. Labbée
; ibid. 1064, entretien X. Labbée ![]() ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts
; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ![]() ; ibid. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ![]() ; ibid. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ![]() ; AJ fam. 2011. 262
; AJ fam. 2011. 262 ![]() ; ibid. 265, obs. B. Haftel
; ibid. 265, obs. B. Haftel ![]() ; ibid. 266, interview M. Domingo
; ibid. 266, interview M. Domingo ![]() ; AJCT 2011. 301, obs. C. Siffrein-Blanc
; AJCT 2011. 301, obs. C. Siffrein-Blanc ![]() ; RTD civ. 2011. 340, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2011. 340, obs. J. Hauser ![]() ) : « Est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision, lorsque cette dernière heurte des principes essentiels du droit français ». Cette position a conduit à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014 (CEDH 26 juin 2014, n° 65941/11, Dalloz actualité, 30 juin 2014, obs. T. Coustet ; AJDA 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen
) : « Est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision, lorsque cette dernière heurte des principes essentiels du droit français ». Cette position a conduit à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014 (CEDH 26 juin 2014, n° 65941/11, Dalloz actualité, 30 juin 2014, obs. T. Coustet ; AJDA 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ![]() ; D. 2014. 1797, et les obs.
; D. 2014. 1797, et les obs. ![]() , note F. Chénedé
, note F. Chénedé ![]() ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ![]() ; ibid. 1806, note L. d’Avout
; ibid. 1806, note L. d’Avout ![]() ; ibid. 2015. 702, obs. F. Granet-Lambrechts
; ibid. 2015. 702, obs. F. Granet-Lambrechts ![]() ; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 755, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; ibid. 1007, obs. REGINE
; ibid. 1007, obs. REGINE ![]() ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ![]() ; AJ fam. 2014. 499
; AJ fam. 2014. 499 ![]() ; ibid. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; ibid. 396, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ; Rev. crit. DIP 2015. 1, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon
; Rev. crit. DIP 2015. 1, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ![]() ; RTD civ. 2014. 616, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2014. 616, obs. J. Hauser ![]() ; ibid. 835, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 835, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ). Les juges de Strasbourg avaient en effet estimé que l’article 8 de la convention avait été violé en ce que le droit au respect de la vie privée de l’enfant, particulièrement sur le droit d’établir la substance de son identité, y compris sa filiation. Par un remarqué arrêt d’assemblée plénière du 4 octobre 2019 (Cass., ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 P+B+R+I, Dalloz actualité, 8 oct. 2019, obs. T. Coustet ; D. 2019. 2228, et les obs.
). Les juges de Strasbourg avaient en effet estimé que l’article 8 de la convention avait été violé en ce que le droit au respect de la vie privée de l’enfant, particulièrement sur le droit d’établir la substance de son identité, y compris sa filiation. Par un remarqué arrêt d’assemblée plénière du 4 octobre 2019 (Cass., ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 P+B+R+I, Dalloz actualité, 8 oct. 2019, obs. T. Coustet ; D. 2019. 2228, et les obs. ![]() , note H. Fulchiron et C. Bidaud
, note H. Fulchiron et C. Bidaud ![]() ; ibid. 1985, édito. G. Loiseau
; ibid. 1985, édito. G. Loiseau ![]() ; ibid. 2000, point de vue J. Guillaumé
; ibid. 2000, point de vue J. Guillaumé ![]() ; ibid. 2423, point de vue T. Perroud
; ibid. 2423, point de vue T. Perroud ![]() ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ![]() ; ibid. 677, obs. P. Hilt
; ibid. 677, obs. P. Hilt ![]() ; ibid. 843, obs. RÉGINE
; ibid. 843, obs. RÉGINE ![]() ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 1696, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 1696, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ![]() ; JA 2019, n° 610, p. 11, obs. X. Delpech
; JA 2019, n° 610, p. 11, obs. X. Delpech ![]() ; AJ fam. 2019. 592, obs. J. Houssier
; AJ fam. 2019. 592, obs. J. Houssier ![]() , obs. G. Kessler
, obs. G. Kessler ![]() ; ibid. 481, point de vue L. Brunet
; ibid. 481, point de vue L. Brunet ![]() ; ibid. 487, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; ibid. 487, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ; RTD civ. 2019. 817, obs. J.-P. Marguénaud
; RTD civ. 2019. 817, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ; ibid. 841, obs. A.-M. Leroyer
; ibid. 841, obs. A.-M. Leroyer ![]() ; ibid. 2020. 459, obs. N. Cayrol
; ibid. 2020. 459, obs. N. Cayrol ![]() ), la Cour de cassation clôturait la saga Mennesson, en ordonnant la transcription totale des actes de naissance des jumelles, mais pour des raisons tenant aux circonstances concrètes de la cause et à la longueur de la procédure. On pensait alors que la filiation devait, sauf exception comme dans l’affaire Mennesson, s’opérer par transcription pour le père (biologique) d’intention et par la voie de l’adoption pour la mère d’intention (v. en ce sens, S. Bollée et B. Haftel, L’art d’être inconstant – Regards sur les récents développements de la jurisprudence en matière de gestation pour autrui, Rev. crit. DIP 2020. 267
), la Cour de cassation clôturait la saga Mennesson, en ordonnant la transcription totale des actes de naissance des jumelles, mais pour des raisons tenant aux circonstances concrètes de la cause et à la longueur de la procédure. On pensait alors que la filiation devait, sauf exception comme dans l’affaire Mennesson, s’opérer par transcription pour le père (biologique) d’intention et par la voie de l’adoption pour la mère d’intention (v. en ce sens, S. Bollée et B. Haftel, L’art d’être inconstant – Regards sur les récents développements de la jurisprudence en matière de gestation pour autrui, Rev. crit. DIP 2020. 267 ![]() ). Mais quelques semaines plus tard, la Cour de cassation semblait faire de la transcription une solution de principe (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-12.327, Dalloz actualité, 20 déc. 2019, obs. T. Coustet ; AJ fam. 2019. 175, obs. A. Dionisi-Peyrusse
). Mais quelques semaines plus tard, la Cour de cassation semblait faire de la transcription une solution de principe (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-12.327, Dalloz actualité, 20 déc. 2019, obs. T. Coustet ; AJ fam. 2019. 175, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ; 4 nov. 2020, n° 19-50.042, Dalloz actualité, 12 nov. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot
; 4 nov. 2020, n° 19-50.042, Dalloz actualité, 12 nov. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot ![]() ; AJ fam. 2020. 664
; AJ fam. 2020. 664 ![]() ; ibid. 616, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; ibid. 616, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ; RTD civ. 2021. 115, obs. A.-M. Leroyer
; RTD civ. 2021. 115, obs. A.-M. Leroyer ![]() ; 18 nov. 2020, n° 19-50.043, Dalloz actualité, 3 déc. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2020. 2289
; 18 nov. 2020, n° 19-50.043, Dalloz actualité, 3 déc. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2020. 2289 ![]() ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt
; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt ![]() ; ibid. 762, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 762, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; AJ fam. 2021. 54, obs. C. Latil
; AJ fam. 2021. 54, obs. C. Latil ![]() ; RTD civ. 2021. 115, obs. A.-M. Leroyer
; RTD civ. 2021. 115, obs. A.-M. Leroyer ![]() ). Pour briser cette jurisprudence, le législateur a modifié la rédaction de l’article 47 du code civil, qui empêche d’accorder une force probante aux actes d’état civil étrangers s’ils contiennent des mentions qui ne correspondent pas à la réalité, « celle-ci [étant] appréciée au regard de la loi française » (v. à cet égard, C. Bidaud, La force probante des actes de l’état civil étrangers modifiée par la loi bioéthique : du sens à donner à l’exigence de conformité des faits à la réalité appréciée au regard de la loi française, Rev. crit. DIP 2022. 35
). Pour briser cette jurisprudence, le législateur a modifié la rédaction de l’article 47 du code civil, qui empêche d’accorder une force probante aux actes d’état civil étrangers s’ils contiennent des mentions qui ne correspondent pas à la réalité, « celle-ci [étant] appréciée au regard de la loi française » (v. à cet égard, C. Bidaud, La force probante des actes de l’état civil étrangers modifiée par la loi bioéthique : du sens à donner à l’exigence de conformité des faits à la réalité appréciée au regard de la loi française, Rev. crit. DIP 2022. 35 ![]() ).
).
La voie de la transcription étant devenue périlleuse, les plaideurs s’orientent alors sur l’exequatur des décisions étrangères consacrant un lien de filiation entre l’enfant né d’une mère porteuse et son (ses) parent(s) d’intention. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation s’attache à examiner la contrariété de ces décisions à l’ordre public international français. C’est là l’objet de son premier temps de raisonnement dans l’affaire sous examen : elle rappelle que l’ordre public international français inclut les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme (§ 10). Or, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que sa naissance à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, dont la Cour rappelle la prohibition au plan interne, ne peut à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger.
Est-ce à dire que la gestation pour autrui n’est pas contraire à l’ordre public international français ? Certainement pas. Ce que semble dire la Cour de cassation, c’est que faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger constitue une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’enfant que lui garantit la Convention européenne telle qu’interprétée par la Cour européenne. Or, ces droits fondamentaux font également partie de l’ordre public international français. Par conséquent, pour déterminer la vigueur, dans l’ordre international, de notre prohibition de la gestation pour autrui, il s’agirait d’opérer une balance entre cette prohibition et l’atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant concerné que produirait sa défense opérée par un refus d’exequatur.
Et c’est précisément dans cette balance de la proportionnalité que l’arrêt présente un apport majeur : la Cour de cassation renonce à l’exigence d’un lien génétique entre l’enfant et son parent d’intention.
Absence de contrariété à l’ordre public international de l’absence de lien génétique entre la mère d’intention et l’enfant
Il faut un instant s’arrêter sur les exigences européennes en la matière. Dans l’affaire Mennesson, la Cour européenne avait en effet mis particulièrement en lumière le fait que le père d’intention était aussi le père génétique de l’enfant (CEDH 26 juin 2014, n° 65941/11, préc., § 79 ; CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001, §§ 35 et 36, Dalloz actualité, 19 avr. 2019, obs. T. Coustet ; AJDA 2019. 788 ![]() ; ibid. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen
; ibid. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen ![]() ; D. 2019. 1084, et les obs.
; D. 2019. 1084, et les obs. ![]() , note H. Fulchiron
, note H. Fulchiron ![]() ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 2020. 506, obs. M. Douchy-Oudot ![]() ; ibid. 677, obs. P. Hilt
; ibid. 677, obs. P. Hilt ![]() ; AJ fam. 2019. 289, obs. P. Salvage-Gerest
; AJ fam. 2019. 289, obs. P. Salvage-Gerest ![]() ; ibid. 233, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; ibid. 233, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ; AJCT 2022. 259, étude S. Benmimoune
; AJCT 2022. 259, étude S. Benmimoune ![]() ; Rev. crit. DIP 2022. 35, chron. C. Bidaud
; Rev. crit. DIP 2022. 35, chron. C. Bidaud ![]() ; RTD civ. 2019. 286, obs. J.-P. Marguénaud
; RTD civ. 2019. 286, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ; ibid. 307, obs. A.-M. Leroyer
; ibid. 307, obs. A.-M. Leroyer ![]() ). Les observateurs avaient ainsi pu en conclure que l’existence d’un lien génétique entre le père d’intention et l’enfant né d’une mère porteuse semblait nécessaire pour obtenir la transcription d’un acte de naissance étranger grâce à l’appui des droits fondamentaux, et notamment du droit à l’identité de l’enfant.
). Les observateurs avaient ainsi pu en conclure que l’existence d’un lien génétique entre le père d’intention et l’enfant né d’une mère porteuse semblait nécessaire pour obtenir la transcription d’un acte de naissance étranger grâce à l’appui des droits fondamentaux, et notamment du droit à l’identité de l’enfant.
Mais comme rappelé précédemment, la Cour de cassation, à partir de décembre 2019, avait semblé faire de la transcription la solution de principe, y compris à l’égard du parent d’intention qui n’est pas le parent biologique de l’enfant. La Cour européenne elle-même avait, dans son avis de 2019, laissé entendre qu’elle pourrait infléchir sa jurisprudence au regard de l’importance qu’elle accordait à l’existence d’un lien biologique (CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P16-2018-001, §§ 35 et 36, préc.).
La question précisément posée à la Cour de cassation dans l’affaire sous examen est la suivante : la demande d’exequatur d’un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant, né à la suite d’une convention de gestation pour autrui, à l’égard d’une personne n’ayant aucun lien biologique, se heurte-t-elle à l’ordre public international français ? Il y a en réalité deux façons d’aborder cette question. Est-ce que ce lien biologique entre l’enfant et son parent d’intention constitue un poids dans le plateau en faveur de la reconnaissance lorsqu’il existe ? Ou au contraire, l’absence d’un tel lien incline-t-il le fléau du côté de l’ordre public international protégeant notre prohibition interne de la gestation pour autrui, en défaveur de la reconnaissance ? C’est dans le contrôle de proportionnalité que ce lien génétique semble être abordé par la Cour de cassation, et ce n’est qu’après avoir rappelé que le recours à la gestation pour autrui ne peut, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance que les juges du quai de l’Horloge vont affirmer qu’« aucun principe essentiel du droit français n’interdit la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique ». Si la solution peut interpeller a priori, il n’en demeure pas moins que l’arrêt sous examen la justifie parfaitement en trois temps.
D’abord, il rappelle que le droit français de la filiation prévoit des modes d’établissement qui reposent sur la vraisemblance biologique, mais permettent qu’une filiation non conforme à la réalité soient établies, la preuve de cette dernière n’intervenant qu’en cas de conflit, dans les conditions et les délais prévus par la loi. De fait, une filiation établie en droit français sur une présomption de paternité ou sur une reconnaissance volontaire repose sur une vraisemblance biologique, mais n’implique aucunement, pour le mari de la mère ou pour l’auteur de la reconnaissance, d’apporter la preuve de la réalité biologique de la filiation. Plus encore, corroborée par une possession d’état de cinq ans, le titre ne saurait plus être remis en cause, quand bien même il serait contraire à la réalité biologique (C. civ., art. 333, al. 2). La réalité biologique n’est pas une considération d’ordre public interne dans l’établissement (ou la consolidation) d’une filiation.
Ensuite, la Cour s’appuie sur l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation, qui conduit à admettre des liens de filiations sans rapport avec la réalité biologique pour les couples de sexe différent qui ont recours à un donneur. L’article 342-9 du code civil précise même qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur et l’enfant issu du don. C’est dire le peu de cas qui est fait de la réalité biologique en la matière. Mais toujours est-il qu’une telle filiation repose sur une vraisemblance biologique : le droit français permet à cet égard de singer la biologie.
Enfin, la Cour met en lumière le changement radical de paradigme depuis la réforme bioéthique de 2021. Certes, le législateur, n’a pas remis en cause la prohibition des gestations pour autrui en droit français. Mais il a en revanche ouvert la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, lesquelles peuvent, par une reconnaissance conjointe anticipée, établir un double lien de filiation maternelle. Ce faisant, le droit français s’est totalement affranchi de la réalité biologique, établie ou vraisemblable, pour faire reposer la filiation sur « l’engagement personnel de deux femmes qui ont construit un projet parental commun ».
De tout ceci résulte que l’existence d’un lien biologique ne peut pas constituer une exigence de l’ordre public interne, et partant, de l’ordre public international français, le second étant nécessairement plus restreint que le premier.
Cet apport majeur de l’arrêt sous examen, rendu contre l’avis de l’avocate générale (v. l’avis de Mme Caron-Déglise, publié sur le site de la Cour de cassation) s’explique par la nécessité pour la Cour de cassation à la fois de respecter les droits fondamentaux des enfants déjà nés de mères porteuses à l’étranger, tout en ne trahissant pas le droit français qui ne fait désormais plus de la réalité biologique la considération primordiale, ou du moins exclusive, en droit de la filiation. Il eut été délicat de conférer à ce lien biologique une dimension d’ordre public international alors même qu’une telle dimension n’est pas indiscutable dans l’ordre interne : les évolutions récentes du droit français ont nécessairement eu un impact sur la caractérisation de l’ordre public international, eu égard au principe d’actualité de l’ordre public international.
Probablement dans un souci de pédagogie et de clarté qu’il faut saluer, la Cour poursuit son examen des conditions de régularité du jugement canadien, confirmant ainsi sa récente jurisprudence.
Des confirmations
Une fois écarté le grief tiré de la contrariété à l’ordre public international de fond, la Cour de cassation poursuit le raisonnement et reprend des considérations qu’elle avait déjà exposées par ses arrêts du 2 octobre 2024. Elle apporte ainsi un nouvel éclairage sur ses solutions concernant l’appréciation de l’ordre public procédural et confirme l’impossibilité de conférer à un jugement revêtu de l’exequatur les effets d’une adoption plénière.
L’appréciation de l’ordre public procédural : l’exigence de motivation renforcée
La Cour de cassation consolide dans l’arrêt sous examen la solution qu’elle avait posée dans l’arrêt du 2 octobre 2024 (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.883 FS-B+R, Dalloz actualité, 17 oct. 2024, obs. A. Panet-Marre ; AJ fam. 2024. 573, obs. J. Houssier ![]() ; ibid. 485, édito V. Avena-Robardet
; ibid. 485, édito V. Avena-Robardet ![]() ; ibid. 537, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; ibid. 537, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ) en y faisant par ailleurs directement référence. Elle souligne à nouveau les risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et les dangers inhérents à ces pratiques, pour rappeler que « le juge doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ».
) en y faisant par ailleurs directement référence. Elle souligne à nouveau les risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et les dangers inhérents à ces pratiques, pour rappeler que « le juge doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ».
La Cour semble ensuite retenir certains éléments qui jouent en faveur du respect de ces considérations « substantielles » qui composent l’ordre public procédural en la matière. D’abord, la Cour d’appel a relevé que la décision canadienne avait retenu que la mère porteuse n’était ni la mère biologique, ni la mère légale de l’enfant en droit canadien. Ensuite, la décision étrangère constatait que la mère porteuse avait librement et volontairement donné son consentement et accepté que la mère d’intention soit le seul parent légal de l’enfant en renonçant à ses droits parentaux à son profit aux termes d’un consentement signé après la naissance de l’enfant. Enfin, la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique a retenu que, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la donneuse d’ovocyte anonyme et le donneur de sperme anonyme n’étaient pas les parents légaux de l’enfant.
Toutes les personnes ayant participé au projet parental d’autrui sont clairement mentionnées et leurs qualités sont précisées, et un consentement de la mère porteuse, intervenu postérieurement à la naissance de l’enfant, a été constaté dans la décision étrangère. Certes, la cour d’appel ne peut pas contrôler la réalité de ce consentement, et son intégrité, en raison de la prohibition de la révision au fond. Elle doit s’en tenir à ce que constate le jugement étranger. Mais toujours est-il que la Cour de cassation semble poursuivre dans la voie d’un renforcement de l’exigence de motivation du jugement étranger en confirmant la nécessité qu’il constate que certaines garanties sont présentes eu égard au caractère sensible de la matière, sous peine de se voir refuser l’exequatur.
L’ordre public procédural ainsi précisé, teinté de considérations substantielles, ne peut produire qu’un effet plein. Le contrôle de la décision étrangère à cet égard serait alors en réalité plus poussé que celui opérant dans le cadre de l’ordre public de fond, qui est susceptible à l’inverse de produire un effet atténué.
Compétence indirecte du juge étranger, absence de fraude et conformité à l’ordre public de fond et de procédure étant réunis, la cour d’appel n’encourt pas la censure et la décision américaine est bel et bien susceptible de recevoir l’exequatur.
En revanche, c’est sur le plan des effets à accorder à un tel jugement que la cassation intervient.
La mise à l’écart des règles relatives à l’adoption
Le procureur soutenait à l’appui de son pourvoi qu’en considérant que l’exequatur de la décision canadienne produirait les effets d’une adoption plénière, la cour d’appel avait procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé l’article 509 du code civil.
La Cour de cassation accueille ce moyen en rappelant que « lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui, est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ». Ce faisant, elle confirme purement et simplement la solution retenue dans l’arrêt du 2 octobre 2024 (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 23-50.002, préc.) et l’on renverra pour l’essentiel à nos observations parues sous ce dernier (Dalloz actualité, 18 oct. 2024). Il faut effectivement reconnaitre que conférer à un jugement canadien établissant la filiation d’un enfant né d’une mère porteuse en application du droit local les effets d’une adoption plénière aurait eu peu de sens, cette solution n’étant d’ailleurs pas recommandée par l’avocate générale. Dans la mesure où le droit canadien connait aussi l’adoption, qui obéit à des règles différentes et qui n’ont pas été mises en œuvre en l’espèce, c’eût été trahir la décision étrangère que de lui conférer en France les effets d’une adoption plénière. La prohibition de la révision au fond y faisait d’ailleurs échec.
En ce qui concerne l’adoption, deux séries de précisions peuvent être apportées. En premier lieu, les règles relatives à l’adoption internationale auraient prétendument été contournées, comme le soutient le ministère public dans son mémoire ampliatif. Pour le procureur, en l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et au moins un de ses parents, la seule voie ouverte serait celle de l’adoption. Recourir comme en l’espèce à une convention de gestation pour autrui pour ensuite demander l’exequatur de la décision canadienne établissant consécutivement le lien de filiation conduirait à un détournement des règles de l’adoption internationale. C’est aborder à demi-mots la condition de l’absence de fraude à la loi, dont on sait à quel point elle est d’un maniement délicat en la matière (v. à cet égard, Civ. 1re, 13 sept. 2013, n° 12-30.138, Dalloz actualité, 17 sept. 2013, obs. I. Gallmeister ; D. 2013. 2383 ![]() ; ibid. 2349, chron. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon
; ibid. 2349, chron. H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ![]() ; ibid. 2377, avis C. Petit
; ibid. 2377, avis C. Petit ![]() ; ibid. 2384, note M. Fabre-Magnan
; ibid. 2384, note M. Fabre-Magnan ![]() ; ibid. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot
; ibid. 2014. 689, obs. M. Douchy-Oudot ![]() ; ibid. 954, obs. REGINE
; ibid. 954, obs. REGINE ![]() ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts
; ibid. 1171, obs. F. Granet-Lambrechts ![]() ; ibid. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano
; ibid. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ![]() ; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 1787, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ![]() ; AJ fam. 2013. 579
; AJ fam. 2013. 579 ![]() ; ibid. 532, obs. A. Dionisi-Peyrusse
; ibid. 532, obs. A. Dionisi-Peyrusse ![]() ; ibid. 600, obs. C. Richard et F. Berdeaux-Gacogne
; ibid. 600, obs. C. Richard et F. Berdeaux-Gacogne ![]() ; AJCT 2013. 517
; AJCT 2013. 517 ![]() , obs. R. Mésa
, obs. R. Mésa ![]() ; Rev. crit. DIP 2013. 909, note P. Hammje
; Rev. crit. DIP 2013. 909, note P. Hammje ![]() ; RTD civ. 2013. 816, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2013. 816, obs. J. Hauser ![]() ; et les nombreuses réactions doctrinales suscités par l’arrêt). La cour d’appel a estimé, suivie en cela par la Cour de cassation, que l’existence d’une fraude à l’adoption internationale, dont il n’était pas précisé quelles règles auraient été contournées, ne saurait se déduire de la circonstance que la décision étrangère établisse la filiation d’un enfant qui ne présente de lien biologique ni avec la mère porteuse, ni avec la mère d’intention.
; et les nombreuses réactions doctrinales suscités par l’arrêt). La cour d’appel a estimé, suivie en cela par la Cour de cassation, que l’existence d’une fraude à l’adoption internationale, dont il n’était pas précisé quelles règles auraient été contournées, ne saurait se déduire de la circonstance que la décision étrangère établisse la filiation d’un enfant qui ne présente de lien biologique ni avec la mère porteuse, ni avec la mère d’intention.
En second lieu, certains estiment que recourir aux règles de l’adoption pour établir le lien de filiation à l’égard d’un parent d’intention qui n’est pas le parent biologique permettrait d’instaurer un certain contrôle du processus a posteriori. Pourtant, il semble que dans le cadre d’une adoption, la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant pèserait extrêmement lourd en faveur de l’établissement du lien, fût-il adoptif. C’est à cet égard que la décision sous examen, et ses précédents du mois d’octobre, sont en réalité moins libérales qu’elles n’y paraissent : le contrôle renforcé de l’exequatur de la décision étrangère permet un examen plus accru, des exigences plus poussées, que celui qui s’opérerait dans le cadre d’une adoption qui interviendrait souvent bien plus tard, alors que la situation serait déjà largement cristallisée.
En conclusion, cet arrêt est riche d’enseignement mais son sens ne doit pas être mal compris : les conventions de mère porteuse conclues à l’étranger heurtent l’ordre public international français, mais notre prohibition doit nécessairement s’articuler avec l’impératif de respect des droits fondamentaux des enfants ainsi nés (H. Fulchiron et C. Bidaud, Ne punissez pas les enfants pour les fautes de leurs pères…, D. 2014. 1773 ![]() ). Pour autant, le recours aux droits fondamentaux n’est pas susceptible de « sauver » toutes les situations acquises à l’étranger, et il est nécessaire de vérifier, au travers de la motivation des jugements étrangers, que les droits de toutes les parties à la convention, et notamment des plus vulnérables, ont été respectés. Il semble capital en la matière de se garder de tout dogmatisme, dans un sens comme dans l’autre.
). Pour autant, le recours aux droits fondamentaux n’est pas susceptible de « sauver » toutes les situations acquises à l’étranger, et il est nécessaire de vérifier, au travers de la motivation des jugements étrangers, que les droits de toutes les parties à la convention, et notamment des plus vulnérables, ont été respectés. Il semble capital en la matière de se garder de tout dogmatisme, dans un sens comme dans l’autre.
Civ. 1re, 14 nov. 2024, FS-B+R, n° 23-50.016
© Lefebvre Dalloz