Impossibilité pour une personne transgenre d’accéder à un traitement hormonal en détention et droit au respect de la vie privée
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne, reconnaissant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la privation d’un traitement hormonal d’une femme transgenre à l’occasion de sa détention.
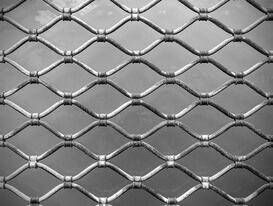
La requérante, reconnue de sexe masculin à sa naissance, a été emprisonnée à plusieurs reprises entre novembre 2013 et mai 2024 pour différents délits de droit commun (en particulier de vol et d’escroquerie). Les peines d’emprisonnement ont été effectuées dans des prisons pour hommes.
À la suite de différents actes de mutilation commis en prison en 2018, dont une orchidectomie bilatérale pratiquée par elle-même ayant nécessité une hospitalisation, une expertise médicale a été requise par le directeur de l’établissement pénitentiaire.
L’expertise médicale a reconnu en décembre 2018 la nécessité de la poursuite d’un traitement hormonal, étant précisé par le médecin que « l’absence de mise en œuvre immédiate de ce traitement constitue un risque grave pour la santé, entraînant une détérioration significative de son efficacité », et « qu’un tel traitement aurait des effets positifs sur la vie et la santé de la requérante et qu’il contribuerait à sa réadaptation » (§ 9).
Le traitement prescrit a été autorisé par les autorités pénitentiaires polonaises, sous réserve que le coût du traitement soit supporté par la requérante. Il est précisé que « grâce à la thérapie, l’apparence de la requérante a changé et sa santé physique et émotionnelle s’est améliorée », ce qui a encouragé à la poursuite du traitement hormonal y compris après le transfert de la requérante dans d’autres établissements pénitentiaires.
Après un changement d’établissement pénitentiaire en 2020, la requérante a sollicité auprès du directeur de l’établissement le renouvellement de son traitement, qui lui a été refusé. En effet, « le chef de l’unité médicale de la prison a déclaré que l’administration d’hormones féminines à un homme en milieu pénitentiaire sans avis d’expert psycho-psychiatrique approfondi et sans tests endocrinologiques recommandés par un endocrinologue consultant était très risquée » (§ 13). Le rendez-vous avec un endocrinologue a néanmoins été retardé en raison des restrictions liées à la covid-19.
Malgré les démarches entreprises par l’avocat de la requérante début juillet 2020, le traitement n’a pu être renouvelé à temps : la requérante est ainsi privée de son traitement à partir du 18 juillet 2020. Le traitement est inaccessible à la requérante jusqu’au 31 juillet, après qu’une demande de mesures provisoires a été formulée auprès de la Cour le 29 juillet. La Cour a enjoint le 30 juillet au gouvernement polonais d’« administrer à la requérante… des hormones prescrites par son endocrinologue […] aux doses prescrites, à ses frais, jusqu’à ce qu’un endocrinologue en décide autrement ».
Une consultation avec un médecin endocrinologue, le 5 août 2020, a permis le renouvellement pérenne du traitement et son acheminement dans le nouvel établissement pénitentiaire.
Si la Cour a pu estimer que la privation d’un traitement hormonal pendant presque deux semaines constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne relatif au droit à la vie privée, cette solution n’a néanmoins pas fait l’unanimité, comme peut en témoigner l’opinion dissidente du juge polonais. En effet, il a fallu déterminer si l’ingérence de l’autorité polonaise répondait aux critères de l’article 8, § 2, de la Convention, après avoir établi que le traitement subi en l’espèce constituait effectivement une violation du droit à la vie privée et non pas un mauvais traitement relevant de l’article 3 de la Convention.
Un « mauvais traitement » appréhendé sous le régime de la vie privée
La requérante s’est plainte, à titre principal, d’une violation de l’article 3 de la Convention en estimant que « le refus de l’autoriser à poursuivre son traitement hormonal à la prison de Siedlce constituait un traitement inhumain et dégradant » (§ 65). C’est à titre subsidiaire qu’elle « alléguait en outre que le refus en question constituait également une violation de l’article 8, car il avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à l’autodétermination » (ibid.).
Au titre du principe jura novit curia selon lequel la Cour ne se considère pas comme liée par la qualification que leur attribuent les requérants, les gouvernements ou la Commission (not. rappelé dans l’arrêt CEDH 20 mars 2018, Radomilja e.a. c/ Croatie, nos 37685/10 et 22768/12), il est considéré comme « plus approprié » d’examiner une potentielle violation de l’article 8 de la Convention, et non de l’article 3 (§ 66).
Ainsi, la Cour rappelle de manière très classique et générale les principes qui guident l’application de l’article 8, et notamment le fait que le concept de vie privée s’analyse de manière particulièrement large, incluant notamment les questions de genre, d’identité sexuelle et d’orientation sexuelle comme établi à plusieurs reprises par la jurisprudence (elle s’appuie not. sur l’arrêt, CEDH 12 juin 2003, Van Kück c/ Allemagne, n° 35968/97, RTD civ. 2004. 361, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ).
).
L’article 8, depuis l’arrêt de principe Pretty (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, n° 2346/02, AJDA 2003. 1383 ![]() , note B. Le Baut-Ferrarese
, note B. Le Baut-Ferrarese ![]() ; D. 2002. 1596, et les obs.
; D. 2002. 1596, et les obs. ![]() ; RDSS 2002. 475, note P. Pédrot
; RDSS 2002. 475, note P. Pédrot ![]() ; RSC 2002. 645, obs. F. Massias
; RSC 2002. 645, obs. F. Massias ![]() ; RTD civ. 2002. 482, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2002. 482, obs. J. Hauser ![]() ; ibid. 858, obs. J.-P. Marguénaud
; ibid. 858, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ), inclut une protection de « l’autonomie personnelle » qui inclut, s’agissant des personnes transgenres, un droit à l’autodétermination dans lequel prévaut une liberté dans la définition de l’identité sexuelle de la personne.
), inclut une protection de « l’autonomie personnelle » qui inclut, s’agissant des personnes transgenres, un droit à l’autodétermination dans lequel prévaut une liberté dans la définition de l’identité sexuelle de la personne.
La Cour rappelle néanmoins la recherche d’équilibre dans l’application de l’article 8, qui n’exige pas une absence totale d’interférence des autorités étatiques : celle-ci s’appuie sur sa jurisprudence passée et constante (v. entre autres, CEDH 10 avr. 2007, Evans c/ Royaume-Uni, n° 6339/05, Dalloz actualité, 17 avr. 2007, obs. C. Delaporte-Carré ; D. 2008. 1435, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; RDSS 2007. 810, note D. Roman
; RDSS 2007. 810, note D. Roman ![]() ; RTD civ. 2007. 295, obs. J.-P. Marguénaud
; RTD civ. 2007. 295, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ; ibid. 545, obs. J. Hauser
; ibid. 545, obs. J. Hauser ![]() ) pour rappeler l’existence d’une marge nationale d’appréciation. Néanmoins, s’agissant des questions aussi « intimes » (§ 84) que l’identité sexuelle des individus, la Cour a souligné leur « importance particulière » et a donc eu tendance à contraindre la marge nationale d’appréciation (dans ce sens, CEDH 8 janv. 2009, Schlumpf c/ Suisse, n° 29002/06, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss
) pour rappeler l’existence d’une marge nationale d’appréciation. Néanmoins, s’agissant des questions aussi « intimes » (§ 84) que l’identité sexuelle des individus, la Cour a souligné leur « importance particulière » et a donc eu tendance à contraindre la marge nationale d’appréciation (dans ce sens, CEDH 8 janv. 2009, Schlumpf c/ Suisse, n° 29002/06, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ![]() ; RTD civ. 2009. 291, obs. J.-P. Marguénaud
; RTD civ. 2009. 291, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ).
).
La privation du traitement hormonal en prison devant donc, au titre du principe jura novit curia, être analysé comme une violation du droit à la vie privée et, plus précisément, du droit à l’autonomie personnelle, la Cour ne procède pas au contrôle traditionnel de gravité de la violation propre à l’article 3 de la Convention mais à un contrôle de l’ingérence polonaise en l’espèce.
Une ingérence polonaise excessive
Si le traitement hormonal est régulièrement considéré comme une obligation positive pour les États au titre de l’article 8 de la Convention, s’agissant en l’espèce d’une privation, la Cour annonce logiquement qu’elle traitera cette privation comme une ingérence prévue à l’article 8, § 2. Dès lors, il convient – très classiquement – de vérifier si celle-ci est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime et si elle est nécessaire dans une société démocratique.
S’agissant des deux premiers critères, ils semblent vérifiés sans qu’il n’y ait besoin de longue discussion : l’ingérence est prévue par la loi (en l’espèce, par l’article 115, § 6, du code d’exécution des sanctions pénales polonais) et poursuit un but légitime, celui de la protection de la santé de la requérante, puisque le traitement avait été seulement suspendu dans l’attente d’une nouvelle expertise par un endocrinologue.
Néanmoins, la Cour considère que la décision n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En effet, elle relève notamment que les autorités avaient pleinement conscience du caractère bénéfique du traitement maintes fois démontré par plusieurs expertises médicales, tandis qu’il avait été souligné en juin 2020 que l’interruption du traitement créait un risque important quant à la santé de la requérante. Elle note également la vulnérabilité de la requérante, qui a, entre autres, procédé à des actes de mutilation génitale lors de ses détentions précédentes. Compte tenu par ailleurs du caractère essentiel de l’identité sexuelle dans le droit reconnu à l’autodétermination, la Cour conclut au fait que les autorités polonaises n’ont pas réussi à trouver un équilibre entre les intérêts en cause, à savoir la protection de la santé de la requérante et la poursuite de la thérapie hormonale.
La Cour souligne – au même titre que l’opinion dissidente du juge polonais – le caractère relativement bref de la privation du traitement, du 18 au 31 juillet. Toutefois, celle-ci rappelle que la reprise effective du traitement le 31 juillet n’est due qu’à l’adoption de mesures provisoires par la Cour la veille, et ne pouvait donc pas être imputée à la volonté des autorités polonaises. Ce faisant, il y a bien eu une violation de l’article 8 de la Convention.
S’agissant de la privation d’un traitement médical à l’occasion d’une incarcération et non d’une affaire relative à un seul changement de genre, nous aurions légitimement pu attendre une condamnation au titre de l’article 3 de la Convention en matière de traitements inhumains et dégradants, et non au titre de l’article 8 et du droit au respect de la vie privée. Cette requalification témoigne d’une tendance globalisante de l’article 8 qui vise à renforcer le droit à l’autodétermination, tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour européenne depuis l’arrêt Pretty (préc.).
Cette requalification témoigne également d’un certain pragmatisme judiciaire et d’un volontarisme de la Cour quant à la protection des personnes transgenres incarcérées : alors que la question de la durée de l’interruption du traitement est ici seulement évoquée et fait déjà l’objet d’une opinion dissidente, il est improbable – et ce malgré la vulnérabilité certaine de la requérante – qu’une privation si contrainte dans le temps atteigne le seuil de gravité nécessaire à l’engagement de la responsabilité des autorités nationales au titre de l’article 3 de la Convention.
CEDH 11 juill. 2024, W. W. c/ Pologne, n° 31842/20
© Lefebvre Dalloz