La demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat de crédit-bail publié : faculté ou obligation pour le propriétaire ?
Si la demande en restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.
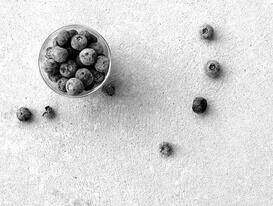
Alors que la procédure collective produit des effets délétères pour de nombreux créanciers, ceux qui conservent la propriété d’un bien détenu par le débiteur tirent incontestablement leur épingle du jeu. Eu égard à leur qualité de propriétaire, ces derniers peuvent empêcher que leurs biens soient attraits à la procédure collective ouverte. Comme l’a écrit un auteur, le créancier propriétaire est appréhendé par la procédure « sous une double casquette, celle de créancier et celle de propriétaire, jouant indépendamment l’un de l’autre, la propriété masquant complètement le droit de créance qu’elle vient garantir » (F. Macorig-Venier, L’exclusivité, LPA, 11 févr. 2011, n° 30, p. 59).
Le crédit-bailleur est concerné au premier chef. Depuis la loi du 10 juin 1994, ce créancier est dispensé de revendication, sous réserve que le contrat de crédit-bail ait fait l’objet d’une publicité régulière. Le défaut de publicité, emportant inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective du preneur, constitue en effet un obstacle tant à la revendication du bien qu’à sa restitution. Tout autre est, en revanche, la situation du crédit-bailleur qui a publié son contrat et qui n’a donc pas à faire reconnaître son droit de propriété à la procédure. Dans ce cas, « il peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » (C. com., art. L. 624-10). La demande en restitution, qui n’est enfermée dans aucun délai, présente un caractère facultatif pour le propriétaire dispensé de revendication. Si ce dernier souhaite obtenir la remise matérielle du bien qui se trouve entre les mains du débiteur, une action en restitution est nécessaire. Mais rien ne l’oblige à l’exercer. Il ne s’agit que d’une simple faculté mise à sa disposition (Com. 18 sept. 2012, n° 11-21.744, Dalloz actualité, 27 sept. 2012, obs. A. Lienhard ; APC 2012/16. Comm. 241, note J. Vallansan ; JCP 2014. Actu. 18, note J.-J. Barbiéri ; RPC 2013, n° 5, sept. 2013, n° 137, note M.-H. Monsérié-Bon ; Gaz. Pal. 19 janv. 2013, n° 019, note E. Le Corre-Broly).
Toutefois, cette simple faculté se transforme en une véritable obligation dès lors que la créance est garantie par un cautionnement. C’est cette précision importante que souhaite apporter la Cour de cassation dans la présente affaire. Les faits de l’espèce sont relativement simples. Par acte en date du 22 août 2007, une entreprise a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec une société un contrat de crédit-bail dont l’exécution était garantie par les cautionnements solidaires de deux époux.
L’entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a alors assigné les cautions en paiement. Celles-ci ont rétorqué en invoquant notamment l’exception de subrogation pour échapper à leur engagement au motif que le crédit-bailleur, qui avait régulièrement publié son contrat, avait omis de demander la restitution du matériel.
Ce moyen de défense est prévu à l’article 2314 du code civil qui dispose, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ». Ainsi la caution est-elle déchargée si le créancier compromet le recours subrogatoire qu’elle pourrait exercer contre le débiteur après avoir payé en lieu et place de celui-ci. « L’aspect économique de l’opération de cautionnement » (S. Piedelièvre, Droit des sûretés, 3e éd., Ellipses, 2022, n° 204) justifie la décharge prévue en faveur de la caution. En effet, l’exécution du contrat de cautionnement ne met pas fin à l’opération, dans la mesure où, une fois le créancier désintéressé par la caution, celle-ci est en droit d’être remboursée par le débiteur. N’étant pas tenue de la dette, la caution peut légitimement prétendre à récupérer l’avance qu’elle a accepté de consentir au profit du créancier.
C’est la raison pour laquelle le créancier doit être très vigilant lorsqu’un cautionnement a été souscrit en garantie de la dette. Il ne doit jamais perdre de vue les intérêts de la caution dont le sort après paiement de la dette est fonction du bon respect du devoir de loyauté qui pèse sur lui dès le contrat de cautionnement conclu. Nombreuses sont ainsi les décisions qui font prévaloir la protection des intérêts de la caution sur la sécurité que le créancier est en droit d’attendre du cautionnement (M. Bourassin et V. Brémond, Droit des sûretés, 7e éd., Sirey, 2019, n° 386). L’on peut citer celles qui ont permis d’étendre la mise en œuvre de l’article 2314 du code civil, au-delà des seules sûretés perdues par la faute du créancier. En effet, dans une acception plus large, celui-ci est sanctionné dès lors qu’il a causé la perte de tous les avantages dont il dispose « qui ne sont pas des droits de préférence à proprement parler, mais qui lui évitent de subir le concours des autres créanciers, ou rendent plus facile le recouvrement de la dette » (L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, 16e éd., LGDJ, 2022, n° 187). Les décisions qui ont érigé en obligation l’exercice d’une simple faculté pour le créancier sont, dans le même sens, révélatrices de cette protection accrue de la caution (v. not., le célèbre arrêt du 17 nov. 2006 dans lequel la chambre mixte a jugé que « le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive », Cass., ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-19.123, Dalloz actualité, 5 déc. 2006, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2007. 157, obs. P. Crocq ![]() ; RTD com. 2007. 215, obs. D. Legeais
; RTD com. 2007. 215, obs. D. Legeais ![]() ; JCP 2006. 2775, note D. Houtcieff ; RD banc. fin. 2007. Comm. 5, obs. A. Cerles ; Defrénois 2007. 688, note S. Piedelièvre).
; JCP 2006. 2775, note D. Houtcieff ; RD banc. fin. 2007. Comm. 5, obs. A. Cerles ; Defrénois 2007. 688, note S. Piedelièvre).
Dans son arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation est restée fidèle à son analyse. Elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel ayant écarté en l’espèce l’application de l’article 2314 du code civil, malgré l’inaction du crédit-bailleur depuis plus de dix ans pour obtenir la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail. Les juges du fond avaient motivé leur arrêt en se fondant sur les courriers de déclaration de créance dans lesquels le crédit-bailleur avait demandé au mandataire judiciaire puis au liquidateur de lui indiquer les modalités de récupération du matériel entre les mains de la société débitrice tout en rappelant, dans ces mêmes courriers, que son contrat de crédit-bail avait fait l’objet d’une publication auprès du greffe du tribunal de commerce. Le crédit-bailleur avait ensuite omis de poursuivre la restitution du matériel dans les conditions de l’article R. 624-14 du code de commerce. La cour d’appel en avait malgré tout déduit qu’aucune faute n’était imputable au crédit-bailleur.
Les hauts magistrats ne pouvaient ici que censurer le raisonnement tenu par la cour d’appel, laquelle aurait dû rechercher si, en omettant de poursuivre la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans les conditions prévues à l’article R. 624-14 du code de commerce, le crédit-bailleur n’avait pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter.
La position de la Cour de cassation est à l’abri de toute critique. La restitution du matériel au crédit-bailleur a nécessairement une incidence sur la dette à recouvrer et, par là-même, sur l’engagement de la caution. En effet, la restitution du bien permet au crédit-bailleur de se « payer sur le bien » en marge des règles de la discipline collective (v. E. Le Corre-Broly, La levée de l’option d’achat du crédit-bail et la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures, D. 2007. 2363 ![]() ).
).
Plus précisément, lorsque le débiteur est placé en procédure collective, le crédit-bailleur est en mesure d’obtenir, par la voie de la récupération du bien, un paiement indirect de tout ou partie de sa créance. Si la résiliation du contrat de crédit-bail intervient aux torts du crédit-preneur, est alors mise à sa charge une indemnité de résiliation correspondant généralement à l’intégralité des loyers restant dus, dont il sera cependant déduit le prix de vente ultérieure du bien récupéré par le crédit-bailleur. Ainsi, le prix de revente s’impute sur la créance et réduit à due concurrence la somme due par le crédit-preneur.
L’on comprend dès lors pourquoi la restitution du bien présente un intérêt pour la caution qui ne viendra alors garantir que la somme restant due après déduction du prix de revente. Par conséquent, plus la restitution du bien se fait tôt, moins le crédit-bailleur se trouve confronté au risque que le bien se déprécie avec le temps et soit vendu à un prix moindre. L’impact que les diligences du crédit-bailleur vont produire sur le montant de la dette garantie par le cautionnement justifie de transformer la faculté de demander la restitution du bien en une véritable obligation à la charge du crédit-bailleur. La Cour de cassation ne s’y est pas trompée par le passé, puisqu’elle a déjà admis la décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil, lorsque le créancier a tardé à reprendre possession de son matériel à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire l’y autorisant (Com. 21 mars 2006, n° 04-20.325, Lexis base n° N7541AKI, note E. Le Corre-Broly).
Un autre moyen de défense, dont on ne dira que quelques mots, avait aussi été invoqué par les cautions. Il s’agit de l’obligation annuelle d’information prévue, avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, par l’article L. 341-6 du code de la consommation. Aux termes de ce texte, « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ». La caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers peut-elle se prévaloir de cette disposition ? La Cour de cassation y répond par l’affirmative. Ainsi le crédit-bailleur doit-il informer chaque année la caution du montant des loyers dus par le crédit-preneur au 31 décembre de l’année précédente, autrement dit des loyers échus à cette date, auxquels s’ajoutent les intérêts de retard en cas de loyers impayés. L’obligation annuelle d’information ne se limite donc pas au professionnel ayant consenti un prêt au débiteur, elle s’applique également dans le cadre d’un contrat de location. Voilà l’autre apport de cet arrêt du 8 novembre 2023 qu’il fallait évoquer, même si la question de l’exception de subrogation méritait une attention plus soutenue.
© Lefebvre Dalloz