La dignité des conditions de détention dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire
La Cour européenne des droits de l’homme s’est imposée comme précurseur d’une évolution certaine en matière de respect des droits et libertés des personnes détenues. Les juges européens confirment, par l’arrêt commenté, le mouvement de défense des droits dans un contexte de grève du personnel pénitentiaire.
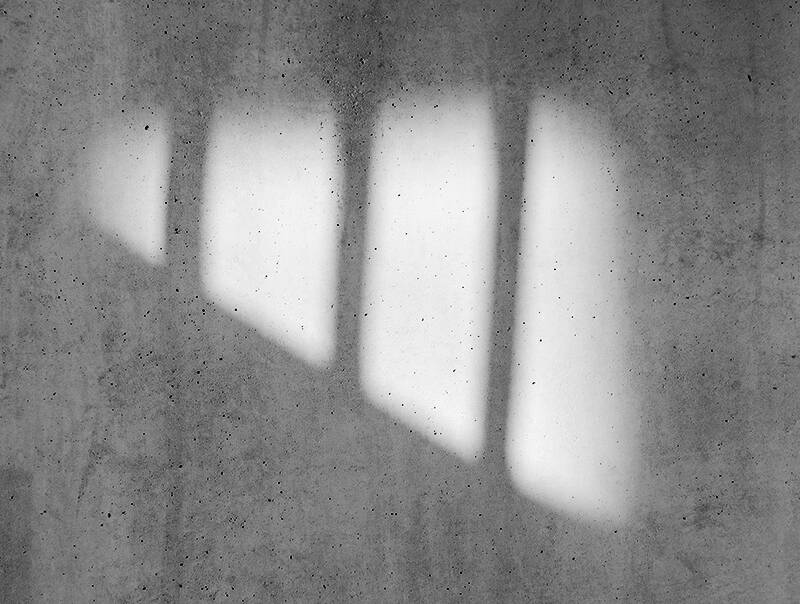
Par l’arrêt commenté, la Cour européenne s’est spécifiquement intéressée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, lequel accueille des personnes détenues condamnées à de longues peines et applique un régime de sécurité renforcée. À l’origine de la présente affaire se trouve l’agression de deux agents pénitentiaires, laquelle a débouché sur l’organisation d’un mouvement social à l’initiative de plusieurs membres du personnel. Les conditions de détention au cours de ce mouvement sont au cœur de l’analyse des juges européens et notamment en considération des articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La dégradation temporaire des conditions de détention au visa des articles 3 et 8 de la Convention
Alors que les juges internes avaient écarté l’existence de traitements inhumains ou dégradants et d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 en se fondant sur les diligences accomplies par les autorités compétentes pour remédier à cette situation, la Cour européenne a refusé de prendre en considération ces éléments. Le caractère indigne des conditions de détention subies temporairement a été reconnu au regard de l’effet cumulatif des restrictions subies.
Le caractère inopérant des considérations de sécurité et de maintien de l’ordre au sein de l’établissement
Les requérants alléguaient d’un confinement en cellule durant une vingtaine de jours sans accès satisfaisant à de la nourriture, en qualité et en quantité, aux cantines (achats personnels) et aux soins. Ils relataient par ailleurs la réalisation de fouilles violentes et humiliantes durant la période de blocage et faisaient état de la privation de contact avec l’extérieur, qu’il s’agisse des familles ou des avocats. Le gouvernement a reconnu le confinement en cellule, la réduction des effectifs ayant temporairement nécessité une interruption des promenades et activités. Il est également établi que ce manque de personnel a justifié une cessation des parloirs et de l’organisation de l’accès au téléphone. Néanmoins, les courriers à destination des avocats et provenant de ces défenseurs ont été distribués. Si la cantine n’a pu faire l’objet d’une distribution, il est soutenu que des repas ont été distribués aux détenus. En ce qui concerne l’accès au personnel médical, le gouvernement précise qu’aucune demande de rencontre n’a été formulée par les personnes incarcérées.
Il est intéressant de constater que les juges européens ont opéré une vérification, dans les rapports des autorités de contrôle, quant aux conditions habituelles de détention relevées au sein du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Ainsi, il résulte du rapport du 7 avril 2017 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants que cet établissement présente de très bonnes conditions matérielles de détention. La dégradation de celles-ci a été rattachée, par les juges internes, à une situation présentant un caractère imprévisible et subi par les autorités compétentes, à savoir une grève du personnel en réponse à une agression au couteau par une personne détenue. Ainsi, les juges européens ont eu à statuer sur une dégradation temporaire des conditions de détention des requérants dans un établissement ne présentant pas, en temps normal, de problématiques particulières à cet égard.
Tout en reconnaissant que de fortes contraintes d’ordre et de sécurité ont pesé sur les autorités pénitentiaires dans les circonstances de l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme affirme cependant que l’appréciation du caractère indigne des conditions de détention ne saurait reposer sur la prise en compte des justifications apportées au nom des considérations de sécurité et de maintien de l’ordre au sein de l’établissement. Aussi, malgré la brièveté en termes de durée du mouvement social et des diligences effectuées par les autorités afin de rétablir la situation, l’effet cumulé du confinement, du défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels et de la privation de contacts avec le monde extérieur, a exposé les requérants à des conditions de détention ne satisfaisant pas leurs besoins élémentaires, dans une mesure telle qu’elles doivent être regardées comme indignes en ce qu’elles ont nécessairement engendré chez les requérants une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la privation de liberté.
La Cour européenne refuse ainsi de prendre en compte la situation d’espèce s’analysant comme exceptionnelle en considération des conditions de détention habituelles dans cet établissement. Elle témoigne, par ce positionnement, d’un pas supplémentaire dans la volonté de protection des droits et libertés des personnes détenues que les juges européens appréhendent comme étant en situation de vulnérabilité. Celle-ci est qualifiée de « vulnérabilité structurelle » en ce qu’elle est liée, d’une part, à la privation de liberté et, d’autre part, à la situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire (M. Guyomar, L’extension du contrôle : le cas du milieu carcéral, JCP Adm. 2010. 2065).
L’appréciation au regard de l’effet cumulatif des conditions
L’on retrouve dans l’argumentation des juges européens l’utilisation de la théorie de l’effet cumulatif. En l’occurrence, les juges de Strasbourg prennent en considération l’effet cumulatif des conditions de détention subies (CEDH 6 mars 2001, Dougoz c/ Grèce, n° 40907/98, § 46, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss ![]() ; RSC 2001. 881, obs. F. Tulkens
; RSC 2001. 881, obs. F. Tulkens ![]() ; 20 oct. 2016, Mursic c/ Croatie, n° 7334/13, § 140, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen
; 20 oct. 2016, Mursic c/ Croatie, n° 7334/13, § 140, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ![]() ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert
; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert ![]() ; 17 nov. 2015, Bamouhammad c/ Belgique, n° 47687/13, § 133, Dalloz actualité, 18 nov. 2015, obs. C. Fleuriot) afin de conclure à une violation de l’article 3 de la Convention, là où, prises indépendamment, les allégations des personnes détenues ne pourraient suffire.
; 17 nov. 2015, Bamouhammad c/ Belgique, n° 47687/13, § 133, Dalloz actualité, 18 nov. 2015, obs. C. Fleuriot) afin de conclure à une violation de l’article 3 de la Convention, là où, prises indépendamment, les allégations des personnes détenues ne pourraient suffire.
En outre, à titre d’exemple, dès lors que l’espace en cellule, bien que très restreint, est supérieur au minimum de 3m2 posé par la jurisprudence, la conformité à la Convention européenne est appréciée en considération des autres aspects des conditions matérielles de détention (CEDH 10 févr. 2011, Nisiotis c/ Grèce, n° 34704/08, § 39 ; 1er oct. 2011, Taggatidis et autres c/ Grèce, n° 2889/09, § 21). Un isolement combiné avec des conditions matérielles jugées inadéquates (absence d’hygiène suffisante, utilisation de seaux hygiéniques en plastique, insuffisance en termes de qualité et de quantité des repas) constitue un traitement inhumain et dégradant (CEDH 27 nov. 2012, Chervenkov c/ Bulgarie, n° 45358/04, § 67). Les juges sont allés jusqu’à appliquer le qualificatif de traitement inhumain et dégradant à un combiné de mesures sécuritaires répétitives indépendamment des conditions de détention (transfèrements, fouilles, isolement notamment, CEDH, gr. ch., 9 juill. 2009, Khider c/ France, n° 39364/05, § 133, Dalloz actualité, 2 sept. 2009, obs. S. Lavric ; AJDA 2010. 994, étude M. Moliner-Dubost ![]() ; D. 2009. 2462
; D. 2009. 2462 ![]() , note M. Herzog-Evans
, note M. Herzog-Evans ![]() ; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ![]() ; ibid. 2010. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; ibid. 2010. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ![]() ; AJ pénal 2009. 372, obs. M. Herzog-Evans
; AJ pénal 2009. 372, obs. M. Herzog-Evans ![]() ; RSC 2010. 225, obs. J.-P. Marguénaud
; RSC 2010. 225, obs. J.-P. Marguénaud ![]() ; ibid. 645, chron. P. Poncela
; ibid. 645, chron. P. Poncela ![]() ).
).
Par le biais de l’arrêt commenté, la Cour est allée au-delà en écartant simplement l’argument tenant à la courte durée des restrictions subies et à l’implication des autorités pour trouver rapidement un solutionnement au manque d’effectif dans un contexte où, rappelons-le, le droit de grève n’est pas reconnu au personnel pénitentiaire. Elle s’est positionnée dans la continuité de la jurisprudence Clasens c/ Belgique (CEDH 28 mai 2019, Clasens c/ Belgique, n° 26564/16) s’intéressant également aux répercussions d’un mouvement social du personnel pénitentiaire.
Si le droit au sein du milieu carcéral est généralement appréhendé comme un « droit emprisonné » conditionné à la prise en considération d’impératifs sécuritaires (G. Salle et G. Chantraine, Le droit emprisonné ? Sociologie des usages sociaux du droit en prison, Politix 2009/3, n° 87, p. 93 s.), la Cour européenne se place comme véritable précurseur en matière de respect des droits et libertés des personnes incarcérées. À cet égard d’ailleurs, il est intéressant de constater que la chambre criminelle de la Cour de cassation a usé récemment de la théorie de l’effet cumulatif, laquelle a été longtemps écartée par les juges français (F. Charlent, Conditions matérielles de détention : un recours complexe contre l’indignité, Dalloz actualité, 4 mars 2024).
Le référé-liberté au regard des exigences de recours effectif
Les requérants alléguaient de l’absence de recours effectif leur permettant d’obtenir rapidement des mesures de nature à mettre un terme à la situation d’indignité. Afin de se positionner, les juges européens ont fait application, concernant certains requérants, de la théorie de l’exception préliminaire. Ils ont, pour ceux ayant effectivement engagé les recours nationaux, effectué une distinction quant à la nature de la cause de l’indignité des conditions de détention.
L’application de la théorie de l’exception préliminaire
Par l’arrêt commenté, la Cour européenne rappelle en premier lieu les exigences en matière d’effectivité des recours internes. Ainsi, afin qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, des recours préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire. Le recours préventif doit être de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre une amélioration des conditions matérielles de détention. Une fois que la situation dénoncée a cessé, la personne doit disposer d’un recours indemnitaire (CEDH 31 oct. 2019, Ulemek c/ Croatie, n° 21613/16, §§ 71 et 72 ; 30 janv. 2020, J.M.B. et autres c/ France, nos 9671/15 et autres, § 167, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ![]() ; ibid. 1064
; ibid. 1064 ![]() , note H. Avvenire
, note H. Avvenire ![]() ; D. 2020. 753, et les obs.
; D. 2020. 753, et les obs. ![]() , note J.-F. Renucci
, note J.-F. Renucci ![]() ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ![]() ; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; ibid. 1643, obs. J. Pradel ![]() ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud
; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ![]() ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud
; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ![]() ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré
; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ![]() ).
).
Les juges européens ont constaté l’existence de deux voies de recours indépendantes l’une de l’autre, l’action préventive ne conditionnant pas ou ne s’exerçant pas au préjudice de l’action compensatoire. Ils ont retenu que cette articulation des voies de recours est conforme à l’approche retenue par sa jurisprudence en dépit de la brièveté de la période de détention litigieuse. De ce fait, les juges européens ont relevé que plusieurs des requêtes présentées sont mal fondées au vu de l’absence d’engagement des recours français, préventif ou compensatoire, aux fins d’amélioration immédiate des conditions de détention.
Le positionnement de la Cour européenne est novateur en ce qui concerne les requêtes jugées recevables dès lors que l’affaire commentée a confronté les juges à une appréciation des pouvoirs du juge du référé-liberté dans une contexte propre, n’ayant pas jusqu’alors fait l’objet d’un recours. Ces requêtes en référé-liberté ont été rejetées par le juge français du fait de la programmation d’un rendez-vous au sein de l’établissement pénitentiaire en vue de parvenir à un règlement du conflit.
L’effectivité du référé-liberté vis-à-vis d’un évènement ponctuel
Le juge administratif, saisi d’un référé-liberté, recours préventif régi par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut, en cas d’urgence, ordonner toute mesure nécessaire afin de remédier à une « atteinte grave et manifestement illégale » portée à une liberté fondamentale. Dans ce cadre, il dispose de pouvoirs d’instruction : il peut réaliser des visites sur place (CJA, art. R. 622-1), engager une procédure d’enquête (CJA, art. R. 623-1), demander un avis technique (CJA, art. R. 625-2) ou consulter une personne compétente (CJA, art. R. 625-3).
Les requérants, pour opposer l’absence de caractère effectif de ce recours, ont indiqué que d’un point de vue pratique, le référé-liberté n’est pas de nature à leur permettre d’obtenir immédiatement une amélioration de leurs conditions de détention, et notamment du fait du délai déraisonnable de la procédure et des difficultés d’exécution des mesures d’urgence susceptibles d’être prononcées par le juge du référé‑liberté. En tant que tiers intervenant, l’OIP a souligné que le juge des référés ne fait jamais usage de ses pouvoirs d’instruction et que la comparution du détenu à l’audience de référé est rare, ce qui implique que le juge statue principalement sur la base des observations de l’administration pénitentiaire.
Par l’arrêt commenté, la Cour a eu à se prononcer sur le caractère effectif du recours préventif ouvert devant le juge administratif, dans l’hypothèse où, comme dans le cas d’espèce, les conditions de détention dont l’indignité est alléguée découlent d’un évènement ponctuel présentant un caractère provisoire et exceptionnel. L’effectivité du référé-liberté au regard des pouvoirs d’injonction du juge a déjà été étudiée dans le cadre de la situation de surpopulation carcérale (CEDH 30 janv. 2020, J.M.B. et autres c/ France, préc., §§ 217 à 220). Dans ce cas, les juges européens avaient retenu que les limites du pouvoir d’injonction du juge des référés l’empêchent de remédier aux atteintes aux droits garantis aux détenus par l’article 3 qui appelaient la prescription par le juge de mesures structurelles. Les juges avaient affirmé, dans un tel contexte, que le référé-liberté ne constitue pas une voie de recours préventive effective.
Dans la présente affaire et à la différence de l’affaire J.M.B et autres, les circonstances ne relèvent pas de problèmes structurels susceptibles d’affecter l’efficacité de cette voie de recours, en ce que le fait générateur du grief soulevé par les requérants réside dans le mouvement social engagé à la suite de l’agression de deux surveillants. Dans ce cadre, la Cour européenne affirme que le juge du référé-liberté tire de l’exercice de son pouvoir d’injonction la possibilité d’ordonner des mesures provisoires de nature à remédier aux atteintes alléguées aux droits des requérants protégés par l’article 3 de la Convention, concernant notamment l’hygiène, les promenades ou les contacts avec les familles ainsi que la pratique des fouilles.
À cet égard, les juges européens affirment qu’il ne résulte ni des éléments du dossier de la procédure devant le juge interne, ni des éléments apportés par les requérants devant la Cour que les autorités pénitentiaires n’auraient pas été en mesure d’exécuter de manière satisfaisante de telles mesures. Aucune carence structurelle n’empêchait l’exécution des mesures prescrites par le juge du référé, comme dans l’affaire Clasens c/ Belgique (préc.). Dans cette dernière, les juges ont retenu que « l’absence d’encadrement de la continuité des missions des agents pénitentiaires en période de grève est à l’origine de l’ineffectivité du recours et a compromis l’exécution de la décision favorable prononcée par le juge judiciaire ». Néanmoins, du fait de l’absence de mesure prononcée par le juge des référés dans l’affaire commentée, il est difficile d’opérer une réelle comparaison entre les deux situations et le rapprochement opéré par les juges est difficilement lisible.
CEDH 18 avr. 2024, Leroy et autres c/ France, nos 32439/19, 37876/19 et 46898/19
© Lefebvre Dalloz