La mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire ne vaut pas renonciation tacite à la prescription
Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de ladite créance. En l’occurrence, si l’information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
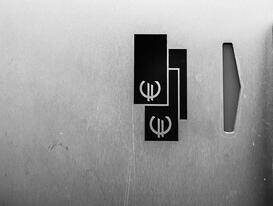
En matière de procédures collectives, le stade de la vérification du passif comporte un nombre important de pièges procéduraux pour les différentes personnes intéressées par cette étape.
L’arrêt ici rapporté, par la solution qu’il apporte, nous paraît en déjouer un.
Avant d’entrer dans les détails de la solution, revenons sur quelques règles applicables en matière.
L’article L. 622-6 du code de commerce indique que le débiteur doit notamment remettre, dans les huit jours de l’ouverture de la procédure aux organes de celle-ci (C. com., art. R. 622-5), la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Or, puisqu’elle doit comprendre l’énumération des créanciers et du montant des dettes, il s’agit, en quelque sorte, de la toute première information dont disposeront les organes de la procédure quant à la composition du passif du débiteur.
En outre, bien que cela ne concerne pas la situation de l’espèce (même si la Cour de cassation prend le soin de le rappeler dans sa solution), il faut souligner que, depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le troisième alinéa de l’article L. 622-24 prévoit que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi en déclaration de créance pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration dans le délai prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce.
À cet égard, bien qu’il ne s’agisse pas « d’un instrument imposé », la connaissance par le mandataire des créances que le débiteur déclare pour le compte des créanciers va s’opérer d’une façon quasi systématique en raison des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
Au regard de ce qui précède, est-ce à dire qu’en portant une créance à la connaissance du mandataire par le canal de l’article L. 622-6, le débiteur en reconnaîtrait le bien-fondé, ce qui l’empêcherait ensuite de la contester ?
La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative et bien que le débiteur mentionne une créance au sein de la liste de l’article L. 622-6 et la déclare donc pour le compte du créancier, il n’est pas privé, par la suite, du droit de la contester (Com. 23 mai 2024, nos 23-12.133 FS-B et 23-12.134 FS-B, Dalloz actualité, 3 juin 2024, obs. B. Ferrari ; D. 2024. 1454 ![]() , note J.-L. Vallens
, note J.-L. Vallens ![]() ; ibid. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 1691, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ![]() ; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret
; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret ![]() ; RTD com. 2024. 745, obs. A. Martin-Serf
; RTD com. 2024. 745, obs. A. Martin-Serf ![]() ).
).
L’arrêt ici rapporté s’inscrit dans le sillage de ce précédent arrêt. En l’occurrence, la question se posait de savoir si en mentionnant une créance sur la liste de l’article L. 622-6 le débiteur renoncerait tacitement à sa prescription, le privant donc du droit de la contester ultérieurement sur le terrain de la prescription.
L’affaire
En l’espèce, un créancier a déclaré une créance au passif de la procédure collective de son débiteur. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu’elle serait prescrite.
En réponse, le créancier a assigné le débiteur, les organes de la procédure, ainsi que la caution aux fins de voir admettre sa créance au passif et de condamner la caution à lui régler une certaine somme correspondant au montant de la créance déclarée.
La caution a, quant à elle, demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire et, subsidiairement, de déclarer les demandes du créancier irrecevables en ce qu’elles seraient prescrites.
Par la suite, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.
L’affaire est portée en appel et les juges du second degré vont également considérer l’action du créancier prescrite.
Ce dernier se pourvoit en cassation, car selon lui la remise de la liste de l’article L. 622-6 du code de commerce par le débiteur au mandataire judiciaire manifestait la renonciation non équivoque du premier à se prévaloir du bénéfice de la prescription à l’égard du créancier, dans la mesure où la créance en cause y figurait.
Fort logiquement à notre sens, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La solution
La Cour de cassation rappelle, d’abord, qu’il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or, sur le fondement de ces règles, elle en déduit, ensuite, que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
Analyse
L’arrêt ici rapporté vient utilement compléter la jurisprudence relative à la portée de la liste de l’article L. 622-6 du code de commerce. En l’occurrence, nous commencerons par revenir sur cette dernière avant de nous intéresser au fait que, comme l’affirme la Cour de cassation, la seule mention d’une créance au sein de ladite liste ne peut s’analyser en une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription de ce droit.
Retour sur la portée de la liste de l’article L. 622-6
Comme nous l’indiquions, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que bien que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire par le biais de la liste de l’article L. 622-6 fasse présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, elle ne valait pas reconnaissance par le débiteur de son bien-fondé, de sorte qu’il pouvait ultérieurement la contester (Com. 23 mai 2024, nos 23-12.133 et 23-12.134, préc.).
Certes, de prime abord, il aurait pu être séduisant de considérer que l’information transmise par le débiteur quant à certaines de ses dettes valait reconnaissance par lui du bien-fondé des créances en question.
À tout le moins, c’est ce qu’un auteur en avait déduit au lendemain de la parution de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 : lorsque le débiteur porte à la connaissance du mandataire une créance et que, ce faisant, il la déclare pour le compte du créancier, « la logique voudrait qu’il soit privé de la possibilité de contester [par la suite] la créance » (D. Boustani-Aufan, De quelques aspects procéduraux de la contestation de créances au regard de l’ordonnance du 12 mars 2014, BJE janv. 2015, n° 111u7, p. 52, spéc. n° 13).
Au regard de ce qui précède, l’on aurait même pu y voir une forme de violation du principe de l’estoppel dans la possibilité pour le débiteur de contester une créance dont il a lui-même mentionné l’existence (G. Jazottes et F. Legrand, Déclaration par le débiteur : retour d’expérience et difficultés, BJE janv. 2017, n° 114b4, p. 66).
Toutefois, ces arguments doivent être combattus pour affirmer, avec la Cour de cassation et certains praticiens (S. Barbot, P. Cagnoli, V. Leloup-Thomas et C. Faure, La créance déclarée, RPC 2023/3. Dossier 21, spéc. n° 15), que la présomption de déclaration de créance par le débiteur ne peut valoir reconnaissance de dette.
En l’occurrence, l’essence même de la liste de l’article L. 622-6 permet d’asseoir le raisonnement.
Du reste, le fait que l’information de telle ou telle créance parvienne au mandataire par le biais de la liste de l’article L. 622-6 ne préjuge pas de la reconnaissance de son bien-fondé par le débiteur. La raison est extrêmement simple : il a l’obligation de mentionner toutes les créances, et ce, y compris, celles qui ne seraient pas certaines !
Au demeurant, c’est ce qu’avait déjà eu l’occasion d’affirmer la Cour de cassation. Selon elle, l’article L. 622-6 « impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Ce dernier texte ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l’information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant » (Com. 2 févr. 2022, n° 20-19.157 NP, RTD com. 2022. 375, obs. A. Martin-Serf ![]() ).
).
Autrement dit, le fait que le contenu de la liste imposée par l’article L. 622-6 du code de commerce puisse, par exemple, in fine valoir déclaration de créance pour le compte du créancier est presque fortuit pour le débiteur, car bien que bénéficiant d’une présomption, c’est au créancier qu’il incombe de procéder à sa propre déclaration de créance dans les délais !
De surcroît, il paraîtrait assez incongru de voir dans la liste de l’article L. 622-6 un mécanisme de reconnaissance de dettes, là où le débiteur a même l’obligation de mentionner les créances qui seraient incertaines. Plus encore, il y a même une certaine antinomie avec la figure de la reconnaissance de dette qui est toujours un acte volontaire !
Au vrai, nous retrouvons au sein de l’arrêt sous commentaire la même contradiction à essayer d’élever la liste de l’article L. 622-6 du code de commerce au rang d’une prétendue renonciation tacite à la prescription d’une créance qui y serait mentionnée.
Pas de renonciation tacite à la prescription d’une créance mentionnée dans la liste de l’article L. 622-6
L’article 2251 du code civil indique que la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite. En somme, le même texte précise que si la renonciation est tacite, cette dernière résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En réalité, la rédaction de ce texte – issue de la loi du 17 juin 2008 – a consacré tout un courant jurisprudentiel selon lequel la renonciation tacite à la prescription ne peut provenir que d’actes accomplis volontairement, « en pleine connaissance de cause » et « manifestant de façon non équivoque l’intention du prétendu renonçant », étant entendu que la simple reconnaissance de l’existence d’une dette ne peut avoir pour effet de faire renaître un droit prescrit (v. par ex., Com. 1er mars 1971, n° 69-12.075 P – il s’agit d’une position constante, v. par ex., Com. 8 avr. 2021, n° 19-17.957 NP).
Partant, l’on se rend bien compte que la seule mention d’une créance au sein de la liste de l’article L. 622-6 ne pouvait être qualifiée d’acte de renonciation tacite à la prescription.
Pour comprendre cette dernière affirmation, il faut s’intéresser, encore une fois, à l’essence de la liste de l’article L. 622-6.
D’abord, relevons que même si la version du texte n’était pas applicable au sein de l’espèce commentée, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 est venue apporter une précision intéressante quant à la vocation de la liste au cœur de l’analyse. Désormais, le texte précise que l’obligation faite au débiteur de remettre certaines informations dès l’ouverture de la procédure aux organes de cette dernière s’inscrit « dans les besoins de l’exercice de leur mandat ».
Or, si elle est éclairante, la « nouvelle » rédaction du texte ne change rien au droit positif, car aujourd’hui comme hier l’essence de l’article L. 622-6 est de permettre aux organes de la procédure d’avoir une première idée sur l’étendue du passif et de l’actif du débiteur dans les liens de la procédure collective.
Cela étant, la précision apportée permet de se convaincre qu’il est impossible de voir dans la mention d’une créance au sein de la liste, d’une part, une quelconque reconnaissance de dette de la part du débiteur, et d’autre part, une tout aussi éventuelle preuve d’une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription de l’une des créances qui y seraient mentionnées.
Au demeurant, l’un des objectifs de la liste est simplement « de faciliter la vie » des mandataires de justice.
Dans la même veine, lorsque l’information sur la créance parvient au mandataire par le biais de la liste de l’article L. 622-6 du code de commerce, il est intéressant de relever qu’aucune marge de manœuvre n’est octroyée au débiteur. Si nous formulons cette remarque, c’est que le débiteur est en quelque sorte obligé de mentionner toutes les créances – même s’il envisage de les contester – puisque s’il est de mauvaise foi, l’article L. 653-8 du code de commerce sanctionne ce défaut de mention par une interdiction de gérer.
Partant, voir dans la liste de l’article L. 622-6 un mécanisme de renonciation volontaire à la prescription d’une créance reviendrait à encourager le débiteur à prendre le risque du prononcé d’une sanction professionnelle : ce dernier pouvant être plus réticent à mentionner, dès l’ouverture de la procédure, l’existence de telle ou telle créance.
Suivant la même logique, ce serait aussi participer à l’explosion des actions en relevé de forclusion, ralentissant le déroulement de la procédure, sur le motif d’une omission du créancier de la liste de l’article L. 622-6, motif que l’on sait désormais « automatique » quant à l’obtention d’un relevé de forclusion (Com. 16 juin 2021, n° 19-17.186 FS-P, Dalloz actualité 28 juin 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 1183 ![]() ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ![]() ; ibid. 2262, chron. S. Barbot, C. Bellino et C. de Cabarrus
; ibid. 2262, chron. S. Barbot, C. Bellino et C. de Cabarrus ![]() ; Rev. sociétés 2021. 551, obs. F. Reille
; Rev. sociétés 2021. 551, obs. F. Reille ![]() ; Rev. prat. rec. 2021. 71, chron. P. Roussel Galle et F. Reille
; Rev. prat. rec. 2021. 71, chron. P. Roussel Galle et F. Reille ![]() ; RTD com. 2021. 919, obs. A. Martin-Serf
; RTD com. 2021. 919, obs. A. Martin-Serf ![]() ).
).
Finalement et au regard de ces derniers inconvénients, la solution posée en l’espèce nous paraît donc parfaitement respectueuse des intérêts en présence et vient utilement compléter la construction jurisprudentielle relative à la portée de la liste de l’article L. 622-6.
Com. 11 déc. 2024, F-B, n° 23-13.300
© Lefebvre Dalloz