La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (2e partie)
La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.
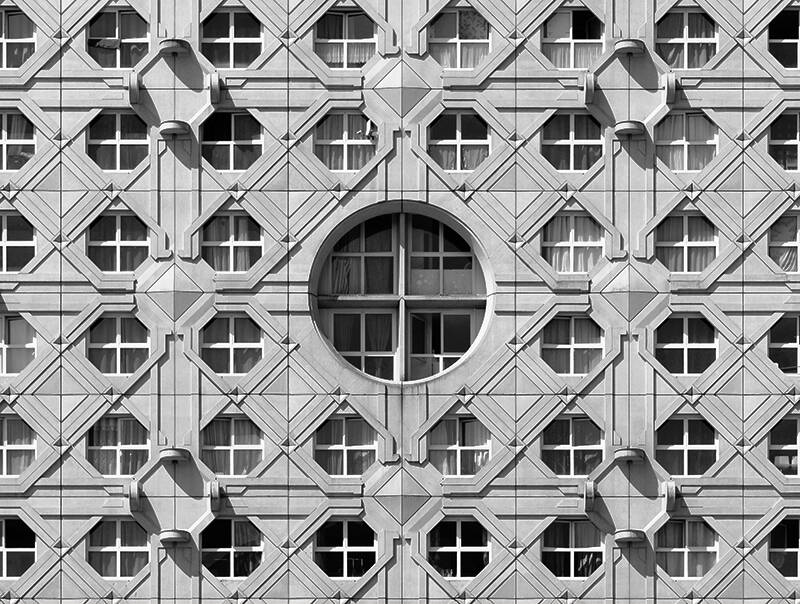
Fiche 2 : la césure du procès
La césure fait l’objet des articles 807-1 à 807-3 du code de procédure civile créés par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, l’article 905 dudit code étant modifié pour l’intégrer. Aucun article ne donne une définition de la « césure du procès », ni même ne la mentionne mais leur lecture permet de comprendre le mécanisme.
Il consiste pour les parties à scinder leurs prétentions et à solliciter du tribunal judiciaire qu’il rende un jugement partiel uniquement sur les prétentions qu’elles déterminent : le régime de ce jugement est exposé (il est susceptible d’appel immédiat et peut-être assorti de l’exécution provisoire).
En revanche, le sort des prétentions non concernées par la clôture n’est pas envisagé par le décret. De plus, il n’est jamais fait mention de l’amiable si ce n’est dans la notice du décret : « les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice », si bien que « les parties peuvent tout aussi bien rester dans une position purement contentieuse et attendre que la mise en état des questions restantes soit close »1.
Alors que le décret est peu disert sur la césure, et totalement muet sur l’amiable annoncé par son intitulé, la circulaire présente les conditions d’ouverture, la clôture partielle, le jugement partiel, la poursuite de la mise en état et l’issue de l’instance – confirmant ou infirmant les interprétations doctrinales2.
D’emblée, la circulaire introduit un vocabulaire pertinent (qui ne figure pas dans le décret) : elle décrit la césure comme permettant « de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents via un MARD [mode alternatif de règlement des différends] ou, à défaut, un resserrement du débat judiciaire »3. Pour autant, elle ne fournit pas d’exemple de « points nodaux ». On peut en trouver dans la pratique de la chambre de la propriété intellectuelle du Tribunal judiciaire de Paris4 : dans un litige de contrefaçon, le tribunal judiciaire peut d’abord statuer sur la question de la validité d’un brevet et reporter l’examen des actes de contrefaçon : si le brevet est nul, l’examen de la contrefaçon est inutile…
Une difficulté vient de ce que, passée l’introduction générale et celle de la fiche 25, la circulaire ne parle plus de points nodaux d’un côté et de points subséquents de l’autre, mais de prétentions séparables, qui pourraient dès lors être d’égale importance, sans hiérarchie entre elles. Or cette conception de la séparabilité de prétentions « égales » l’emporte sur celle de leur hiérarchisation : la circulaire n’est dès lors plus très claire sur le déroulement de la césure.
Conditions d’ouverture
La circulaire reprend l’article 807-1 du code de procédure civile qui évoque l’initiative de la césure et la forme de la demande : « À tout moment, l’ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état [JME] la clôture partielle de l’instruction. Elles produisent à l’appui de leur demande un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel ». Elle précise que les conclusions doivent être spécialement adressées au JME ce qui va de soi (C. pr. civ., art. 791).
En revanche elle apporte des précisions sur le « périmètre » : seules les parties identifient et déterminent les prétentions qui seront concernées par la clôture partielle – ce qui n’empêche pas une « discussion sur le périmètre de la césure entre le juge et les avocats » ; elle insiste sur la « séparabilité des prétentions »6.
Clôture partielle
Bien que cela aille de soi, la circulaire informe les lecteurs que l’ordonnance de clôture partielle consiste en une nouvelle catégorie d’ordonnance de clôture (l’article 807-2 c. pr. civ. renvoie aux articles 798, 799, alinéas 2 à 4, ainsi que 802 à 807)7, dont l’objet n’est pas de sanctionner un comportement (comme celle de l’article 800 c. pr. civ.), mais qui demeure une mesure d’administration judiciaire – que le JME ordonne « en opportunité ».
La circulaire évoque surtout les suites de la demande de césure :
- soit le JME la rejette et la mise en état poursuit son cours… sans amiable ;
- soit le JME y fait droit et il y a scission du litige : « la mise en état est poursuivie quant aux prétentions qui sont hors du champ de la clôture partielle »8.
Ce qui peut sembler surprenant : pourquoi ne pas mettre la mise en état « en sommeil », en attendant le jugement partiel9 : quelles serait l’utilité de mesures d’instruction si la prétention sur la « question nodale » était rejetée ? On l’a dit, dans un litige de contrefaçon, si le brevet est nul, l’examen de la contrefaçon est inutile et les mesures d’instruction éventuellement ordonnées seraient caduques10 … Cela n’a de sens que pour des prétentions séparées du « reste », qui ne sont pas nodales mais « égales ».
En outre, puisque la césure peut être demandée à tout stade de la mise en état, il semble que celle-ci puisse avoir besoin d’être parachevée avant un renvoi à la formation de jugement : ni le décret, ni la circulaire, ne l’évoque (?).
Jugement partiel
Là encore, bien que cela aille de soi, la circulaire informe les lecteurs que le jugement partiel consiste en une nouvelle catégorie de jugement11 (elle aurait pu ajouter qui ne se confond pas avec les jugements qui tranchent une partie du principal, avant-dire droit et mixtes)12.
De même, ni le décret, ni la circulaire, ne disent que ce jugement a autorité de la chose jugée ; or, étant défini comme « tranch[ant] dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1 » (C. pr. civ., art. 807-2, al. 1er), il est logiquement pourvu de cet attribut du jugement.
La circulaire précise encore que le jugement partiel « est rendu à l’issue d’une audience de plaidoirie, sauf à ce qu’il soit recouru à une procédure sans audience »13 … ce qui résulte du renvoi, par l’article 807-2 du code de procédure civile, à l’article 799, alinéas 2 à 4 : ce n’est d’ailleurs pas surprenant, en procédure écrite ordinaire.
Ce qui est curieux, en revanche, c’est la règle posée à l’article 807-2, alinéa 2, du code de procédure civile, que la circulaire reprend : celle de l’exécution provisoire facultative. Or, comment exécuter un jugement qui ne tranche qu’un « point nodal », un principe de validité ou de responsabilité, par exemple, sans concrétisation qui dépend de la phase laissée à la mise en état ?14 Là encore cette exécution provisoire ne se conçoit que pour des prétentions séparées du « reste », qui ne sont pas nodales et peuvent donc être exécutées immédiatement…
La circulaire rappelle que les article 544 et 905 du code de procédure civile ont été modifiés afin de permettre l’appel immédiat des jugements partiels, selon la procédure à bref délai de l’article 90515. Enfin, elle confirme que « l’appel du jugement partiel n’est pas un motif d’interruption du délai de péremption de l’instance afin de permettre la poursuite de la mise en état sur des prétentions subséquentes » : la doctrine l’avait compris avec inquiétude dans le silence du décret16.
Poursuite de la mise en état et l’issue de l’instance
Sur ce point, la circulaire apporte des éléments non prévus par le décret, puisqu’elle traite en effet de la mise en état qui se poursuit pour les prétentions non concernées par la clôture partielle. En substance, il s’agit d’une mise en état « normale », mais la circulaire insiste sur la possibilité pour les parties de « parvenir à un accord sur le “reste” des prétentions, en recourant notamment à la médiation, à la conciliation voire à une ARA, et [de] formaliser leur accord selon les règles du droit commun. Elles pourront notamment présenter au juge de la mise en état (C. pr. civ., art 785, al. 3) ou au juge du fond (C. pr. civ., art. 131-12 et 1565) une demande d’homologation de leur accord accompagnée d’une demande de désistement d’instance »17. Ce qui, on l’a dit, laisse perplexe au moins dans l’hypothèse où les prétentions « restantes » sont la suite du point nodal : comment conclure un accord alors que ce point n’est pas encore tranché ?
D’ailleurs, la circulaire – à la suite de l’article 807-3 du code de procédure civile – précise que la mise en état ne peut être totalement close (sur les prétentions non concernées par la clôture partielle puis le jugement partiel) que lorsque le jugement partiel ne peut plus faire l’objet d’un appel soit parce que le délai d’appel est expiré soit parce qu’un appel a été interjeté sur lequel la cour a statué »18. Solution justifiée par le lien entre la question nodale et « le reste », qui rend difficilement compréhensible la poursuite des échanges entre parties dans le cadre de la mise en état… sauf égalité des prétentions séparées19.
Aide juridictionnelle
La circulaire renvoie au décret n° 2020-1717 du 28 décembre 202020.
Fiche 3 : l’article 750-1 du code de procédure civile
La circulaire et la fiche 3 traitent ensuite du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui a rétabli l’article 750-1 du code de procédure civile21.
La fiche 3 rappelle le cadre juridique de l’obligation de tenter un préalable amiable avant de saisir le tribunal judiciaire, à savoir que l’article 750-1 est une disposition d’application de la loi JXXI, « dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 » (en oubliant au passage qu’elle a encore été modifiée par la loi n° 2021- du 22 déc. 2021), que l’article 750-1 a été annulé sans rétroactivité par le Conseil d’État puis rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur le 1er octobre 2023 : il en résulte que « seule la dérogation liée à l’indisponibilité des conciliateurs a été modifiée »22.
La fiche traite donc essentiellement de cette dérogation, rappelant que désormais un critère objectif est retenu : « l’indisponibilité des conciliateurs est établie lorsqu’elle entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ». La doctrine s’était interrogée, car, si la preuve de l’indisponibilité peut être rapportée par tout moyen, cela n’est pas forcément simple23 : « faudra-t-il penser à enregistrer un appel téléphonique au conciliateur, par exemple, pour attester qu’il a accepté de s’occuper du cas du justiciable… mais que la première réunion n’est organisée que plus de trois mois après cet appel ? Quid si ledit justiciable ne sait pas enregistrer ou n’y pense pas ? »24 … Que « désigne concrètement “l’organisation de la première réunion de conciliation” » ?25 Une réunion d’information des parties qui ne serait pas suivie d’autres démarches faute de volonté des parties est-elle suffisante ? […]. Qu’est-ce que la “saisine” du conciliateur ? Est-ce le moment où il accepte la mission ? »26.
C’est à de telles questions que la circulaire s’efforce de répondre, sans totalement convaincre, notamment à propos de la saisine du conciliateur dont il est rappelé – par renvoi à l’article 1536 du code de procédure civile – qu’elle est sans forme et doit le rester27 …
Tout d’abord, elle affirme que justifier de l’indisponibilité du conciliateur « suppose pour le demandeur de démontrer deux éléments de fait dont il peut apporter la preuve par tout moyen », à savoir « la date à laquelle le conciliateur a été saisi » et « l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et la date à laquelle une première réunion de conciliation sera proposée »28 :
- pour la date, la circulaire donne des exemples : la preuve pourra être rapportée par l’accusé de réception délivré à l’occasion d’une démarche en ligne, par un avis de réception du courrier de saisine adressé à un conciliateur,… Inversement lorsque le justiciable s’est présenté directement à une permanence, par exemple, il n’existe aucune obligation pour le conciliateur ou pour l’intermédiaire de délivrer aux justiciables une attestation justifiant de sa démarche, mais aucune interdiction non plus : la circulaire considère donc que la délivrance d’une attestation « peut dès lors être recommandée lorsqu’elle est possible » (ce qui n’est ni précis, ni rassurant !). Enfin une simple demande d’information ne constitue pas une saisine d’un conciliateur ;
- pour l’écoulement d’un délai, deux cas de figure sont envisagés : le cas où le justiciable a reçu une réponse et où le délai est d’emblée supérieur à trois mois ; celui où le justiciable n’a reçu aucune réponse dans le délai de trois mois. Dans la première hypothèse, le justiciable sait dès la réponse du conciliateur, qu’il peut saisir la juridiction immédiatement ; dans la seconde, nettement plus préjudiciable, il doit attendre pendant trois mois, en vain, avant de pouvoir saisir la juridiction !
La fiche précise que les dispositions nouvelles n’interdisent ni n’imposent de réaliser plusieurs démarches concomitantes ou consécutives29.
La circulaire termine en rappelant les dispositions d’entrée en vigueur du décret30.
Si le rétablissement de l’article 750-1 du code de procédure civile a été salué par les partisans de l’amiable, qui déploraient la disparition de la fin de non-recevoir de l’article 750-1, nous étions beaucoup plus dubitative, pour ne pas dire critique31. De manière générale, si « l’amiable consenti, l’amiable “amiable” ( !) est évidemment une bonne chose, l’amiable imposé ne l’est pas du tout, “d’une part, parce qu’on ne fait pas s’entendre des personnes qui ne le souhaitent pas, d’autre part, parce qu’il est source lui-même de contentieux ! ”… »32. En outre, il n’est pas certain que la nouvelle rédaction ne sera pas à nouveau annulée si sa nouvelle mouture est à nouveau attaquée devant le Conseil d’État : la circulaire ne lève pas les doutes à cet égard, tant la notion de « saisine du conciliateur » est peu précise, alors qu’il en dépend directement le droit d’accès au juge.
Fiche 4 : l’évaluation de la politique de l’amiable
Enfin la circulaire et la fiche 4 prévoient l’évaluation de la politique de l’amiable : cette fiche concerne essentiellement les magistrats et surtout les greffiers. Il est cependant intéressant de savoir qu’il existe une nomenclature des décisions, dont l’objectif est de décrire le résultat des demandes dont sont saisies les juridictions civiles à titre principal dans les différentes matières33. Le ministère de la Justice cherchant à développer la pratique des MARD dans les affaires contentieuses devant les juridictions, il a procédé à une adaptation de la nomenclature des codes des décisions, afin de pouvoir disposer de statistiques plus fiables sur le recours aux MARD en procédure civile34.
La fiche présente ensuite les modifications des codes décisions relatifs aux MARD et consignes de codage35.
Rendez-vous est maintenant donné dans quelques temps, afin de voir les résultats de cette évaluation : la politique de l’amiable, pour être à la mode et favorisée, sera-elle un succès ? Il est permis d’être, sinon dubitatif, au moins attentiste.
Plus généralement, il sera intéressant de voir si les justiciables/leurs avocats s’emparent des nouveaux outils et comment ils s’en emparent : la réglementation de la césure et son explication par la circulaire laissent entrevoir des difficultés. Quant à l’article 750-1 nouvelle version du code de procédure civile, il n’a pas répondu à des questions posées en doctrine36 ou par des décisions de juges du fond37 qui remonteront inévitablement à la Cour de cassation.
À suivre…
1. G. Maugain, Dalloz actualité, 18 sept. 2023.
2. V. Dalloz actualité, 14 nov. 2023, spéc. note 2.
3. P. 3. ; v. aussi, très proche, la définition donnée par la fiche 2, p. 14.
4. V. aussi, E. Vergès, Lexbase droit privé, 14 sept. 2023.
5. P. 3 et p. 14.
6. Fiche 2, p. 15 et supra.
7. L’ordonnance peut être suivie d’un dépôt de dossiers (simple ou inclus dans une procédure sans audience) et a des conséquences identiques à une ordonnance de clôture dans un procès sans césure (les conclusions postérieures sont en principe irrecevables, un rapport doit être présenté à l’audience, celle-ci peut être tenue à juge unique,…).
8. Fiche 2, p. 15. 3. ; v. aussi, déjà, la notice du décret : « la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle ».
9. E. Vergès, Lexbase droit privé, préc.
10. V. supra.
11. Fiche 2, p. 15.
12. Qui sont déjà des jugements « partiels » au sens courant du terme, puisqu’ils ne tranchent pas tout le principal.
13. Fiche 2, p. 16.
14. E. Vergès, Lexbase droit privé, préc.
15. Fiche 2, p. 16.
16. E. Vergès, Lexbase droit privé, préc. : « Durant cette période, le délai de péremption d’instance court puisque le décret ne prévoit ici aucune interruption ou suspension de l’instance. En d’autres termes, si les parties ne réalisent pas de diligences au cours de la mise en état, elles sont menacées par la péremption d’instance ». L’auteur ajoute « on peut conseiller aux plaideurs de solliciter un sursis à statuer en même temps que leur demande de clôture partielle ».
17. Fiche 2, p. 16.
18. Fiche 2, p. 16.
19. V. supra.
20. Fiche 2, p. 16.
21. Sur l’historique, v. G. Maugain, Dalloz actualité, 23 mai 2023 ; C. Bléry, Lexbase contentieux et recouvrement n° 2 du 29 juin 2023, N5723BZY.
22. Fiche 3, p. 18.
23. C. Bléry, Lexbase contentieux et recouvrement, préc.
24. G. Maugain, Dalloz actualité, 23 mai 2023.
25. C. Bléry, Lexbase contentieux et recouvrement, préc.
26. Fiche 3, p. 19.
27. Fiche 3, p. 19.
28. Fiche 3, p. 19.
29. Fiche 3, p. 19.
30. Fiche 3, p. 20.
31. G. Maugain, Dalloz actualité, 23 mai 2023.
32. C. Bléry, Dalloz actualité, 12 mai 2022.
33. Fiche 4, p. 21 : « elle expose aux greffes et magistrats les trames utiles et les instructions de saisie Winci TGI relatives à l’audience de règlement amiable et à la césure du procès civil qui seront disponibles pour les juridictions à compter du 1er novembre 2023 sur l’espace web de l’intranet justice de la DSJ ainsi que les consignes de codage » (CNB).
34. Fiche 4, p. 21 s.
35. Fiche 4, p. s.
36. C. Bléry, Lexbase contentieux et recouvrement, préc.
37. Par ex., l’art. 750-1 c. pr. civ. joue-t-il pour des demandes reconventionnelles ? Non, selon Douai, 14 sept. 2023, n° 22/04885, mais contra, Nancy, 31 août 2023, n° 23/00212…
© Lefebvre Dalloz