La surveillance nocturne des DPS dans le viseur du Défenseur des droits
La Défenseure des droits estime que le placement automatique des détenus particulièrement signalés (DPS) sous le régime de la surveillance nocturne renforcée, qui implique des rondes et l'allumage répété des cellules pendant la nuit, constitue un traitement inhumain et dégradant qui les prive de leur droit à la dignité en détention et méconnaît leur droit à un recours effectif.
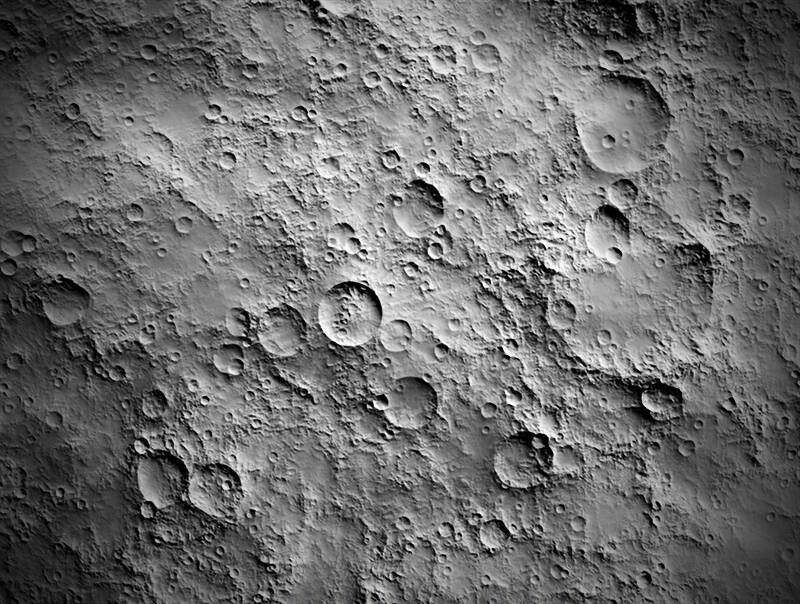
« Les lieux de privation de liberté obéissent la nuit à des règles et procédures pour partie différentes de celles qui prévalent la journée » (CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, Dalloz, 2019, p. 1). En l’occurrence, la sécurité, la surveillance et la gestion des personnes détenues y sont repensées, tant au regard de leurs régimes de détention que des pratiques des personnels pénitentiaires. L’enjeu est majeur, il s’agit du « droit au sommeil » des personnes détenues, et de ses éventuelles incidences sur leur santé et leur dangerosité. Dans la décision soumise à l’étude, deux questions se posaient à propos de leur « droit au sommeil ». Le seul statut de détenu particulièrement signalé (DPS) justifie-t-il le placement sous surveillance nocturne renforcée ? Cette mesure est-elle conforme aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Le contexte
Il faut d’abord rappeler que le placement sous le régime de DPS n’est pas en soi contraire à la Convention européenne (§ 25). Autrement dit, il est conforme aux articles 3 (interdisant les traitements inhumains et dégradants), et 8, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, sous réserve qu’il respecte certaines conditions (CE 30 déc. 2015, n° 383294, Observatoire international des prisons – Section française, § 10 ; v. égal. CE 7 déc. 2015, n° 393668, Garde des Sceaux, Min. de la Justice, Dalloz actualité. 22 déc. 2015, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ![]() ; AJDA 2015. 2415
; AJDA 2015. 2415 ![]() ; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon
; D. 2016. 1220, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ![]() ). D’une part, ce régime ne peut être systématique, et doit donc faire l’objet d’un examen de nécessité et de proportionnalité lors de son prononcé et de son renouvellement (RPE, art. 49, 51.1, 53.1). D’autre part, les mesures de « sécurité » qui y sont adjointes doivent respecter le standard de respect de la dignité humaine (tel qu’il est établi par le droit européen) et les besoins de la personne détenue en matière de « santé » et de « bien-être » (CEDH 17 avr. 2012, Piechowicz c. Pologne, req. n° 20071, § 162 ; v. égal. 2 juill. 2019, n° 27057/06, Gorlov e.a. c. Russie, D. 2020. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
). D’une part, ce régime ne peut être systématique, et doit donc faire l’objet d’un examen de nécessité et de proportionnalité lors de son prononcé et de son renouvellement (RPE, art. 49, 51.1, 53.1). D’autre part, les mesures de « sécurité » qui y sont adjointes doivent respecter le standard de respect de la dignité humaine (tel qu’il est établi par le droit européen) et les besoins de la personne détenue en matière de « santé » et de « bien-être » (CEDH 17 avr. 2012, Piechowicz c. Pologne, req. n° 20071, § 162 ; v. égal. 2 juill. 2019, n° 27057/06, Gorlov e.a. c. Russie, D. 2020. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ![]() ; AJ pénal 2020. 38, obs. M. H-Evans
; AJ pénal 2020. 38, obs. M. H-Evans ![]() ; 28 nov. 2017, n° 70838/13, Antovic et Mirkovic c. Monténégro, D. 2018. 138, obs. J.-F. Renucci
; 28 nov. 2017, n° 70838/13, Antovic et Mirkovic c. Monténégro, D. 2018. 138, obs. J.-F. Renucci ![]() ; 1er juin 2004, n° 8704/03, Van der Graaf c. Pays-Bas). En droit interne, ce régime est prévu par la combinaison des articles 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui prévoit le respect de la dignité de la personne détenue, même si elle est soumise à des mesures de sécurité, et D. 272 du code de procédure pénale, lequel prévoit les modalités de sa surveillance nocturne (v. égal., pour le régime de la surveillance nocturne, Notes, 30 oct. 2018 relative à l’organisation des rondes de nuit ; Circ. 15 oct. 2012, relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, NOR : JUSD1236970C ; note n° 01477, 15 oct. 2010, relative aux surveillances spécifiques ; note n° 000350, 31 juill. 2009, relative à la définition des modalités de surveillance spécifique des personnes détenues).
; 1er juin 2004, n° 8704/03, Van der Graaf c. Pays-Bas). En droit interne, ce régime est prévu par la combinaison des articles 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui prévoit le respect de la dignité de la personne détenue, même si elle est soumise à des mesures de sécurité, et D. 272 du code de procédure pénale, lequel prévoit les modalités de sa surveillance nocturne (v. égal., pour le régime de la surveillance nocturne, Notes, 30 oct. 2018 relative à l’organisation des rondes de nuit ; Circ. 15 oct. 2012, relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, NOR : JUSD1236970C ; note n° 01477, 15 oct. 2010, relative aux surveillances spécifiques ; note n° 000350, 31 juill. 2009, relative à la définition des modalités de surveillance spécifique des personnes détenues).
En l’espèce, un individu inscrit au registre des détenus particulièrement signalés (DPS) est placé sous un régime de surveillance nocturne renforcée dans un premier établissement pénitentiaire, dès 2013. Cette mesure s’intensifie ensuite, jusqu’à être annulée par le tribunal administratif le 30 juin 2016, lequel considère qu’une inscription au registre DPS ne peut entraîner automatiquement la mise en œuvre d’un régime de surveillance nocturne renforcée. Il est ensuite transféré d’établissement. Le 17 février 2017, la personne détenue est placée à l’isolement, où elle fait de nouveau l’objet d’un régime de surveillance nocturne renforcée. Toutefois, aucune décision formelle n’était intervenue pour permettre à l’intéressé d’apprécier le bien-fondé de son placement sous ce régime. Le même jour, il saisit le Défenseur des droits. À la sollicitation de celui-ci auprès de l’administration pénitentiaire, l’autorité administrative confirmait que le détenu avait été placé sous un tel régime, qui s’était d’ailleurs traduit par des rondes de nuit intermédiaires avec contrôle à l’œilleton et allumage de la cellule.
Les atteintes aux droits fondamentaux des DPS soumis à la surveillance nocturne renforcée
L’atteinte procédurale : le droit à un recours effectif
Force est de constater que le régime des DPS peut conduire à des situations ambivalentes concernant le respect de leurs droits fondamentaux (v. not., Rép. pén., v° Prison – organisation générale, par J.-P. Céré, n° 285 ; v. égal. pour un ex. Crim. 17 mars 2010, n° 09-84.719, AJ pénal 2010. 409, obs. M. Herzog-Evans ![]() ; TA Versailles, 10 mars 2023, n° 2301859). En principe, seule inscription au régime de DPS ne peut justifier la mise en place d’une surveillance nocturne renforcée. À chaque fois, il devrait être nécessaire de réaliser un examen de la conformité de cette mesure avec les droits fondamentaux de la personne détenue (CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, préc., recommandation 14). Or, en l’espèce, l’inscription du détenu sous ce régime n’avait pas permis d’apprécier les motifs de son placement et sa compatibilité avec le respect de ses droits fondamentaux (§ 42 de la présente décision). De surcroît, elle avait automatiquement conduit à son placement sous le régime de la surveillance nocturne renforcée. Cette décision se plaçait donc en contradiction avec les prescriptions de la Convention européenne des droits de l’homme (§ 43). Dès lors, selon la Défenseure des droits, d’une part, « la mise en œuvre d’un régime de surveillance nocturne renforcée à l’encontre de [l’intéressé] au seul motif de son inscription au registre DPS constitue une atteinte injustifiée aux droits de ce dernier », (§ 44). D’autre part, l’absence de « décision formelle de placement sous un régime de surveillance nocturne renforcée et de notification de celle-ci constitue une atteinte [à son] droit au recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la CEDH et ne permet pas à la personne concernée d’exercer utilement les voies de recours à sa disposition » (§ 44).
; TA Versailles, 10 mars 2023, n° 2301859). En principe, seule inscription au régime de DPS ne peut justifier la mise en place d’une surveillance nocturne renforcée. À chaque fois, il devrait être nécessaire de réaliser un examen de la conformité de cette mesure avec les droits fondamentaux de la personne détenue (CGLPL, La nuit dans les lieux de privation de liberté, préc., recommandation 14). Or, en l’espèce, l’inscription du détenu sous ce régime n’avait pas permis d’apprécier les motifs de son placement et sa compatibilité avec le respect de ses droits fondamentaux (§ 42 de la présente décision). De surcroît, elle avait automatiquement conduit à son placement sous le régime de la surveillance nocturne renforcée. Cette décision se plaçait donc en contradiction avec les prescriptions de la Convention européenne des droits de l’homme (§ 43). Dès lors, selon la Défenseure des droits, d’une part, « la mise en œuvre d’un régime de surveillance nocturne renforcée à l’encontre de [l’intéressé] au seul motif de son inscription au registre DPS constitue une atteinte injustifiée aux droits de ce dernier », (§ 44). D’autre part, l’absence de « décision formelle de placement sous un régime de surveillance nocturne renforcée et de notification de celle-ci constitue une atteinte [à son] droit au recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la CEDH et ne permet pas à la personne concernée d’exercer utilement les voies de recours à sa disposition » (§ 44).
L’atteinte substantielle : le respect de la dignité en détention
Également, la Défenseure des droits profite de l’occasion qui lui est offerte pour donner son avis concernant les normes applicables au jour de sa décision, c’est-à-dire sous l’angle de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des DPS (NOR : JUSK2201661C). Elle observe que l’instruction ministérielle précise explicitement que « les DPS font systématiquement l’objet d’un placement sous surveillance spécifique renforcée, de jour comme de nuit » (Inst. 11 juill. 2022, p. 17, n° 4.2.1.2). Elle est donc à la fois en contradiction avec les prescriptions européennes et la décision du 30 décembre 2015 du Conseil d’État (CEDH 27 mai 2014, Radkov et Sabev c. Bulgarie, req. nos 18938/07 et 36069/0 ; CE 30 déc. 2015, préc.). Dès lors, la Défenseure des droits considère que « le placement automatique d’une personne inscrite au registre DPS sous un régime de surveillance nocturne renforcée, […] porte atteinte au respect de la dignité et des droits des détenus […] au sens de l’article 3 de la Concention européenne » (§ 49). Elle recommande donc que « le placement sous surveillance nocturne renforcée résulte d’une décision motivée en fait et en droit, notifiée à la personne détenue indiquant les voies et délais de recours pour la contester » (§ 52). De plus, elle recommande que « cette mesure soit conditionnée à un examen médical préalable et accompagnée d’un suivi médical régulier » (§ 53). Il faudra noter ici que le placement sous le régime de DPS a déjà été considéré comme une mesure faisant grief, susceptible de recours (CE 30 nov. 2009, n° 318589, Lebon ![]() ; AJDA 2009. 2320
; AJDA 2009. 2320 ![]() ; ibid. 2010. 994, étude M. Moliner-Dubost
; ibid. 2010. 994, étude M. Moliner-Dubost ![]() ; AJ pénal 2010. 43, obs. E. Péchillon
; AJ pénal 2010. 43, obs. E. Péchillon ![]() ; CAA Paris, 22 mai 2008, n° 05PA00853, Kehli, AJDA 2008. 1483
; CAA Paris, 22 mai 2008, n° 05PA00853, Kehli, AJDA 2008. 1483 ![]() , concl. B. Bachini
, concl. B. Bachini ![]() ; D. 2009. 1188
; D. 2009. 1188 ![]() , note M. Giacopelli
, note M. Giacopelli ![]() ; RSC 2009. 431, chron. P. Poncela
; RSC 2009. 431, chron. P. Poncela ![]() ).
).
La protection des droits fondamentaux des DPS par la reconnaissance du « droit au sommeil »
Sur la fréquence des rondes
En pratique, la surveillance renforcée se traduit par « la mise en œuvre de rondes supplémentaires et un contrôle renforcé à l’égard des personnes détenues » (§55). Selon la CGLPL, il s’agit d’un traitement inhumain et dégradant qui les soumet, au sens du droit européen, à une « détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » (CEDH 20 oct. 2016, n° 7334/13, Muršić c. Croatie, AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ![]() ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert
; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert ![]() ; v. CGLPL, Rapport d’activité 2015, 27 janv. 2016, p. 71). Par ailleurs, la note du 30 oct. 2018 (préc.), qui prévoit « seulement » quatre rondes par nuit, précise qu’il peut être dérogé à cette règle sur décision du chef d’établissement. Pour la Défenseure des droits, il est nécessaire que le chef d’établissement établisse le nombre de rondes effectuées par nuit en tenant compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap ou de la personnalité de la personne détenue. À défaut, la mise en place de cette mesure méconnaît son droit au respect de sa dignité (§ 59). Elle recommande ainsi que ce nombre soit strictement défini, afin de limiter les interruptions de son sommeil (§ 60).
; v. CGLPL, Rapport d’activité 2015, 27 janv. 2016, p. 71). Par ailleurs, la note du 30 oct. 2018 (préc.), qui prévoit « seulement » quatre rondes par nuit, précise qu’il peut être dérogé à cette règle sur décision du chef d’établissement. Pour la Défenseure des droits, il est nécessaire que le chef d’établissement établisse le nombre de rondes effectuées par nuit en tenant compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap ou de la personnalité de la personne détenue. À défaut, la mise en place de cette mesure méconnaît son droit au respect de sa dignité (§ 59). Elle recommande ainsi que ce nombre soit strictement défini, afin de limiter les interruptions de son sommeil (§ 60).
Sur l’allumage des lumières dans la cellule
À la suite d’une visite en France en 2017, le Comité de prévention de la torture (CPT) notait que l’allumage des lumières dans les cellules des DPS avait des conséquences néfastes sur leur santé. Il recommandait que ce mode de surveillance soit réservé à des situations « strictement nécessaires » (CPT, Rapport du 7 avril 2017 au gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France du 15 au 27 novembre 2015, CPT/Inf (2017) 7, p. 52). En l’espèce, au regard de la note du 31 juillet 2009, applicable au moment des faits, l’allumage des lumières de la cellule de l’intéressé ne répondait pas à une « stricte nécessité » (§ 64). Il s’agit donc d’un « traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Concention européenne » (§ 66). Plus précisément, la Défenseure des droits estime que l’allumage des lumières dans les cellules constitue une « mesure de police soumise au respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration », laquelle n’est pas, en droit français, assortie des garanties suffisantes (§ 70-71). Elle s’associe donc aux recommandations du CPT et estime qu’une telle décision devrait être notifiée aux personnes détenues, pour leur permettre d’exercer une voie de recours le cas échéant (§ 73 ; v. TA Lille, 13 déc. 2016, n° 1607033, AJ pénal 2017. 144, obs. M. H.-Evans ![]() ; TA Limoges, 18 avr. 2014, n° 1400678, AJ pénal 2014. 382, obs. M. Herzog-Evans
; TA Limoges, 18 avr. 2014, n° 1400678, AJ pénal 2014. 382, obs. M. Herzog-Evans ![]() ; v. contra CE 23 juill. 2014, n° 379602).
; v. contra CE 23 juill. 2014, n° 379602).
© Lefebvre Dalloz