L’AARPI : une SEP comme les autres
Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.
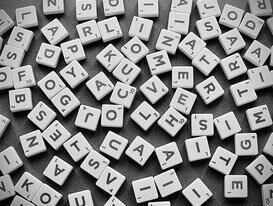
Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI.
1- Persistance des associations d’avocats. Premières structures à autoriser une forme d’exercice collectif de la profession, les associations d’avocats de la loi du 31 décembre 1971 résistent au temps (Loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 7). Instituées par un décret n° 54-406 du 10 avril 1954 (art. 49), ces groupements qui, déjà visaient les « associés » (sic), ont survécu à toutes les réformes, en ce compris la dernière en date, opérée par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées (sur l’histoire de ces associations d’avocats, v. not., J.-J. Daigre et C. Kaunan, D. 2023. 1247 ![]() , ss. Com. 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; J.-P. Chiffaut-Moliard, L. Dupuis et C. Thevenet, Guide de l’exercice en association d’avocats du CNB, oct. 2017).
, ss. Com. 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; J.-P. Chiffaut-Moliard, L. Dupuis et C. Thevenet, Guide de l’exercice en association d’avocats du CNB, oct. 2017).
Mieux, depuis qu’il est possible de constituer une « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle », connue sous l’acronyme AARPI, l’intérêt pour ce mode d’exercice très souple, s’est accru (Loi du 31 déc. 1971, art. 7, al. 1, mod. par loi n° 2006-1771 du 30 déc. 2006 et décr. du 27 nov. 1991, art. 124, al. 5, mod. par décr. n° 2007-932 du 15 mai 2007 : « Le contrat d’association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu’elle a fait l’objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126 »).
Ainsi, au 1er janvier 2022, 10,2 % des structures d’exercice collectif en activité étaient des associations d’avocats, parmi lesquelles, près de 80 % d’AARPI, leur nombre ne cessant de croître depuis 2012 (DACS, Statistiques sur la profession d’avocat – Situation au 1er janvier 2022). C’est dire l’attachement des praticiens à cette structure, en dépit de la possibilité, depuis la loi du 31 décembre 1991, de constituer des sociétés en participation de professions libérales (sur les SEPPL, v. Loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990, art. 22, abrogée et remplacée par ord. n° 2023-77 du 8 févr. 2023, art. 34 s.) ; et l’importance des arrêts rendus en la matière pour les professionnels du secteur.
2- Pas à pas. Étrangement, il a fallu un certain temps pour que la jurisprudence vienne clairement fixer la nature de ces groupements, au qualificatif trompeur. C’est sous l’impulsion d’un auteur ayant très tôt perçu en l’association d’avocats les caractéristiques de l’article 1832 du code civil, que la Cour de cassation a fini par trancher en faveur de la nature de société (J.-J. Daigre, Les associations d’avocats : associations ou sociétés, personnes morales ou groupements de fait ?, JCP E 1997. I. 671 ; Les associations d’avocats après le décret du 15 mai 2007 : de bien curieuses associations…, Rev. sociétés 2008. 725 ![]() ).
).
Deux arrêts récents ont permis, singulièrement, de rallier cette position. Le premier, du 17 février 2021, ayant jugé qu’une association d’avocats était soumise aux articles 1832 à 1844-17 du code civil, excepté l’article 1843-4 (Civ. 1re, 17 févr. 2021, n° 19-22.964 FS-P, Dalloz actualité, 9 mars 2021, obs. X. Delpech ; D. 2021. 428 ![]() ; ibid. 1941, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; ibid. 1941, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ![]() ; Rev. sociétés 2021. 384, note J.-F. Barbièri
; Rev. sociétés 2021. 384, note J.-F. Barbièri ![]() ; JCP E 2021. 1394, obs. J. Valiergue ; ibid. 1484, obs. M. Caffin-Moi ; BJS 2021, n° BJS121z2, note C.-A. Michel ; Dr. sociétés 2021. Comm. 59, note N. Jullian). Le second, du 8 mars 2023, qui est venu parachever l’office en jugeant que l’« AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale » (Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 20-16.475, préc., BJS mai 2023, n° BJS202a7, note J.-F. Barbièri). C’est cette dernière formule que reprend et entérine la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 avril 2024, publié et commenté dans ces colonnes.
; JCP E 2021. 1394, obs. J. Valiergue ; ibid. 1484, obs. M. Caffin-Moi ; BJS 2021, n° BJS121z2, note C.-A. Michel ; Dr. sociétés 2021. Comm. 59, note N. Jullian). Le second, du 8 mars 2023, qui est venu parachever l’office en jugeant que l’« AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale » (Civ. 1re, 8 mars 2023, n° 20-16.475, préc., BJS mai 2023, n° BJS202a7, note J.-F. Barbièri). C’est cette dernière formule que reprend et entérine la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 avril 2024, publié et commenté dans ces colonnes.
3- Utilité du recours à la société créée de fait ? Historiquement, on comprend que l’association d’avocats ait été qualifiée de société créée de fait, à une époque où précisément la SEP n’était pas consacrée dans le code civil (avant la loi du 4 janv. 1978) et où seul le code de commerce (anc. art. 44) traitait des « associations en participation », nécessairement à objet commercial. Un auteur avait par ailleurs proposé cette qualification motif pris de ce que l’association d’avocats coexistait avec les SEPPL (J.-J. Daigre, Les associations d’avocats : associations ou sociétés, personnes morales ou groupements de fait ?, préc., nos 4 s.).
Aujourd’hui, même si cela est sans incidence pratique, l’article 1873 disposant que « les dispositions du présent chapitre [afférentes aux SEP] sont applicables aux sociétés créées de fait », on s’interroge sur l’opportunité du passage par la case société créée de fait. D’abord, parce que chacun sait que l’AARPI n’est pas « créée de fait » : elle est volontairement constituée par ses membres et nécessairement formalisée par la signature d’une convention d’association (Décr. du 27 nov. 1991, art. 125). Ensuite, parce qu’il est tout à fait concevable, à rebours, que des avocats se comportent dans les faits comme des associés, sans avoir constitué de groupement, de sorte qu’il en résulterait l’existence d’une « vraie » société créée de fait. Or, cette « vraie » société créée de fait serait bien assujettie aux règles des SEP – articles 1871 à 1872-2 – en application de l’article 1873 précité, mais peut-être pas à celles régissant les associations d’avocats de la loi de 1971 ; peut-être pas plus, d’ailleurs, qu’à celles régissant les sociétés en participation de professions libérales. Cela dit, en pratique, cette qualification n’aurait que peu d’incidence sur l’exercice professionnel des intéressés, déontologie oblige.
4- Une SEP ostensible. Faute d’immatriculation au RCS (C. civ., art. 1871), l’AARPI est logiquement privée de la personnalité morale, bien que certaines dispositions semblent parfois la lui reconnaître (v. sur la « petite personnalité procédurale » de l’association d’avocats, J.-J. Daigre et C. Kaunan, D. 2023. 1247, préc ; elle est inscrite au tableau de l’ordre selon la commission professionnelle du statut de l’avocat ; elle peut postuler, v. Loi du 31 déc. 1971, art. 8, III). Surtout, l’AARPI est une SEP ostensible, sa constitution étant déclarée au bâtonnier et faisant l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (Décr. du 27 nov. 1991, art. 124 s.). Ses membres sont ainsi tenus de répondre conjointement des dettes d’activité (non des dettes professionnelles) contractées en cette qualité, envers les tiers, ce qui n’est que l’application de l’article 1872-1 du code civil ; disposition doublée par l’article 124, alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 : « chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association ». Aucune solidarité ne saurait être présumée entre les associés, s’agissant de l’exercice d’une activité civile et ce, même en ce qui concerne les dettes liées à l’exploitation d’une activité commerciale nécessairement accessoire à celle d’avocat, par exemple la mise à disposition de locaux avec services (ces dettes commerciales subiraient l’attraction de l’activité principale civile, à la condition de demeurer accessoires).
5- Contexte. Le litige, qui concernait les trois associés d’une AARPI, était né, sans grande originalité, à l’occasion du retrait de l’une d’entre eux et, subséquemment, lors des comptes à établir entre associés. Ainsi, après que le retrait de Mme D. avait été acté au 31 décembre 2018 en « assemblée générale extraordinaire », l’un des associés, M. E., avait saisi le bâtonnier d’une réclamation déontologique et d’une demande d’arbitrage à l’égard de la première, retrayante. Le 21 mai 2019, une « assemblée générale » à laquelle était convoquée Mme D., pourtant retirée, était réunie « afin d’arrêter les comptes de l’association au 31 décembre 2018 » (sic). Deux jours plus tard, Mme D. formait des demandes reconventionnelles devant le bâtonnier, relatives à ses droits financiers et sollicitait la désignation d’un expert-comptable afin qu’il établisse le bilan au 31 décembre 2018 de l’AARPI.
6- Procédure. Le 29 janvier 2021, une sentence arbitrale fixait les « créances de l’AARPI à l’encontre de Mme D. » et celles de cette dernière « à l’encontre de l’AARPI », prononçait un sursis à statuer sur les demandes en paiement et désignait un expert aux fins de déterminer, conformément aux dispositions des statuts de l’AARPI, les « droits sociaux » de Mme D. Sur ce dernier point, on déduit que l’expert avait été désigné par le bâtonnier, en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971. Selon ce texte, « tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats ». Cela mérite d’être relevé car il avait été jugé par la même première chambre civile, sur le fondement d’un motif de pur droit, que, pour l’évaluation des droits d’associés d’une AARPI, l’article 1843-4 ne pouvait recevoir application. Simplement, la Cour de cassation avait refusé d’appliquer ce texte du droit commun des sociétés, non pas au motif que l’article 21, III, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 réserverait une compétence exclusive au bâtonnier ; mais au motif, très discutable, que « l’article 1843-4 ne lui est pas applicable en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat » (Civ. 1re, 17 févr. 2021, préc.). Espérons que cette dernière solution sera abandonnée, l’associé d’AARPI étant bien titulaire de « droits sociaux », certes des droits d’associés contre les autres associés, tirés de sa position contractuelle et donc non négociables, mais des droits d’associés au moins susceptibles d’évaluation (Décr. du 27 nov. 1997, art. 124, qui reprend une solution déjà énoncée en 1954, dispose que « les droits dans l’association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés » ; comp., Com. 15 mai 2012, n° 11-30.192, D. 2012. 1401, et les obs. ![]() ; Rev. sociétés 2013. 88, note B. Dondero
; Rev. sociétés 2013. 88, note B. Dondero ![]() ; BJS déc. 2012. 842, note L. Godon, jugeant que « la circonstance que la société en participation ne soit pas titulaire d’un patrimoine propre ne fait pas obstacle à la cession par les associés des droits qu’ils tiennent du contrat de société »). En appel, les demandes formées par l’avocate retirée sont rejetées : elle sollicitait l’annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 21 mai 2019, outre l’infirmation de la sentence arbitrale l’ayant reconnue débitrice d’un certain nombre de dettes à l’égard de l’AARPI.
; BJS déc. 2012. 842, note L. Godon, jugeant que « la circonstance que la société en participation ne soit pas titulaire d’un patrimoine propre ne fait pas obstacle à la cession par les associés des droits qu’ils tiennent du contrat de société »). En appel, les demandes formées par l’avocate retirée sont rejetées : elle sollicitait l’annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale du 21 mai 2019, outre l’infirmation de la sentence arbitrale l’ayant reconnue débitrice d’un certain nombre de dettes à l’égard de l’AARPI.
7- Discussion. Dans son pourvoi, deux problématiques sont soulevées : celle, désormais classique, de l’incidence de la participation d’un « non associé » d’AARPI sur la validité des délibérations d’une assemblée ; celle de la possibilité pour un associé d’AARPI de consentir à cette dernière, en réalité à ses associés, des avances en compte courant.
Le droit de participer aux décisions collectives des associés d’AARPI
8- Premier moyen. L’associée retrayante poursuivait ici l’annulation des délibérations d’approbation des comptes prises au cours de l’assemblée du 21 mai 2019, sur deux fondements. Seul le premier nous retiendra, car le second, tiré d’une prétendue fraude à ses droits et d’un abus de droit, est balayé par la Cour de cassation au motif que l’intéressée « ne soumettait aucun élément objectif de nature à démontrer la fraude alléguée ».
Pour l’essentiel, l’avocate retirée reprochait à la cour d’appel son incohérence. Elle soutenait que, pour écarter sa demande d’annulation des délibérations prises lors de l’assemblée du 21 mai 2019, la cour d’appel ne pouvait à la fois constater qu’elle avait perdu sa qualité d’associé au 31 décembre 2018 et en même temps lui opposer le fait qu’elle avait « fait délibérément le choix de ne pas participer et par conséquent de ne pas utiliser son droit de vote ». Statuer ainsi, c’était prétendument violer l’article 1844 du code civil, dès lors que tous les associés, mais seuls les associés, ont le droit de participer et donc doivent être convoqués aux assemblées.
9- Solution. Si le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation donne raison à l’associée retirée sur le fond du droit. Elle commence par rappeler qu’en application des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, et 1871-1 du code civil et 124 du décret du 27 novembre 1991, « seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale ». Partant, c’est à tort que les juges versaillais ont retenu qu’était justifiée la convocation de l’associée retirée et, que pour écarter sa demande en nullité, ils lui ont opposé son choix de ne pas y participer et de ne pas exercer son droit de vote, alors même qu’ils avaient constaté que l’intéressée n’avait plus la qualité d’associé.
Dans un second temps toutefois, la Cour de cassation juge que « l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure ». Selon cette dernière, l’associée retrayante « est sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande d’annulation […] dès lors que les créances ont été fixées par le bâtonnier au vu des éléments soumis par les parties et qu’une expertise a été ordonnée pour analyser les factures, établir les comptes entre les parties et, le cas échéant, aboutir à une régularisation de ceux approuvés par les délibérations de cette assemblée générale que les associés ont accepté de remettre en cause. »
10- Analyse. Cette partie de l’arrêt, qui est à la fois justifiée et classique, mérite quelques observations. D’abord, elle est justifiée parce que l’article 1844, alinéa 1er, du code civil est sans conteste applicable aux AARPI, qui sont des SEP, l’impérativité de ce texte étant par ailleurs rappelée à l’article 1871, alinéa 2, du même code. Elle est également classique, puisqu’en dépit de son caractère inédit en matière d’AARPI, il a été jugé à plusieurs reprises que tous les associés, mais seuls les associés, ont le droit de participer aux décisions collectives au sens de l’article 1844, alinéa 1 (Civ. 3e, 8 juill. 2015, n° 13-27.248 P, D. 2015. 1537 ![]() ; Rev. sociétés 2016. 175, note L. Godon
; Rev. sociétés 2016. 175, note L. Godon ![]() ; RTD com. 2015. 533, obs. A. Constantin
; RTD com. 2015. 533, obs. A. Constantin ![]() ; ibid. 2016. 145, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
; ibid. 2016. 145, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ![]() ; BJS 2015. 585, note J.-P. Garçon ; Gaz. Pal. 29 sept. 2015, n° 272, obs. B. Dondero ; Dr. sociétés 2015, n° 11, comm. 189, note R. Mortier ; Com. 11 oct. 2023, n° 21-24.646 FS-B, Dalloz actualité, 10 nov. 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 2024
; BJS 2015. 585, note J.-P. Garçon ; Gaz. Pal. 29 sept. 2015, n° 272, obs. B. Dondero ; Dr. sociétés 2015, n° 11, comm. 189, note R. Mortier ; Com. 11 oct. 2023, n° 21-24.646 FS-B, Dalloz actualité, 10 nov. 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 2024 ![]() , note B. Dondero
, note B. Dondero ![]() ; RTD com. 2023. 892, obs. A. Lecourt
; RTD com. 2023. 892, obs. A. Lecourt ![]() ; BJS 2024. 20, note E. Guégan ; Lexbase Affaires, oct. 2023, n° 772, note B. Saintourens ; LPA 29 févr. 2024, p. 53, note S. Farges).
; BJS 2024. 20, note E. Guégan ; Lexbase Affaires, oct. 2023, n° 772, note B. Saintourens ; LPA 29 févr. 2024, p. 53, note S. Farges).
11- À présent, certains aspects de la solution doivent être précisés. D’abord, pour comprendre l’incidence de la convocation irrégulière de l’associée retirée sur la validité de l’assemblée au cours de laquelle les délibérations litigieuses ont été prises, il faut s’accorder sur le moment où l’intéressée a perdu sa qualité d’associé. Or, sur ce terrain, le principe est qu’un associé retiré ne perd cette qualité qu’au jour du remboursement effectif de ses droits sociaux (not., Com. 17 juin 2008, n° 06-15.045 P, Dalloz actualité, 19 juin 2008, obs. A. Lienhard ; D. 2008. 1818 ![]() , obs. A. Lienhard
, obs. A. Lienhard ![]() ; ibid. 2009. 1772, chron. M. Laroche
; ibid. 2009. 1772, chron. M. Laroche ![]() ; Rev. sociétés 2008. 826, note J.-F. Barbièri
; Rev. sociétés 2008. 826, note J.-F. Barbièri ![]() ; RTD com. 2008. 588, obs. M.-H. Monsèrié-Bon
; RTD com. 2008. 588, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ![]() ; JCP 2008. Il. 10169, note C. Lebel). Aussi, du point de vue des solutions « classiques » du droit des sociétés, la convocation de l’avocate retirée aurait pu ne pas apparaître si incongrue que cela. Certes, son retrait avait été acté au 31 décembre 2018, mais restaient en suspens les comptes à établir entre associés et, notamment, l’évaluation et donc le remboursement de ses « droits d’associés ». Aussi, pour expliquer le caractère irrégulier de la convocation de l’avocate retirée, il faut peut-être admettre, qu’à la différence des associés de sociétés personnifiées, propriétaires de titres de capital, parts sociales ou actions, dont le retrait n’est en principe effectif qu’au jour de leur remboursement, l’associé d’une SEP est titulaire de droits de nature conventionnelle à l’encontre des autres associés, et perd cette qualité dès son retrait acté. Avouons toutefois que si tel est le cas, cette différence de régime s’explique mal. En outre, on peut imaginer qu’une convention d’association prévoie une solution différente.
; JCP 2008. Il. 10169, note C. Lebel). Aussi, du point de vue des solutions « classiques » du droit des sociétés, la convocation de l’avocate retirée aurait pu ne pas apparaître si incongrue que cela. Certes, son retrait avait été acté au 31 décembre 2018, mais restaient en suspens les comptes à établir entre associés et, notamment, l’évaluation et donc le remboursement de ses « droits d’associés ». Aussi, pour expliquer le caractère irrégulier de la convocation de l’avocate retirée, il faut peut-être admettre, qu’à la différence des associés de sociétés personnifiées, propriétaires de titres de capital, parts sociales ou actions, dont le retrait n’est en principe effectif qu’au jour de leur remboursement, l’associé d’une SEP est titulaire de droits de nature conventionnelle à l’encontre des autres associés, et perd cette qualité dès son retrait acté. Avouons toutefois que si tel est le cas, cette différence de régime s’explique mal. En outre, on peut imaginer qu’une convention d’association prévoie une solution différente.
12- Ensuite et surtout, on note que la formule employée par la première chambre civile, concernant la participation irrégulière d’un non associé, cause de nullité de l’assemblée, n’est pas exactement celle consacrée par la chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 11 octobre 2023, ayant repris la formule consacrée par l’arrêt Larzul 2 (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 671 ![]() , note A. Couret
, note A. Couret ![]() ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau
; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ![]() ; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon
; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon ![]() ; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt
; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt ![]() ; ibid. 391, obs. J. Moury
; ibid. 391, obs. J. Moury ![]() ; JCP E 2023. 1093, note B. Dondero ; JCP 2023. 658, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2023. Comm. n° 72, note J.-F. Hamelin ; BJS mai 2023, p. 13, note H. Le Nabasque ; RDC 2023, n° 3, p. 48, obs. M. Caffin-Moi). Pour rappel, il est jugé dans l’arrêt du 11 octobre 2023 que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, « dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette précision mérite d’être apportée, car n’était pas en cause, en l’espèce, la participation d’un non associé aux décisions collectives au sens le plus pur : prendre part aux délibérations et voter les résolutions. En outre, même si l’avocate retirée avait pris part aux débats et au vote, sa participation n’aurait été source de nullité qu’à la condition qu’elle ait exercé une influence sur le résultat du processus de décision. La reprise du tempérament apporté par la chambre commerciale aurait été bienvenue.
; JCP E 2023. 1093, note B. Dondero ; JCP 2023. 658, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2023. Comm. n° 72, note J.-F. Hamelin ; BJS mai 2023, p. 13, note H. Le Nabasque ; RDC 2023, n° 3, p. 48, obs. M. Caffin-Moi). Pour rappel, il est jugé dans l’arrêt du 11 octobre 2023 que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, « dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette précision mérite d’être apportée, car n’était pas en cause, en l’espèce, la participation d’un non associé aux décisions collectives au sens le plus pur : prendre part aux délibérations et voter les résolutions. En outre, même si l’avocate retirée avait pris part aux débats et au vote, sa participation n’aurait été source de nullité qu’à la condition qu’elle ait exercé une influence sur le résultat du processus de décision. La reprise du tempérament apporté par la chambre commerciale aurait été bienvenue.
L’associé d’une AARPI, apporteur en compte courant
13- Second moyen. Cet aspect de la solution est à notre avis le plus intéressant. Il touche aux incidences, toujours difficiles à saisir, de l’absence de personnalité morale de l’AARPI sur les rapports entre associés, s’agissant des « actifs sociaux », c’est-à-dire concernant les biens mis à disposition ou acquis par les associés en cours de vie sociale pour la réalisation de l’objet social.
Dans son pourvoi, l’avocate retirée soutenait qu’en déclarant recevables comme non prescrites les demandes de remboursement formées par M. E. portant sur diverses sommes mises à disposition de la « trésorerie de l’association », lesquelles devaient s’analyser en des apports en compte courant d’associé, la cour d’appel aurait jugé que l’AARPI disposait d’un patrimoine propre et, ainsi, aurait violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 124 du décret du 27 novembre 1991, desquelles il s’infère qu’une AARPI est dépourvue de la personnalité morale et donc de patrimoine propre. Indiquons que l’on ne sait pas bien en quelle qualité M. E. réclamait le remboursement de ces sommes, c’est-à-dire s’il agissait en qualité d’associé seulement et/ou de gérant de l’AARPI.
14- Solution. L’argument est écarté par la Cour de cassation selon laquelle « il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI. »
15- Analyse. C’est la première fois que la Cour de cassation énonce aussi clairement, que les associés d’une SEP peuvent consentir des avances en compte courant d’associé, en dehors de considérations comptables (Com. 22 févr. 2005, n° 02-13.304 FS-B, D. 2005. 892, obs. A. Lienhard ![]() ; Rev. sociétés 2005. 820, note D. Poracchia
; Rev. sociétés 2005. 820, note D. Poracchia ![]() ; JCP E 7 juill. 2005, n° 1048 ; BJS 2005. 871, note F. Kenderian) ou fiscales (Com. 4 nov. 2020, n° 18-11.696 F-D). Il faut dire qu’en pratique la question ne semble pas vraiment faire débat. Un auteur qui s’est intéressé à la question n’a pas formulé de réserve sur la possibilité de consentir de telles avances, singulièrement au profit de l’indivision des associés (A. Rigaud, Comptes courants d’associés : l’AARPI se distingue, Gaz. Pal. 28 nov. 2017, n° 41, p. 13). À la vérité, la souplesse de fonctionnement de ce groupement commande le recours à ce mode de financement de l’activité sociale. En outre, l’absence de personnalité morale ne constitue pas un obstacle, comme elle n’en est pas un d’ailleurs pour traiter des apports et de leur rémunération par des droits d’associés, puisque l’on peut trouver, comme le fait la Cour de cassation, dans les dispositions propres aux SEP et celles de l’indivision, d’utiles secours. Avouons malgré tout, que le chemin emprunté par la Cour de cassation pour énoncer « qu’il se déduit » des dispositions des articles 1871 à 1873, et singulièrement de l’article 1871-1, qu’un associé de SEP « peut consentir des avances de fonds à l’indivision des associés », n’est pas si aisé à pister.
; JCP E 7 juill. 2005, n° 1048 ; BJS 2005. 871, note F. Kenderian) ou fiscales (Com. 4 nov. 2020, n° 18-11.696 F-D). Il faut dire qu’en pratique la question ne semble pas vraiment faire débat. Un auteur qui s’est intéressé à la question n’a pas formulé de réserve sur la possibilité de consentir de telles avances, singulièrement au profit de l’indivision des associés (A. Rigaud, Comptes courants d’associés : l’AARPI se distingue, Gaz. Pal. 28 nov. 2017, n° 41, p. 13). À la vérité, la souplesse de fonctionnement de ce groupement commande le recours à ce mode de financement de l’activité sociale. En outre, l’absence de personnalité morale ne constitue pas un obstacle, comme elle n’en est pas un d’ailleurs pour traiter des apports et de leur rémunération par des droits d’associés, puisque l’on peut trouver, comme le fait la Cour de cassation, dans les dispositions propres aux SEP et celles de l’indivision, d’utiles secours. Avouons malgré tout, que le chemin emprunté par la Cour de cassation pour énoncer « qu’il se déduit » des dispositions des articles 1871 à 1873, et singulièrement de l’article 1871-1, qu’un associé de SEP « peut consentir des avances de fonds à l’indivision des associés », n’est pas si aisé à pister.
16- Le principe de la licéité des apports en compte courant d’associé. S’agissant d’abord de la possibilité pour un associé de société de consentir des prêts « à la société », faute pour la structure d’être dotée d’un patrimoine, la difficulté peut être résolue. On sait que l’article L. 312-2 du code monétaire et financier autorise, par dérogation au monopole bancaire, « les sociétés » à recevoir des avances de fonds de la part de leurs associés. Et cet article ne limite pas cette dérogation au seul bénéfice des sociétés dotées de la personnalité morale, alors qu’il désigne largement « les associés ». Partant, si des associés de société civile peuvent consentir de telles avances à la société personne morale, il doit certainement en aller de même des associés d’une AARPI, sous réserve de quelques adaptations. Sur ce plan, la première chambre civile suit le précepte de l’article 1871-1 selon lequel, dans les rapports entre associés, et à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, leurs rapports sont régis, « en tant que de raison », par les dispositions applicables aux sociétés civiles. Concrètement, ces règles s’appliquent sous réserve de leur compatibilité avec l’organisation de la SEP et in fine de leur adaptation à l’absence de personnalité morale (relevant la proximité avec C. com., art. L. 226-1 et L. 227-1, v. P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, 2023, n° 1472). Au résultat, il peut être déduit de l’article 1871-1 la possibilité pour un associé de SEP de consentir, par exemple à l’indivision des autres associés, des avances en compte courant. En pratique, on imagine que les sommes transitent alors par un compte bancaire ouvert « au nom » de l’AARPI, et que les sommes qui y figurent seront réputées être la propriété indivise des associés.
17- Les apports en compte courant consentis à l’indivision des associés. S’agissant à présent de l’affirmation selon laquelle les fonds ont été avancés à l’indivision des associés, on peut là aussi chercher un fondement dans les règles « propres » aux SEP. Il est vrai qu’un débat existe, en doctrine, sur la question de savoir si, dans les rapports entre associés d’une SEP, il convient d’appliquer les règles de l’indivision, pour les actifs apportés ou acquis en cours de vie sociale, sur renvoi de l’article 1872 ; ou bien s’il faut préférer l’application exclusive des règles des statuts et du droit des sociétés, sur renvoi de l’article 1871-1 (sur la question, v. C. Saint-Alary-Houin, Les critères distinctifs de la société et de l’indivision depuis les réformes récentes du code civil, RTD com. 1980. 645, spéc. n° 20 ; F. Dekeuwer-Défossez, L’indivision dans les sociétés en participation, JCP 1980. I. 2970, spéc. nos 7 s. ; J.-Cl. civ., art. 815 à 815-8, fasc. 60, v° Successions – Indivision – Indivision et société, par F. Deboissy, G. Wicker et J. Valiergue, spéc. nos 85 s.).
18- Manifestement, la Cour de cassation ne semble pas ici s’en embarrasser. Il faut dire que l’article 1872 du code civil est suffisamment accueillant pour régir autant les apports effectués par les associés, au sens de l’article 1832 du code civil, que les actifs qu’ils acquièrent en commun ou mettent à disposition de la société en cours de vie sociale. Notons que la pratique professionnelle n’est pas non plus réfractaire à superposer une indivision à l’AARPI, puisqu’elle envisage expressément l’articulation entre retrait d’un associé et sort de ses droits indivis (J.-P. Chiffaut-Moliard, L. Dupuis et C. Thevenet, Guide de l’exercice en association d’avocats du CNB, préc., spéc. n° 43 : « il convient de veiller à ce que tout changement dans la composition des membres de l’association soit accompagné d’une cession de droits indivis pour assurer la corrélation entre la qualité d’associé et celle d’indivisaire »). Au vu de ces quelques éléments, il n’apparait pas illogique, pour la gestion des actifs indivis entre associés et dans le silence de la convention d’association ou en l’absence de décisions sociale ou de convention d’indivision, de s’en remettre aux articles 815-4 et suivants du code civil.
19- Au cas particulier, s’il n’est pas indiqué par la Cour de cassation les raisons pour lesquelles les fonds mis à disposition du groupement le sont à « l’indivision des associés », on peut accepter l’idée qu’ils soient « réputés » l’être en application de l’article 1872, non parce qu’ils le seraient par défaut, mais simplement parce que telle était probablement l’organisation choisie par les associés. Si l’on suit l’article 1872, deux autres options leur étaient d’ailleurs offertes : l’associé prêteur pouvait s’engager à utiliser les sommes prêtées dans « l’intérêt » de la société (C. civ., art. 1872, al. 1) ; l’associé prêteur pouvait en transférer la propriété au gérant ou à un autre participant, qui en devenait propriétaire fiduciaire (C. civ., art. 1872, al. 3 ; sur ces aspects, Rép. sociétés, v° Société en participation, par B. Dondero, nos 53 s.). Quoi qu’il en soit, dans notre hypothèse, on comprend que les autres associés devaient être considérés comme coemprunteurs et donc copropriétaires des sommes, c’est-à-dire à la fois cocréanciers de la mise à disposition et codébiteurs de la restitution. De ce point de vue, l’effet du prêt est identique à celui de l’apport en jouissance de sommes d’argent (C. civ., art. 1843-3). La différence, de taille, tient cependant au régime applicable à ces deux types d’opérations : le prêt ne peut être réalisé à fonds perdus. En outre, on ne saurait appliquer l’article 1872-2, alinéa 2, selon lequel « à moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l’article 1872 tant que la société n’est pas dissoute ». Les avances de fonds, consenties pour une durée indéterminée, donc non affectées d’un terme, peuvent en effet être réclamées à tout moment par l’associé prêteur aux autres, sauf clause de blocage. Et il faut ici se souvenir que, dans cette hypothèse, le délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur du compte ne court que du jour où il devient exigible, c’est-à-dire à compter du jour où l’associé en demande le remboursement (Com. 27 mai 2021, n° 19-18.983 F-D, Rev. sociétés 2022. 83, note I. Urbain-Parleani ![]() ; RDC 2021. 48, obs. J. Heinich).
; RDC 2021. 48, obs. J. Heinich).
Civ. 1re, 24 avr. 2024, FS-B, n° 22-24.667
© Lefebvre Dalloz