Le rapport au CCSF sur l’assurance de prêt : ou comment susciter la tension
Deux vues contraires traversent le marché français de l’assurance emprunteur (ou assurance de prêt) : selon les uns, il est un modèle d’équilibre concurrentiel et de respect des droits des consommateurs. Selon les autres : la concurrence est faussée et les droits des consommateurs ne sont pas respectés. Publiant le rapport prévu par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur », le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) contribue à la défense ardente de la première analyse. En occultant de la sorte la réalité d’un débat profondément installé, le CCSF s’affranchit de la mission que lui assigne la loi. La liberté des assurés en assurance emprunteur n’est pas effective en France. Et l’une des éminentes instances chargées de veiller aux relations entre les établissements agréés et leurs clientèles se désintéresse de cette carence. Cette posture d’ignorance des droits des consommateurs alimente le durcissement des tensions. Elle appelle inévitablement des réponses législatives plus dures, envers les prêteurs qui imposent des assurances de prêt aux assurés.
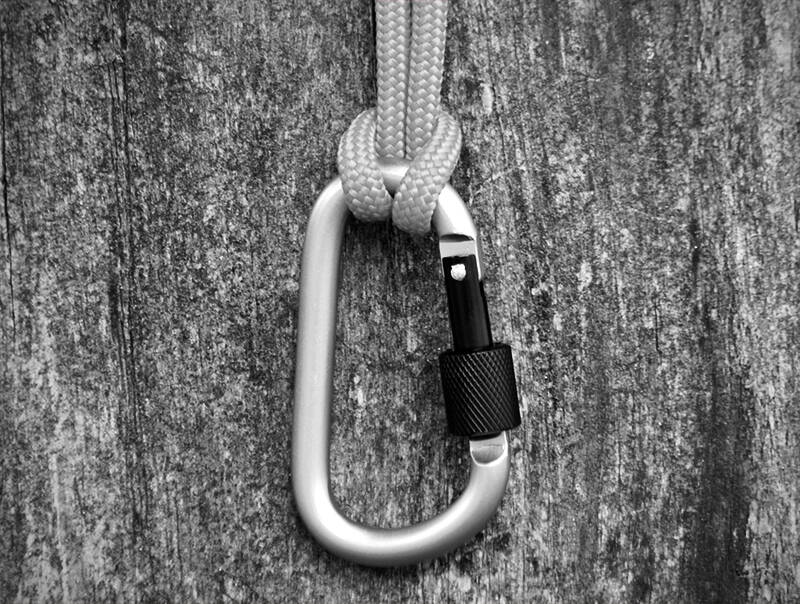
Un bilan célébrant le succès d’une loi dont l’échec est pourtant manifeste en matière de liberté de choix d’assurance par l’assuré
Le CCSF reçoit pour mission « […] d’étudier les questions liées aux relations entre, d’une part, les établissements [agréés, dont] les entreprises d’assurance et, d’autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’avis ou de recommandations d’ordre général » (C. mon. fin., art. L. 614-1). Il lui incombe donc d’identifier les difficultés « relationnelles » entre ces établissements et leurs clients ; et d’y répondre, par des propositions ajustées. Installé depuis 2004 (Loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 22), il forme une instance originale, dans laquelle, en pratique, les représentants des établissements agréés, ainsi que ceux des intermédiaires bancaires et d’assurance, dialoguent avec ceux des associations de consommateurs, sous le regard des pouvoirs publics, d’universitaires et de parlementaires. Une telle configuration peut susciter des résultats. Manifestement pas en matière d’assurance de prêt.
Le CCSF a publié son « Bilan de l’assurance emprunteur - 2023 », le 15 janvier 2024. La loi confie au CCSF le soin d’examiner « […] les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé » deux des principales mesures législatives, avec l’abaissement à cinq années du « droit à l’oubli » au bénéfice des personnes affectées de maladies lourdes. S’agissant de la substitution d’assurance de prêt, deux des objectifs du rapport publié par le CCSF consistent à évaluer « l’impact de la loi sur la segmentation tarifaire et la mutualisation » et à mesurer « l’évolution des tarifs et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs. » (Rapp. CCSF, p. 3).
Le droit de substitution, à tout moment, de l’assurance de prêt (C. consom., art. L. 113-29) par un autre contrat d’assurance emprunteur aux garanties équivalentes (C. assur., art. L. 113-12-2) ou « résiliation infra annuelle » illustre l’esprit de dépit qui inspire la loi n° 2022-270 du 28 février 2022. Au lieu d’identifier les causes qui, manifestement, nuisent à la liberté de choix de cette assurance lors de la souscription du prêt, pour y remédier, la loi se dérobe et consacre l’imposition d’une assurance de prêt par le prêteur comme une fatalité. Elle se concentre sur les échappatoires à cette situation détrimentaire à l’assuré.
Rappelons, en termes vulgaires, l’immense anomalie qui traverse le marché de l’assurance emprunteur français : pratiquement neuf contrats sur dix sont vendus près de deux fois plus chers aux emprunteurs, avec des garanties souvent minimales. L’origine de ce résultat économique inusuel s’explique fort aisément : par les pratiques commerciales déloyales (C. consom., art. L. 121-1) et agressives (C. consom., art. L. 121-6, 1°) utilisées par les établissements de crédit agréés. Lors de la souscription des prêts, les prêteurs imposent le placement de l’assurance emprunteur de groupe. Le prix de cette dernière est bien plus élevé pour l’assuré que ceux d’assurances de prêt concurrentes. Faute de contrôle adapté, les méthodes de vente des prêteurs inhibent le jeu concurrentiel et nuisent aux assurés.
Le rapport remis par le CCSF confirme, sans exégèse, cette situation de privation de la liberté de choix de l’assuré lors de l’octroi de prêt : 77 % des nouveaux contrats d’assurance emprunteur sont des contrats de groupe, proposés par les prêteurs (Rapp. CCSF, p. 15). Le constat est, une nouvelle fois, indiscutable. Son explication se fait attendre. Surtout, la part des assurances de prêt en délégation chute, de 9,3 % à 7,5 % de la production de nouveaux contrats (Rapp. CCSF, p. 19). Dans le stock des contrats la part d’assurance de prêt externe aux prêteurs bouge de manière millimétrique : elle passe de 15,3 % en 2021 à 16 % en mai 2023. La liberté de choix de l’assurance n’a pas progressé.
Le rapport du CCSF observe le vif développement de la substitution d’assurance, au moyen d’une donnée sans grand intérêt : le nombre de demandes de substitutions formulées en deux semestres, comparées à celles de l’année 2021. Il est vrai que la configuration du marché ne pouvait laisser espérer d’autre résultat que l’accroissement des demandes de substitution. Ce n’est pas un indicateur pertinent. Ce quasi « doublement » s’avère ridicule en regard des enjeux mentionnés. Le rapport du CCSF souligne que le mouvement de substitution ne profiterait pas « au plus grand nombre », mais « aux populations les plus aisées » avec 58 % des substitutions (Rapp. CCSF, p. 20). La lenteur de la substitution d’assurance emprunteur serait due au manque de moyens « opérationnels » des entreprises d’assurance déléguées (Rapp. CCSF, p. 16), sans que cette hypothèse soit sérieusement étayée. Le rapport invite ainsi à déduire que les assurances déléguées disposeraient des moyens suffisants pour les substitutions des contrats des emprunteurs/assurés « les plus aisés », mais pas pour les autres.
Le rapport constate que le taux de placement des assurances déléguées chez les courtiers-intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (C. mon. fin., art. L. 519-1 s.) a chuté à 12 % en 2023 (Rapp. CCSF, p. 46). Les courtiers en crédit, mandatés par les clients, agissent souvent également comme intermédiaires d’assurance et sont à même, en théorie, de proposer des contrats d’assurance emprunteur. Hors le saisissant commentaire, aussi plat que pléonastique, que « pour les courtiers en crédit, la situation reste particulièrement difficile » (Rapp. CCSF, p. 46) le rapport demeure muet sur l’analyse de ce point intéressant. Dommage, car l’examen des freins sans cesse mis par les prêteurs dans les services de courtage en crédit recherchés par les emprunteurs, indéfectiblement combattus par les courtiers, serait particulièrement éclairant.
Même du point de vue purement sémantique, le rapport s’engage dans la stigmatisation des concurrents des assureurs de groupe. Empruntant pourtant au vocabulaire bancaire, il qualifie les concurrents des assurances de groupe d’assureurs « alternatifs » (Rapp. CCSF, p. 15 ; 130 occurrences dans le document). Ce terme entretient l’idée que seule l’assurance de groupe du prêteur possède un caractère principal. Nouveauté : le rapport emploie ou relaie l’expression d’assureurs « alternatifs externes » afin d’adouber une nouvelle pratique des prêteurs : celle consistant à faire eux-mêmes concurrence à leurs propres contrats (« assureurs alternatifs internes » ; Rapp. CCSF, p. 8). Le rapport économise tout réflexion sur le caractère d’oxymore que contient visiblement l’expression « d’assurance alternative interne, » vue sous l’angle de la concurrence.
Malgré ces constats, de privation persistante de liberté de choix de l’assurance lors de l’octroi du prêt et de mol entrain à la substitution de contrats existants, le rapport expose une conclusion qu’aucune des données qu’il affiche n’autorise : la loi de 2022 aurait permis « d’accélérer […] la dynamique concurrentielle » (Rapp. CCSF, p. 16). Selon ses propres données, rien n’est moins sûr.
Un bilan qui observe le développement des exclusions motivées par des facteurs médicaux, effet corollaire prévisible de la suppression des questions de santé pour nombre de contrats
Deux des quatre objectifs du rapport du CCSF visent à analyser « la capacité d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque » et à évaluer « la mise en œuvre de l’abandon de la sélection médicale. » Rapp. CCSF, p. 3).
La deuxième forte mesure de la loi du 28 février 2022 formule l’interdiction de collecter toute information de santé, pour les prêts dont l’encours cumulé par emprunteur est inférieur ou égal à 200 000 €, lorsque le terme du prêt intervient avant le soixantième anniversaire de l’emprunteur (C. assur., art. L. 113-2-1). Cette disposition inattendue, votée, était étrangère à la proposition de loi initiale.
Les prêteurs ont suggéré cette généreuse mesure (Communiqué de presse du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 15 janv. 2024). Par le jeu des amendements, et via le Sénat, elle s’est installée dans la loi. En augmentant la base de coût à mutualiser entre les assurés concernés, elle visait d’évidence à renchérir le coût moyen des contrats d’assurance de prêt, au moment où la loi de 2022 imposait le principe d’une concurrence plus ouverte, laquelle n’est toujours pas effective. Saluons ce pur produit de lobbying.
Le rapport du CCSF souligne que « l’écart entre le nombre de contrats dont le montant assuré est inférieur à 200 000 € et celui des contrats souscrits SANS sélection est donc très important » (Rapp. CCSF, p. 28). Il montre au passage la tendance à l’exclusion des garanties dans les contrats d’assurance de prêt diffusés par des prêteurs. Des assurés présentant des maladies préexistantes à la souscription du contrat d’assurance de prêt se trouvent, de la sorte, dépourvus de couverture assurantielle. De surcroît, des discriminations tarifaires se sont instillées dans les contrats, entre ceux souscrits sur la base d’informations médicales (moins chers) et ceux qui en sont dépourvus (plus coûteux). Le rapport ne daigne même pas utiliser l’indicateur de coût de l’assurance durant huit années (C. consom., art. L. 313-8, 2°), pourtant préconisé par le CCSF.
La suppression de toute question médicale pour certains contrats d’assurance a produit un effet sur les prix de l’assurance emprunteur. Le rapport s’abstient d’en offrir la mesure : leur coût moyen aurait augmenté de 15 % à 20 %, selon les professionnels. Pour les contrats de groupe des prêteurs, le principe d’ouverture à la concurrence incite à la baisse des tarifs. Le rapport note ainsi « la tendance à la baisse des tarifs » notamment pour les contrats de groupe (Rapp. CCSF, p. 38).
Le coût bien plus onéreux des contrats de groupe des prêteurs s’affiche en termes euphémiques : les contrats en question « adoptent des approches tarifaires très différentes » (…) conduisant « à constater des écarts de prix, qui peuvent être importants pour certains d’entre eux » (Rapp. CCSF, p. 15). Certes. Sur ce point essentiel du surcoût des contrats d’assurance de prêt imposés par les prêteurs, le rapport adopte une douce réserve : il expose des données statistiques qui minimisent la différence tarifaire pour l’assuré, tout en omettant toute donnée statistique procurant une réponse synthétique à cette question primordiale.
Le rapport du CCSF passe sous silence l’analyse des possibles conséquences d’une faute législative : la suppression du questionnaire de santé n’est légalement pas applicable aux contrats des entreprises d’assurance régies par le code de la mutualité (Loi n° 2022-270 du 28 févr. 2022, art. 10), ni d’ailleurs, imposée aux intermédiaires d’assurance, tels que des prêteurs, comme l’ont relevé plusieurs auteurs.
Il s’agit d’un rapport au CCSF et non du CCSF. Sous-traité à un prestataire extérieur, le bilan 2023 sur l’assurance emprunteur a fait l’objet d’une publication brute, sans avis ni recommandation du CCSF. De sorte que l’opinion du comité lui-même, celles de ses membres, quant au rapport remis demeure inconnue. Il n’est pourtant pas souhaitable de laisser au prestataire technique le soin de tirer des orientations qui incombent au CCSF, dont la présidence a changé le 15 janvier 2024 (Communiqué de presse n° 1503 du ministre de l’Économie et des finances, 15 janv. 2024). En publiant un rapport n’identifiant guère de difficultés « relationnelles » entre assurés et entreprises d’assurance de prêt, ne contenant aucun « avis » ni « recommandations d’ordre général » et étant dépourvu de tout élément de sa validation par le CCSF, ce dernier échoue dans la mission que lui assigne la loi (C. mon. fin., art. L. 614-1, déjà mentionné).
Un bilan qui souligne justement l’importance du devoir de conseil en assurance emprunteur, ainsi que de sa formalisation sous forme de fiche interne
Le prestataire du CCSF fait proclamer à ce dernier que « la loi Lemoine est déjà un réel succès » (Rapp. CCSF, p. 56), alors que les données livrées sont soit incomplètes, soit diamétralement opposées à de telles affirmations. Analyser le marché de l’assurance emprunteur en niant l’existence même d’un puissant débat quant à la liberté de choix des assurés en assurance emprunteur dénote un manque de neutralité. Ce débat est légitime, ancré et documenté, depuis près qu’une quinzaine d’années. En adoptant des méthodes statistiques l’escamotant, en ne produisant ni avis ni recommandation avec le « bilan de l’assurance emprunteur - 2023 » le CCSF ne favorise ni l’identification des difficultés, ni la recherche de solutions.
Les autorités publiques n’ont pourtant d’autre option que d’aborder courageusement cette anomalie du marché de l’assurance emprunteur. L’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a commencé à le faire en matière d’assurance-vie sous l’angle du rapport « prix/garanties » des unités de compte (ACPR, recomm. 2023-R-01, 17 juill. 2023 ; v. aussi, EIOPA, 30 nov. 2021). Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’« en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d’assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. » (Cons. const. 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, Dalloz actualité, 19 janv. 2018, obs. N. Kilgus ; D. 2018. 1299, et les obs. ![]() , note S. Bros
, note S. Bros ![]() ; ibid. 371, obs. M. Mekki
; ibid. 371, obs. M. Mekki ![]() ; ibid. 1279, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre
; ibid. 1279, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ![]() ; AJ contrat 2018. 80
; AJ contrat 2018. 80 ![]() , obs. P.-Y. Gahdoun
, obs. P.-Y. Gahdoun ![]() ; Constitutions 2018. 181, Décision
; Constitutions 2018. 181, Décision ![]() ). Il reste donc à atteindre en France ce « meilleur équilibre contractuel ».
). Il reste donc à atteindre en France ce « meilleur équilibre contractuel ».
La loi du 28 février 2022 pourrait stimuler le fort potentiel de contentieux de l’assurance de prêt. L’adaptation du devoir de conseil en assurance (C. assur., art. L. 521-4) aux particularités de l’assurance emprunteur, et à celles de son marché, s’imposent. Le rapport attire l’attention, fort opportunément (il s’agit pratiquement de la seule voie d’amélioration qu’il identifie) sur la nécessité pour les distributeurs de mieux analyser les « différences de garanties entre le contrat originel et le contrat de substitution » (Rapp. CCSF, p. 56). Il ne fait en effet pas de doute que la notion d’« équivalence du niveau de garanties » n’est pas l’égalité des garanties, notamment dans leurs contenus comme dans leur mise en œuvre. En ouvrant même un temps d’incertitude, l’action de substitution d’assurance elle-même peut priver l’emprunteur de garantie. La Médiation de l’assurance a signalé une telle situation, y répondant en faveur de l’assuré (Médiation de l’assurance, 19 sept. 2023). Le rapport expose les difficultés de prise en charge des sinistres, avec des taux de refus de la garantie décès s’étageant de 3,8 % à 8,3 %, en 2020 (Rapp. CCSF, p. 49). Fausses déclarations et exclusions de garanties expliquent ces résultats, pourtant antérieurs à la promulgation de la loi du 28 février 2022.
Le rapport relève que le délai légal de dix jours (le rapport mentionne un délai de 11 jours, p. 45), pour accuser réception d’une demande de substitution, est enfreint dans 82 % des demandes en 2023 (Rapp. CCSF, p. 45). Une telle enfreinte est pourtant exposée à des sanctions. Le rapport suppute « des difficultés persistantes sur le marché alternatif » (Rapp. CCSF, p. 41). En effet, pour nuire au renforcement théorique de la liberté des emprunteurs à choisir une assurance de prêt, les banques ont « réarmé » leurs dispositifs internes de résistance aux demandes de substitutions. Le rapport voit dans cette résistance des prêteurs au droit de changer d’assurance emprunteur une occasion, pour les entreprises d’assurances déléguées, de s’adapter « aux exigences et différences entre réseaux bancaires » (Rapp. CCSF, p. 42). Or, ce sont bien les réseaux bancaires qui devraient s’adapter aux exigences qui découlent du droit des assurés de substituer leur assurance de prêt ; et non aux concurrents de s’adapter aux processus internes des prêteurs, souvent créatifs et infondés. Le rapport s’épargne ainsi l’analyse de cette autre réalité observable : la remarquable résistance administrative mise en place par les banques, pour nuire à l’exercice effectif du droit de substitution d’assurance. Ce marché est sans contrôle effectif (ACPR, recomm. 2017-R-01, 26 juin 2017 et mise en garde du 3 oct. 2018).
L’assurance emprunteur est un contrat spécifique. Affiner le devoir de conseil en assurance emprunteur, en distinguant la situation de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit et à la substitution, forme un impératif pour les distributeurs concernés : garanties couvertes, modalités de mise en jeu, franchises, exclusions, carences, mais également principes de tarification. L’analyse comparative poussée du contrat d’assurance emprunteur en vue d’une substitution nécessite des étapes méthodologiques précises. La qualité de la fiche de conseil en assurance emprunteur devient éminente. La fiche standardisée d’information (C. consom., art. L. 313-10) n’a pas cette fonction. Les intermédiaires d’assurance, mais aussi les prêteurs, souscripteurs d’assurance de groupe, ont tout intérêt à renforcer et à mieux formaliser leur obligation de conseil en assurance emprunteur.
Le rapport passe totalement sous silence un notable phénomène tarifaire du marché : le fort développement des assurances emprunteurs de groupe des prêteurs imposant des mensualités dégressives. Le prix de ces assurances n’est pas linéaire : il est concentré durant les premières années de remboursement du prêt. Elles sont un instrument d’extraction prompte d’une forte partie de la valeur du contrat auprès de l’assuré, en début de contrat d’assurance, au moment où les difficultés pour substituer ce contrat à un autre sont les plus décourageantes. La vente comme la substitution de tels contrats rehaussent l’exigence du conseil en assurance de prêt.
Ce « bilan » peine donc à convaincre tandis que son professionnalisme ne fait pas de doute. Le 9 novembre 2022, deux députés avaient remis un autre rapport pour « vérifier l’application de la loi votée » concluant « Les députés soulignent que l’application du droit de résiliation de l’assurance emprunteur est globalement satisfaisant » (Rapp. d’information n° 444, 16e législature, Dalloz actualité, 22 nov. 2022, obs. P. Januel). Le 15 janvier 2024, le CCSF a donc remis son « bilan 2023 de l’assurance emprunteur ». À fin avril 2024, le parlement n’a rien fait de ces bilans. Les droits des assurés en assurance de prêt n’intéressent manifestement ni l’Assemblée nationale, ni le Sénat. Le 18 novembre 2021, la présentation de la proposition de loi invitait à la curiosité : « […] Le marché de l’assurance emprunteur pour les crédits immobiliers : un marché peu concurrentiel et insuffisamment protecteur des droits des consommateurs » (Rapp. n° 4699 de la Commission des affaires économiques). Après l’entrée en application de cette loi en 2022 et à la lecture du rapport remis par le CCSF, en 2024, cette affirmation demeure intacte. Sans surprise, en matière de droit applicable aux banques et aux assurances, les bonnes intentions législatives ne sont pas suffisantes. En assurance emprunteur, des normes plus exigeantes sont inévitables pour garantir la liberté des assurés.
CCSF, bilan de l’assurance emprunteur 2023, 15 janv. 2024
© Lefebvre Dalloz