Le secret médical raboté mais le dossier médical préservé dans le contentieux de l’assurance
Le droit au secret médical ne fait pas obstacle à ce qu’un rapport d’expertise médicale amiable soit produit aux débats, malgré l’opposition de la personne faisant l’objet de cette expertise amiable, mais l’expert judiciaire ne peut pas accéder au dossier médical de la personne sans son consentement.
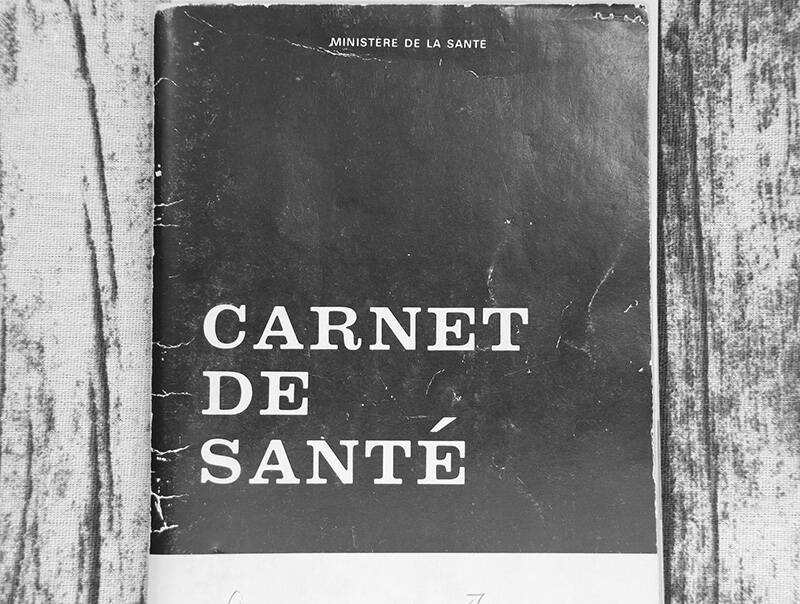
Depuis quelques années, la jurisprudence doit faire preuve de trésors d’inventivité pour offrir à l’assureur la possibilité de produire devant le juge certaines preuves nécessaires au succès de ses prétentions, tout en respectant le principe du secret médical.
La deuxième chambre civile en offre une nouvelle illustration dans un avis du 3 juillet 2025. Elle était confrontée à une sollicitation d’une juridiction du fond qui lui avait transmis deux questions.
Le rapport d’expertise peut être produit aux débats malgré l’opposition de la personne
La première, en substance, consistait à demander s’il est possible de passer outre le refus d’une personne ayant fait l’objet d’une expertise médicale amiable, de produire cette expertise devant le tribunal dans le cadre d’un contentieux ultérieur relatif au dossier.
Sur ce point, la Cour de cassation se montre compréhensive à l’égard des besoins de preuve de l’assureur et considère que celui-ci peut produire le rapport d’expertise amiable en dépit du refus de cette personne « à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi ». A l’appui de sa position, la Cour de cassation cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, depuis maintenant quelques années, souligne que le droit à la preuve peut contrebalancer le droit au secret médical et justifier qu’il soit porté une atteinte à ce dernier lorsque celle-ci est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH 27 mars 2012, Eternit c/ France, n° 20041/10 ; 10 oct. 2006, L.L. c/ France, n° 7508/02, D. 2006. 2692 ![]() ; RTD civ. 2007. 95, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2007. 95, obs. J. Hauser ![]() ). La deuxième chambre civile aurait éventuellement pu aussi signaler sa propre jurisprudence de 2025 qui estime que la production en justice de documents couverts par le secret médical peut être justifiée lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (Civ. 2e, 30 janv. 2025, n° 22-15.702, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. M. Couturier ; RSC 2025. 405, obs. P. Mistretta
). La deuxième chambre civile aurait éventuellement pu aussi signaler sa propre jurisprudence de 2025 qui estime que la production en justice de documents couverts par le secret médical peut être justifiée lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (Civ. 2e, 30 janv. 2025, n° 22-15.702, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. M. Couturier ; RSC 2025. 405, obs. P. Mistretta ![]() ). Il faut noter que, contrairement à l’arrêt du 30 janvier 2025, dans l’affaire ayant donné lieu à cet avis c’est le bénéficiaire du secret lui-même qui s’opposait à la production du rapport aux débats. La position de la deuxième chambre civile n’en est que plus significative.
). Il faut noter que, contrairement à l’arrêt du 30 janvier 2025, dans l’affaire ayant donné lieu à cet avis c’est le bénéficiaire du secret lui-même qui s’opposait à la production du rapport aux débats. La position de la deuxième chambre civile n’en est que plus significative.
Cet avis n’établit pas pour autant un blanc-seing à l’assureur pour tout transmettre au juge. Il faut rappeler que, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a plusieurs fois pris soin de souligner que l’assureur ne peut produire aux débats, par exemple, des documents médicaux qu’il aurait obtenu en violation du secret médical auprès du médecin traitant de l’assuré, potentiellement par l’intermédiaire de son médecin-conseil (Civ. 1re, 6 janv. 1998, nos 95-19.902 et 96-16.72 ; 12 janv. 1999, n° 96-20.580, D. 1999. 676 ![]() ; ibid. 381, obs. J. Penneau
; ibid. 381, obs. J. Penneau ![]() ; ibid. 469, chron. B. Beignier
; ibid. 469, chron. B. Beignier ![]() ). Ces solutions avaient d’ailleurs été adoptées pour contrebalancer un arrêt un peu trop radical de la Cour de cassation qui, en 1993, avait estimé que la veuve d’un assuré n’était pas fondée à s’opposer à la production aux débats d’un document médical obtenu par l’assureur auprès du médecin traitant de l’assuré, sans l’autorisation de ce dernier ni de sa veuve, au motif que celle-ci « ne pouvait pas légitimement s’opposer à la production d’un tel certificat [dans les débats], dès lors qu’il ne s’agissait pas pour elle de faire respecter un intérêt légitime mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions » (Civ. 1re, 9 juin 1993, n° 91-16.067, RTD civ. 1996. 166, obs. J. Mestre
). Ces solutions avaient d’ailleurs été adoptées pour contrebalancer un arrêt un peu trop radical de la Cour de cassation qui, en 1993, avait estimé que la veuve d’un assuré n’était pas fondée à s’opposer à la production aux débats d’un document médical obtenu par l’assureur auprès du médecin traitant de l’assuré, sans l’autorisation de ce dernier ni de sa veuve, au motif que celle-ci « ne pouvait pas légitimement s’opposer à la production d’un tel certificat [dans les débats], dès lors qu’il ne s’agissait pas pour elle de faire respecter un intérêt légitime mais de faire écarter un élément de preuve contraire à ses prétentions » (Civ. 1re, 9 juin 1993, n° 91-16.067, RTD civ. 1996. 166, obs. J. Mestre ![]() ). L’arrêt avait été très critiqué car il laissait entendre que le droit au secret médical pouvait s’effacer en toute situation, quelle que soit la manière par laquelle l’assureur se serait procuré les documents versés aux débats, même si celle-ci violait outrancièrement la protection du secret médical par le propre médecin de la personne.
). L’arrêt avait été très critiqué car il laissait entendre que le droit au secret médical pouvait s’effacer en toute situation, quelle que soit la manière par laquelle l’assureur se serait procuré les documents versés aux débats, même si celle-ci violait outrancièrement la protection du secret médical par le propre médecin de la personne.
En d’autres termes, il y a bien une balance à effectuer. Concernant cet avis de 2025, la production de ce rapport d’expertise amiable doit être considérée comme possible parce que le document a été établi dès le départ avec le consentement de la personne et dans un cadre et pour un but qui lui était connu, à savoir une discussion entre l’assureur et lui autour de l’évaluation de son dommage. La personne avait donc déjà, en somme, consenti à une forme de transmission de l’information médicale la concernant et, dans une certaine mesure, renoncé au bénéfice du secret médical. Or, la jurisprudence admet tout à fait qu’une personne puisse renoncer au bénéfice du secret en acceptant, même par avance, la transmission à l’assureur de certains éléments la concernant (Civ. 1re, 3 janv. 1991, n° 89-13.808 ; 29 oct. 2002, n° 99-17.187, D. 2002. 3186 ![]() ).
).
Cet avis pose cependant un problème de cohérence entre la position de la deuxième chambre civile et celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, cette dernière considère, pour sa part, qu’un médecin-conseil de compagnie qui transmet les éléments d’une expertise amiable à un expert judiciaire nommé par le tribunal « sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’intéressé » commet le délit de violation du secret professionnel (Crim. 16 mars 2021, n° 20-80.125). Il arrive parfois que, raisonnant de manière différente et sur la base de prédicats différents, le juge civil et le juge pénal projettent des regards distincts sur une question comparable. Néanmoins, l’absence de cohérence dans la jurisprudence est ici trop importante puisque, dans le même temps, le juge civil autorise la transmission de l’expertise amiable au tribunal malgré le refus de l’intéressé qui invoque pourtant le secret médical alors que le juge pénal, au nom d’une violation du secret médical, sanctionne pénalement, parce que l’intéressé n’a pas autorisé cette transmission, le médecin qui transmet l’expertise amiable à l’expert judiciaire nommé par le tribunal.
Il importe donc que la Cour de cassation clarifie ce sujet et trouve, entre toutes ses formations, un bon équilibre entre la nécessité de protéger les droits du patient tout en évitant que l’argument du droit au secret puisse être brandi en n’importe quelle situation pour faire obstacle à la circulation d’éléments qui sont entrés préalablement dans le débat sans déloyauté de quiconque.
Il serait donc illogique que, en brandissant très opportunément au dernier moment son droit au secret médical, la personne puisse subitement s’opposer à ce que ce rapport d’expertise amiable, clairement établi avec son consentement libre et éclairé dans le but de régler le problème de l’évaluation de son dommage, circule vers les mains du juge.
Si, en revanche, des pièces et documents ou informations médicaux relatifs à la personne étaient obtenus par l’assureur complètement à l’insu de la personne par fraude, mensonge ou manipulation, la balance devrait sans doute davantage pencher de l’autre côté : celui du respect du droit au secret. Le droit à la preuve ne justifie pas, en effet, toute pratique dans l’administration de la preuve.
Le dossier médical ne peut pas être ouvert sans le consentement de la personne
De de point de vue, la seconde question soumise à la deuxième chambre civile demeure sur une position plus classique qui s’inscrit dans cette lignée de protection du secret. La question posée, qui n’est pas très nouvelle en réalité, était de savoir si le tribunal peut mandater un expert judiciaire avec pour mission de prendre connaissance du dossier médical de la personne malgré le refus de celle-ci. Sur ce point, la deuxième chambre civile rappelle une jurisprudence maintenant plutôt bien établie depuis une vingtaine d’années (Civ. 1re, 15 juin 2004, n° 01-02.338, D. 2004. 2682 ![]() , note D. Duval-Arnould
, note D. Duval-Arnould ![]() ; ibid. 2005. 1317, obs. H. Groutel
; ibid. 2005. 1317, obs. H. Groutel ![]() ; RTD civ. 2005. 99, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2005. 99, obs. J. Hauser ![]() ; ibid. 384, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 384, obs. J. Mestre et B. Fages ![]() ; 7 déc. 2004, n° 02-12.539, AJDA 2005. 167
; 7 déc. 2004, n° 02-12.539, AJDA 2005. 167 ![]() ; D. 2005. 339, et les obs.
; D. 2005. 339, et les obs. ![]() ; ibid. 332, obs. P. Julien et N. Fricero
; ibid. 332, obs. P. Julien et N. Fricero ![]() ; ibid. 403, obs. J. Penneau
; ibid. 403, obs. J. Penneau ![]() ; ibid. 1317, obs. H. Groutel
; ibid. 1317, obs. H. Groutel ![]() ; 11 juin 2009, n° 08-12.742, D. 2009. 1760
; 11 juin 2009, n° 08-12.742, D. 2009. 1760 ![]() ; ibid. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur
; ibid. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur ![]() ; RTD civ. 2009. 695, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2009. 695, obs. J. Hauser ![]() ) : il n’est pas possible de passer outre le refus de la personne de laisser accéder à son dossier médical. La seule ressource du juge, lorsqu’il est confronté à un tel refus, est éventuellement d’en tirer les conséquences qui s’imposent lorsqu’il estime que celui-ci est guidé par une forme de mauvaise foi de la personne et non par la volonté de protéger un intérêt légitime. Par exemple, en matière de suspicion de fausse déclaration lors de la souscription d’une assurance, le juge peut, lorsque ce refus de laisser accéder au dossier médical est accompagné d’autres éléments qui semblent corroborer la mauvaise foi de l’assuré, décider de prononcer quand même la nullité du contrat malgré l’absence de preuve directe de fausse déclaration.
) : il n’est pas possible de passer outre le refus de la personne de laisser accéder à son dossier médical. La seule ressource du juge, lorsqu’il est confronté à un tel refus, est éventuellement d’en tirer les conséquences qui s’imposent lorsqu’il estime que celui-ci est guidé par une forme de mauvaise foi de la personne et non par la volonté de protéger un intérêt légitime. Par exemple, en matière de suspicion de fausse déclaration lors de la souscription d’une assurance, le juge peut, lorsque ce refus de laisser accéder au dossier médical est accompagné d’autres éléments qui semblent corroborer la mauvaise foi de l’assuré, décider de prononcer quand même la nullité du contrat malgré l’absence de preuve directe de fausse déclaration.
Civ. 2e, avis, 3 juill. 2025, n° 25-70.007
par Mathias Couturier, Maître de conférences à l'Université de Caen
© Lefebvre Dalloz