L’efficacité des clauses attributives de juridiction stipulées pour autrui
Il résulte des principes qui régissent la compétence internationale que la clause attributive de juridiction aux tribunaux d’un État tiers à l’Union européenne, contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant, qui est indissociable de l’exercice du droit créé au profit du bénéficiaire, peut être invoquée par et contre ce tiers bénéficiaire, sous réserve, le cas échéant, de l’application des règles de droit de l’Union européenne protectrices d’une partie faible.
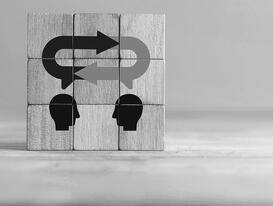
La présentation des faits de l’espèce est utilement éclairée par l’arrêt de la cour d’appel ayant statué (Besançon, 13 juin 2023, n° 23/00147), le rapport de Madame la conseillère Corneloup et l’avis de Monsieur l’avocat général Salomon. L’affaire s’inscrit dans une opération de cession de parts sociales d’une société de droit thaïlandais. Dans un premier temps, trois associés [A], [B] et [C] ont cédé à deux tiers [D] et [E] 51 % du capital de cette société. Le contrat de cession contenait alors une clause de compétence au profit d’une juridiction de Pattaya en Thaïlande. Dans un deuxième temps, ces mêmes parties ont convenu d’un avenant ayant pour objet spécifique de modifier cette clause, laquelle était alors reformulée comme suit : « Les parties conviennent que tous les différends qui pourraient naître entre elles et relatifs à l’exécution du présent contrat seront de la compétence du tribunal provincial de Pattaya ou soit [sic] du Tribunal de grande instance de Besançon, selon les choix des parties [sic] ». Dans un troisième temps, le cédant [A] a cédé 20 % des parts sociales au cessionnaire [D], lequel en a payé le prix entre les mains du cédant [B] envers lequel le cessionnaire [E] s’est porté caution. Et ce dernier acte de contenir une nouvelle clause d’electio fori désignant uniquement la juridiction de Pattaya.
Le litige est né entre le cédant [B], qui a assigné la caution [E] en paiement de diverses sommes au titre des deux contrats de cession devant le Tribunal judiciaire de Besançon. Le juge de la mise en état et la cour d’appel ont confirmé la validité de l’avenant et de la clause attributive duale qu’il contient, retenu la compétence « territoriale [sic] et matérielle » du Tribunal judiciaire de Besançon s’agissant des demandes fondées sur la première cession, tout en confirmant l’incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes relatives à la seconde cession. L’arrêt d’appel a fait l’objet d’un pourvoi principal initié par [E] et d’un pourvoi incident soutenu par [B].
Ce n’est que le pourvoi incident qui donnera lieu à l’apport de l’arrêt. Par ce pourvoi, le cédant [B] fait grief à la cour d’appel de lui avoir opposé la clause attributive de juridiction thaïlandaise contenue dans le second contrat de cession alors qu’il n’est pas partie à ce contrat, et d’avoir violé de ce fait tout à la fois le règlement (UE) n° 1215/2012 « Bruxelles I bis », la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, l’article 42 du code de procédure civile et les articles 1103, 1113 et 1128 du code civil.
Par contraste, l’arrêt de rejet a été rendu sur le fondement « des principes qui régissent la compétence internationale ». On s’en félicitera au cas particulier, dans la mesure où le pourvoi invoquait des fondements manifestement inopérants : les textes européens et le code de procédure civile s’appliquent de manière alternative en conflit de juridictions (Règl. [UE] n° 1215/2012 « Bruxelles I bis », art. 6.1, Dalloz actualité, 7 janv. 2013, obs. L. Dargent), et le régime particulier des clauses de compétence internationale ne se résout pas dans les articles généralistes du code civil cités (v. en 1er lieu, Civ. 1re, 17 déc. 1985, n° 84-16.338 ; en matière de subrogation, Civ. 1re, 25 nov. 1986, n° 84-17.745). Régime désormais complété de la règle suivante : « la clause attributive de juridiction aux tribunaux d’un État tiers à l’Union européenne, contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant, qui est indissociable de l’exercice du droit créé au profit du bénéficiaire, peut être invoquée par et contre [nous soulignons] ce tiers bénéficiaire, sous réserve, le cas échéant, de l’application des règles de droit de l’Union européenne protectrices d’une partie faible ». Et la Cour de compléter qu’une clause de compétence est opposable au tiers bénéficiaire « dès lors qu’il revendiqu[e] le bénéfice du droit que le promettant avait fait naître à son profit ».
Avant de présenter l’apport de cet important arrêt relatif à la clause stipulée pour autrui, quelques observations s’imposent sur la clause de compétence optionnelle contenue dans l’avenant et sur la potentielle contradiction de clauses attributives que l’opération globale aurait pu susciter.
Sur la clause de compétence optionnelle
On ne s’attardera pas sur le pourvoi principal relatif à la clause optionnelle de compétence dans la mesure où la Cour a estimé qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation au sens de l’article 1014 du code de procédure civile. Toutefois, on en retiendra que le dernier syntagme de la clause optionnelle de compétence figurant à l’avenant a donné lieu à un débat dispensable causé par sa piètre rédaction : prise au sens littéral, cette clause pouvait laisser entendre que l’exercice du choix de la juridiction au moment de la survenance du litige devait faire l’objet d’un choix conjoint des parties. Toujours est-il que les juges du fond se sont livrés à une interprétation souveraine contraire du sens de cette clause, qui ne saurait constituer un cas d’ouverture à cassation.
En tout état de cause, ce mode de rejet empêche la Cour de consacrer explicitement la règle selon laquelle une clause d’electio fori désignant au moins les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers relève bien du règlement (UE) n° 1215/2012 « Bruxelles I bis » (ce qui est également l’interprétation de Mme Corneloup dans son rapport).
Sur la contradiction des clauses de compétence
La Cour de cassation a relevé que, selon l’appréciation de la cour d’appel, « il n’existait pas d’indivisibilité » entre les deux contrats de cession successifs et, partant, en a déduit qu’il n’y avait pas de contradiction des clauses de compétence que chacun recelait. Ainsi la question de la contradiction des clauses attributives de juridiction est-elle évincée. Soulignons-le immédiatement : en l’absence d’éléments sur l’opération globale, il est difficile de porter une appréciation sur l’analyse de la cour d’appel. En revanche, il est permis de regretter une occasion manquée d’ajouter à la jurisprudence existante concernant la contradiction des clauses de compétence.
En droit interne, la tendance est à l’inefficacité réciproque des clauses contraires (Com. 20 nov. 1984, n° 83-15.956 ; Versailles, 5 janv. 2016, n° 15/03359 ; Com. 14 oct. 2020, n° 18-23.549). La solution contraste avec le sort favorable réservé aux clauses d’arbitrage, pour lesquelles la contradiction avec une clause attributive de juridiction est résolue en faveur des premières, notamment par l’application du principe de compétence-compétence (Com. 11 oct. 1971, n° 70-13.387 ; Civ. 2e, 18 déc. 2003, n° 02-13.410, D. 2004. 321, et les obs. ![]() ; RTD com. 2004. 255, obs. E. Loquin
; RTD com. 2004. 255, obs. E. Loquin ![]() ), lorsque les clauses ne sont pas complémentaires (Civ. 1re, 12 mars 2025, n° 22-17.166, Dalloz actualité, 31 mars 2025, obs. J. Jourdan-Marques) ou l’une d’application subsidiaire par rapport à l’autre (Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-12.131, D. 2010. 2933, obs. T. Clay
), lorsque les clauses ne sont pas complémentaires (Civ. 1re, 12 mars 2025, n° 22-17.166, Dalloz actualité, 31 mars 2025, obs. J. Jourdan-Marques) ou l’une d’application subsidiaire par rapport à l’autre (Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-12.131, D. 2010. 2933, obs. T. Clay ![]() ). S’agissant des clauses de compétence internationale, il n’est déjà pas certain que l’indivisibilité des contrats aurait permis une solution différente, la Cour de cassation tendant à ne pas étendre la portée des clauses que chacun des actes peut contenir (Com. 12 déc. 1989, n° 88-10.936, Rev. crit. DIP 1990. 358, note H. Gaudemet-Tallon
). S’agissant des clauses de compétence internationale, il n’est déjà pas certain que l’indivisibilité des contrats aurait permis une solution différente, la Cour de cassation tendant à ne pas étendre la portée des clauses que chacun des actes peut contenir (Com. 12 déc. 1989, n° 88-10.936, Rev. crit. DIP 1990. 358, note H. Gaudemet-Tallon ![]() ). La Cour de cassation a eu l’occasion de prononcer leur inefficacité réciproque par application spécifique des articles 18 et 19 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (Civ. 1re, 16 juill. 1998, n° 96-11.984, D. 1999. 117
). La Cour de cassation a eu l’occasion de prononcer leur inefficacité réciproque par application spécifique des articles 18 et 19 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (Civ. 1re, 16 juill. 1998, n° 96-11.984, D. 1999. 117 ![]() , note C. Witz
, note C. Witz ![]() ; Rev. crit. DIP 1999. 122, note B. Ancel et H. Muir Watt
; Rev. crit. DIP 1999. 122, note B. Ancel et H. Muir Watt ![]() ) et de censurer une cour d’appel qui ne s’est pas attachée à tirer les conséquences d’une telle contradiction au visa de l’article 455 du code de procédure civile (Com. 22 févr. 2017, n° 15-23.569). C’est dire que la position de la Cour de cassation dans la présente espèce aurait été appréciée s’il avait été établi que deux contrats de cession étaient indivisibles.
) et de censurer une cour d’appel qui ne s’est pas attachée à tirer les conséquences d’une telle contradiction au visa de l’article 455 du code de procédure civile (Com. 22 févr. 2017, n° 15-23.569). C’est dire que la position de la Cour de cassation dans la présente espèce aurait été appréciée s’il avait été établi que deux contrats de cession étaient indivisibles.
Sur la clause de compétence stipulée pour autrui
La Cour précise ab initio qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt préjudiciel de la Cour de justice interrogée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 9 oct. 2024, n° 22-22.015, Dalloz actualité, 7 nov. 2024, obs. F. Mélin ; D. 2024. 2230 ![]() , note G. Lardeux
, note G. Lardeux ![]() ; Rev. crit. DIP 2025. 139, note D. Sindres
; Rev. crit. DIP 2025. 139, note D. Sindres ![]() ). Une première lecture pourrait laisser croire que la différence entre les deux espèces réside dans leur positionnement par rapport à la clause de compétence : dans l’affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle, le tiers invoquait la clause tandis que, dans l’arrêt sous commentaire, le tiers se voyait opposer la clause. Une telle lecture serait confortée par la lecture de l’avis de Monsieur Salomon et du rapport de Madame Corneloup, lesquels insistent sur la distinction entre invocabilité et opposabilité et citent le précédent par lequel la Cour a déjà admis l’invocabilité d’une clause attributive de juridiction par le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui (Com. 8 févr. 2017, n° 14-24.544, Rev. sociétés 2018. 124, note B. Le Bars
). Une première lecture pourrait laisser croire que la différence entre les deux espèces réside dans leur positionnement par rapport à la clause de compétence : dans l’affaire ayant donné lieu à la question préjudicielle, le tiers invoquait la clause tandis que, dans l’arrêt sous commentaire, le tiers se voyait opposer la clause. Une telle lecture serait confortée par la lecture de l’avis de Monsieur Salomon et du rapport de Madame Corneloup, lesquels insistent sur la distinction entre invocabilité et opposabilité et citent le précédent par lequel la Cour a déjà admis l’invocabilité d’une clause attributive de juridiction par le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui (Com. 8 févr. 2017, n° 14-24.544, Rev. sociétés 2018. 124, note B. Le Bars ![]() ).
).
Tel ne nous paraît pourtant pas le motif adéquat du rejet du sursis à statuer. En effet, l’attendu de principe précise bien qu’il est question de savoir si la clause peut être invoquée « par et contre » le tiers bénéficiaire – et en cela, l’arrêt opère d’ailleurs un alignement des solutions. En revanche, la présente espèce échappe au régime européen des clauses de compétence, puisque la clause désigne une juridiction thaïlandaise. En effet, la question ne ressort pas ici du droit de l’Union européenne, mais du droit français, dans la mesure où le juge désigné n’est pas établi dans un État membre. Par son refus de surseoir à statuer, la Cour de cassation paraît marquer son attachement à la solution qu’elle donne et souligner que la concordance des solutions françaises et européennes sur ce sujet n’est pas un impératif pour elle. En ce sens, il faut percevoir la particularité de la question préjudicielle, qui procède d’une incertitude quant à la portée de la jurisprudence de la Cour de justice spécifique aux contrats d’assurance (CJCE 14 juill. 1983, Gerling Konzern, aff. C-201/82), à l’aune des précédents relatifs aux clauses contenues dans un connaissement (CJCE 19 juin 1984, Tilly Russ, aff. C-71/83 ; 9 nov. 2000, Coreck Maritime, aff. C-387/98, D. 2000. 298 ![]() ; Rev. crit. DIP 2001. 359, note F. Bernard-Fertier
; Rev. crit. DIP 2001. 359, note F. Bernard-Fertier ![]() ; RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque
; RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque ![]() ) et aux chaînes translatives de propriété (CJUE 7 févr. 2013, Refcomp, aff. C-543/10, Dalloz actualité, 21 févr. 2013, obs. S. Monetrey ; D. 2013. 1110
) et aux chaînes translatives de propriété (CJUE 7 févr. 2013, Refcomp, aff. C-543/10, Dalloz actualité, 21 févr. 2013, obs. S. Monetrey ; D. 2013. 1110 ![]() , note S. Bollée
, note S. Bollée ![]() ; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke
; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau
; Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau ![]() ; RTD civ. 2013. 338, obs. P. Remy-Corlay
; RTD civ. 2013. 338, obs. P. Remy-Corlay ![]() ; ibid. 2014. 436, obs. P. Théry
; ibid. 2014. 436, obs. P. Théry ![]() ; RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ![]() ). Les particularités du droit de l’Union européenne sont ici prégnantes. Ceci étant, ce droit européen n’est jamais complètement absent. En effet, « géométrie dans l’espace » oblige (P. Deumier, M. Laazouzi et É. Treppoz, Le règlement Bruxelles I bis et la géométrie dans l’espace, RDC 2013. 1037), les dispositions européennes protectrices de certaines parties faibles ayant été « universalisées », la règle énoncée par la Cour de cassation ne peut logiquement que réserver leur application, et ce rappel doit être approuvé.
). Les particularités du droit de l’Union européenne sont ici prégnantes. Ceci étant, ce droit européen n’est jamais complètement absent. En effet, « géométrie dans l’espace » oblige (P. Deumier, M. Laazouzi et É. Treppoz, Le règlement Bruxelles I bis et la géométrie dans l’espace, RDC 2013. 1037), les dispositions européennes protectrices de certaines parties faibles ayant été « universalisées », la règle énoncée par la Cour de cassation ne peut logiquement que réserver leur application, et ce rappel doit être approuvé.
En revanche, la Haute juridiction reprend de manière univoque la solution que, après hésitations (Com. 4 juin 1985, n° 84-10.344), elle avait consacrée en matière d’arbitrage : « la clause d’arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui » (Civ. 1re, 11 juill. 2006, n° 03-11.983, RTD com. 2006. 773, obs. E. Loquin ![]() ; en matière d’assurances et sur le fondement du principe de compétence-compétence, Civ. 1re, 5 sept. 2018, n° 17-13.837, RTD com. 2019. 49, obs. E. Loquin
; en matière d’assurances et sur le fondement du principe de compétence-compétence, Civ. 1re, 5 sept. 2018, n° 17-13.837, RTD com. 2019. 49, obs. E. Loquin ![]() ). Qui peut le plus peut le moins : cet alignement est sans doute opportun dans la mesure où l’opposabilité d’une clause d’arbitrage est sans doute plus lourde de conséquences que celle d’une clause d’élection de for.
). Qui peut le plus peut le moins : cet alignement est sans doute opportun dans la mesure où l’opposabilité d’une clause d’arbitrage est sans doute plus lourde de conséquences que celle d’une clause d’élection de for.
La solution doit également s’apprécier au regard du régime juridique de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1205 à 1209). Il est constant que, sous réserve des tempéraments existants (Civ. 1re, 8 déc. 1987, n° 85-11.769), la stipulation pour autrui ne peut créer que des droits dans le chef du bénéficiaire, et non lui imposer des obligations (C. civ., art. 1205). L’on doit donc s’interroger : le choix préalable d’une juridiction, dérogeant à la compétence objective d’une autre juridiction, constitue-t-il un droit ou une obligation ? Dans l’affaire In Zone Brands connue des internationalistes (Civ. 1re, 14 oct. 2009, n° 08-16.369, Dalloz actualité, 20 oct. 2009, obs. X. Delpech ; D. 2010. 177, obs. X. Delpech ![]() , note S. Bollée
, note S. Bollée ![]() ; ibid. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
; ibid. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ![]() ; Rev. crit. DIP 2010. 158, note H. Muir Watt
; Rev. crit. DIP 2010. 158, note H. Muir Watt ![]() ; RTD civ. 2010. 372, obs. P. Théry
; RTD civ. 2010. 372, obs. P. Théry ![]() ; RTD com. 2010. 459, obs. P. Delebecque
; RTD com. 2010. 459, obs. P. Delebecque ![]() ), la Cour avait explicitement considéré qu’il s’agissait d’une « obligation », mais il n’est pas impossible qu’il s’agisse là d’une maladresse rédactionnelle (la difficulté résidait alors dans le sort à réserver aux anti-suit injunctions de droit étatsunien). Dans l’arrêt sous commentaire, la Cour construit sa solution en énonçant que la clause « est indissociable de l’exercice du droit créé au profit du bénéficiaire » (nous soulignons).
), la Cour avait explicitement considéré qu’il s’agissait d’une « obligation », mais il n’est pas impossible qu’il s’agisse là d’une maladresse rédactionnelle (la difficulté résidait alors dans le sort à réserver aux anti-suit injunctions de droit étatsunien). Dans l’arrêt sous commentaire, la Cour construit sa solution en énonçant que la clause « est indissociable de l’exercice du droit créé au profit du bénéficiaire » (nous soulignons).
C’est donc son caractère ancillaire par rapport au droit substantiel concerné qui justifierait son opposabilité au bénéficiaire, ce qui permet de ne pas se prononcer frontalement sur la qualification de droit ou d’obligation. Ontologiquement, cette justification semble emporter l’approbation, ne serait-ce qu’en raison de la très grande variété en pratique des clauses de compétence (plurielles, optionnelles, asymétriques, négociées, imposées, etc.) qui empêche d’affirmer péremptoirement que le choix préalable d’une juridiction compétente constitue un droit ou une obligation pour une partie.
Civ. 1re, 18 juin 2025, FS-B, n° 23-21.709
par Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Cabinet Legi Avocats, Docteur en droit, Chercheur associé EDIEC-CREDIP (EA4185), Lyon III
© Lefebvre Dalloz