Les clauses de parité tarifaire devant la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une double question préjudicielle dans un litige opposant une plateforme de réservation hôtelière en ligne à des prestataires d’hébergement allemands, l’une sur la licéité des clauses de parité au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’autre sur la définition du marché pertinent pour bénéficier du règlement d’exemption catégorielle sur les accords verticaux, répond, d’une part, que les clauses de parité (élargies ou restreintes) ne peuvent être considérées comme des restrictions « accessoires » et, d’autre part, que la délimitation du marché nécessite une analyse concrète pour apprécier le degré de substituabilité tant du côté de l’offre que de la demande.
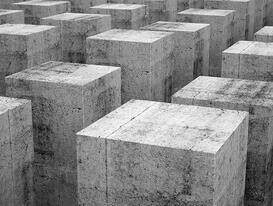
Dans le cadre d’un litige qui oppose Booking, plateforme de réservation hôtelière en ligne (OTA), à plus d’une soixantaine d’hôteliers allemands au sujet des fameuses clauses de parité tarifaire, le Tribunal d’Amsterdam a, par une décision du 22 février 2023, sursis à statuer pour poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice. D’une part, les clauses de parité étendues et restreintes doivent-elles être qualifiées de restriction accessoire aux fins d’application de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ? D’autre part, dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, comment le marché en cause doit-il être défini lorsque les transactions sont conclues par l’intermédiaire d’une plateforme de réservation en ligne sur laquelle des établissements d’hébergement peuvent offrir des chambres, et entrer en contact avec des voyageurs qui peuvent réserver une chambre par l’intermédiaire de ladite plateforme ?
Avant de commenter stricto sensu la décision, il convient de rappeler en quoi consiste l’opération et ce qu’est la clause de parité tarifaire. L’opération consiste à mettre en relation les consommateurs, en aval, avec les prestataires d’hébergement, en amont, au moyen de leur référencement sur le site de la plateforme de réservation. Chaque réservation fait l’objet du versement d’une commission par le prestataire d’hébergement au profit de la plateforme. La clause de parité tarifaire, quant à elle, consiste à imposer à l’hôtelier de garantir à la plateforme des prix plus compétitifs que ceux qui sont proposés aux concurrents. Elle est dite « étendue » lorsqu’elle couvre l’intégralité des canaux de commercialisation ; elle est dite « restreinte » lorsqu’elle interdit seulement à l’hôtelier de proposer des prix plus attractifs sur ses propres canaux (généralement sur son propre site internet). La clause de parité étendue avait suscité des préoccupations concurrentielles de la part des autorités françaises, italiennes et suédoises. Elles avaient ainsi obtenu de Booking qu’elle soit supprimée dans ses conditions générales de service. En revanche, bien que les autorités aient estimé, notamment l’Autorité française de concurrence (Aut. conc. 21 avr. 2015, n° 15-D-06, D. 2016. 964, obs. D. Ferrier ![]() ; JT 2015, n° 175, p. 8, obs. S. Zouag
; JT 2015, n° 175, p. 8, obs. S. Zouag ![]() ; ibid., n° 176, p. 11, obs. X. Delpech
; ibid., n° 176, p. 11, obs. X. Delpech ![]() ), que la clause de parité restreinte ne posait aucune préoccupation de concurrence, et bien qu’elle pût être condamnée sur le fondement du droit des pratiques commerciales déloyales inter-entreprises (CEPC, avis n° 13-10, 16 sept. 2013 ; Paris, pôle 5 - ch. 4, 21 juin 2017, n° 15/18784, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
), que la clause de parité restreinte ne posait aucune préoccupation de concurrence, et bien qu’elle pût être condamnée sur le fondement du droit des pratiques commerciales déloyales inter-entreprises (CEPC, avis n° 13-10, 16 sept. 2013 ; Paris, pôle 5 - ch. 4, 21 juin 2017, n° 15/18784, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ![]() ; AJ contrat 2017. 388, obs. V. Pironon
; AJ contrat 2017. 388, obs. V. Pironon ![]() ; ibid. 305, obs. X. D.
; ibid. 305, obs. X. D. ![]() ; JT 2017, n° 200, p. 11, obs. X. Delpech
; JT 2017, n° 200, p. 11, obs. X. Delpech ![]() ; RTD com. 2017. 598, obs. M. Chagny
; RTD com. 2017. 598, obs. M. Chagny ![]() ; ibid. 599, obs. M. Chagny
; ibid. 599, obs. M. Chagny ![]() ; ibid. 601, obs. M. Chagny
; ibid. 601, obs. M. Chagny ![]() ; ibid. 603, obs. M. Chagny
; ibid. 603, obs. M. Chagny ![]() ; ibid. 606, obs. M. Chagny
; ibid. 606, obs. M. Chagny ![]() ), le législateur français a adopté un texte spécial l’interdisant purement et simplement sous toutes ces formes (C. tourisme, art. L. 311-5-1). Il a dès lors pu être reproché à ce dernier d’avoir succombé aux intérêts sectoriels de l’hôtellerie, bien que la France soit loin d’être isolée dans cette position puisqu’elle a été suivie par d’autres États de l’Union européenne dans ce mouvement d’interdiction. Toutefois, la Cour de justice n’avait encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur cette clause, raison pour laquelle le Tribunal d’Amsterdam a souhaité saisir le juge de l’Union européenne.
), le législateur français a adopté un texte spécial l’interdisant purement et simplement sous toutes ces formes (C. tourisme, art. L. 311-5-1). Il a dès lors pu être reproché à ce dernier d’avoir succombé aux intérêts sectoriels de l’hôtellerie, bien que la France soit loin d’être isolée dans cette position puisqu’elle a été suivie par d’autres États de l’Union européenne dans ce mouvement d’interdiction. Toutefois, la Cour de justice n’avait encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur cette clause, raison pour laquelle le Tribunal d’Amsterdam a souhaité saisir le juge de l’Union européenne.
Ceci ayant été rappelé, la Cour condamne les clauses de parité mais définit prudemment le marché pertinent.
La condamnation des clauses de parité
S’agissant de la première question, la Cour de justice rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, si une opération ou une activité ne relève pas du principe d’interdiction de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison de son effet neutre ou positif à la concurrence, une restriction accessoire (qui limite l’autonomie commerciale d’un ou plusieurs participants) ne relève pas non plus de l’interdiction si elle remplit deux conditions : d’une part, qu’elle soit objectivement nécessaire à la bonne réalisation de l’opération ou de l’activité exemptée et, d’autre part, qu’elle soit proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par cette opération ou activité. En outre, contrairement au bilan concurrentiel effectué au titre de l’exemption individuelle de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui nécessite la réunion de purs éléments factuels que seule la juridiction de renvoi peut concrètement apprécier, la Cour de justice considère qu’elle est en mesure d’apporter des indications générales et abstraites pour aider la juridiction de renvoi à apprécier le caractère accessoire d’une restriction au titre de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Concernant la première condition, la Cour rappelle qu’il s’agit bien de démontrer la nécessité objective de la restriction, de sorte qu’une restriction qui rendrait simplement l’opération plus difficilement réalisable ou moins profitable ne seraient pas des éléments suffisants pour satisfaire cette condition. En effet, cela reviendrait à accepter des restrictions qui ne sont pas strictement indispensables à la réalisation de l’opération principale.
Concernant la seconde condition, la Cour précise qu’il convient de rechercher s’il existe des solutions alternatives moins restrictives de concurrence. Cette recherche peut s’effectuer au moyen d’un scénario contrefactuel consistant à vérifier la manière dont les services d’intermédiation en ligne pourraient fonctionner sans la clause litigieuse.
Certes, la Cour considère que l’opération principale organisée par l’OTA a bien cet effet neutre ou positif sur la concurrence en raison des gains d’efficience qu’elle permet de réaliser, tant pour les consommateurs (choix étendus) que pour les hôteliers (clientèle étendue). Mais elle considère aussi que les deux conditions exigées ne sont pas remplies concernant les clauses de parité, tant élargies que restreintes. En effet, de telles clauses ne sont pas de nature à mettre en péril l’opération principale alors que, de manière très certaine, elles entraînent, d’une part, une restriction de concurrence de nature à empêcher la concurrence entre les plateformes et, d’autre part, un risque d’éviction des plateformes entrantes ou de petite taille. Bien que l’OTA, dans l’affaire principale qui a donné lieu au renvoi, se plaignait à la fois d’un risque de concurrence déloyal de la part des hôteliers et de la difficulté d’amortir les investissements réalisés, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une restriction nécessairement objective, mais simplement moins profitable, voire plus difficilement réalisable. Par conséquent, la Cour conclut que les clauses de parité, qu’elles soient élargies ou restreintes, n’échappent pas à l’interdiction de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au motif qu’elles seraient accessoires à l’opération principale.
Il apparaît, pour la Cour de justice, que l’OTA a opéré une confusion entre le critère de la restriction accessoire au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (tests de nécessité et de proportionnalité) et celui du caractère indispensable de la restriction au sens de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (test de justification). Elle aurait sans doute dû mieux fonder ses prétentions, et se rabattre sur le troisième paragraphe pour défendre son modèle commercial sous l’angle de la rentabilité et de la protection contre les comportements opportunistes.
La définition prudente du marché pertinent
Concernant la seconde question, en partant du constat qu’il s’agit d’un accord vertical, la Cour commence par rappeler les conditions économiques qu’il faut remplir pour bénéficier du règlement d’exemption catégorielle, à savoir, que le fournisseur et l’acheteur aient chacun des parts qui ne dépassent pas 30 % sur le marché en cause. Au-delà, il n’est plus possible de présumer que l’accord vertical entraîne des avantages économiques de nature à compenser les inconvénients subis par la concurrence.
La Cour prend ensuite des précautions sur la définition du marché pertinent puisque la juridiction de renvoi n’a transmis que peu d’éléments factuels alors qu’un tel effort de délimitation suppose de connaître avec précision les conditions de la concurrence ainsi que la structure de l’offre et de la demande sur le marché. Elle prévient dès lors que son analyse ne sera pas en mesure de fournir une définition rigoureuse du marché de produits en cause.
Pout qualifier le marché pertinent, elle va classiquement rechercher le degré de substituabilité des produits entre eux. En d’autres termes, elle va rechercher si ce marché est constitué des services d’intermédiation aux prestataires d’hébergement (marché des plateformes hôtelières) ou s’il peut être élargi. En s’appuyant sur un arrêt de la Cour fédérale de justice allemande du 18 mai 2021, elle va décider de définir ce marché comme étant celui des plateformes hôtelières. Mais, s’agissant d’un marché multiface, elle invite la juridiction de renvoi à vérifier le degré de substituabilité entre les produits et les services à la fois du côté de l’offre et de la demande. Cette réponse « à la normande » pourra décevoir de la part de la Cour de justice. Néanmoins, sa prudence se comprend tant la délimitation des marchés nécessite une fine analyse économique alors que d’importants enjeux juridiques découlent de la définition retenue. Il convient donc de porter une attention particulière sur ce point dans le contentieux à venir.
CJUE 19 sept. 2024, aff. C-264/23