L'étendue de la suspension de la prescription consécutive au prononcé d'une mesure d'instruction préventive
Si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
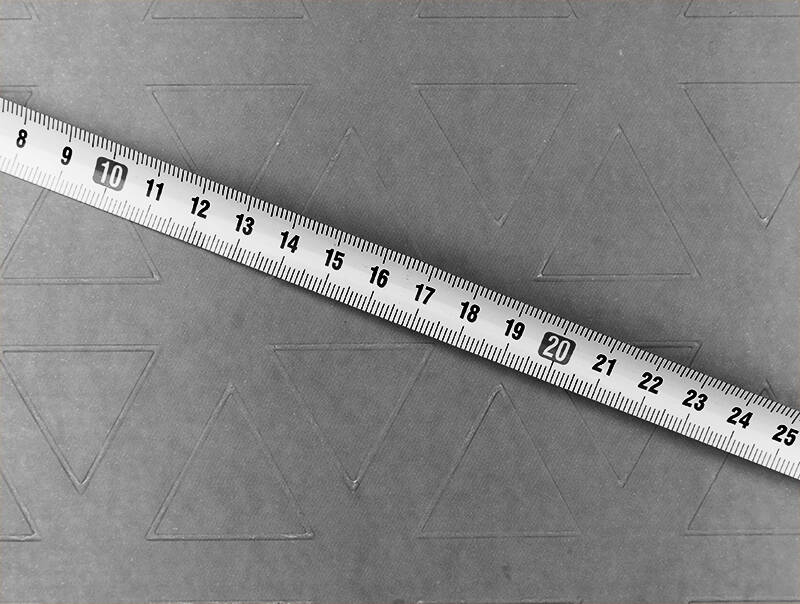
Quel est le droit dont le délai de prescription est suspendu lorsqu’un juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès ?
Telle était la question soulevée dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu le 2 mars 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits ayant conduit au prononcé de cet arrêt n’étaient guère originaux. Parce qu’elle rencontrait des difficultés à propos de moteurs acquis entre octobre 2005 et octobre 2006, une société a décidé d’assigner la société venderesse à comparaître devant le président du tribunal de commerce afin que, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ce dernier ordonne une mesure d’instruction préventive en vue, notamment, de rechercher l’existence de vices rédhibitoires. Par ordonnance du 20 novembre 2009, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a prescrit une expertise. L’expert a établi son rapport le 26 février 2015 et ce n’est que, selon un acte signifié le 4 mars 2016, que l’acquéreur a assigné le vendeur en paiement au titre de manquements à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de conseil. La cour d’appel de Lyon a cependant déclaré ces prétentions irrecevables comme se heurtant à la prescription. Les juges du fond n’ont pas nié qu’un délai de prescription puisse être interrompu par l’assignation devant le juge des référés, puis suspendu par le prononcé de la mesure d’instruction préventive ; en revanche, ils ont estimé que les mesures d’instruction préventives, qui visaient à rechercher l’existence de vices rédhibitoires, n’avaient pas le même objet que celui des prétentions dont ils étaient saisis.
La Cour de cassation n’a pas partagé cette manière de voir les choses. Après avoir rappelé les termes de l’article 2239 du code civil, elle a jugé que « si, en principe, la suspension comme l’interruption de la prescription ne peuvent s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ». Appliquant cette règle, elle a constaté que la demande d’expertise en référé, qui tendait à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s’ils étaient atteints d’un vice rédhibitoire, tendait au même but que l’action en inexécution de l’obligation de délivrance conforme, si bien que la cour d’appel aurait dû constater que la mesure d’instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l’action au fond.
L’étendue de l’effet suspensif attaché au prononcé d’une mesure d’instruction avant tout procès est ainsi calquée sur celle de l’effet interruptif attaché à la demande en justice.
L’étendue de l’effet interruptif de prescription
Apprécier la portée de l’effet suspensif découlant du prononcé de la mesure d’instruction préventive revient finalement à fixer celle de l’effet interruptif attaché à la demande en référé.
L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Mais il faut alors identifier le droit dont le délai de prescription est ainsi interrompu par la demande en justice.
Il pourrait être prétendu que l’effet interruptif ne peut s’étendre au-delà du délai de prescription de l’action qui est mise en œuvre par la demande portée en justice. Cette analyse, qui ne semble jamais avoir été réellement soutenue, conduirait alors à limiter considérablement l’effet interruptif de prescription attaché à la demande tendant au prononcé d’une mesure d’instruction préventive. Car l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui tend à la sanction du droit à la preuve (I. Després, Les mesures d’instruction in futurum, préf. G. Wiederkehr, Dalloz, 2004, nos 177 s.), est, selon toute vraisemblance, distincte de l’action qui pourrait ultérieurement être exercée devant un juge du fond. Dans tous les cas, une telle analyse, qui conduirait à un cantonnement de l’effet interruptif de prescription, ne reflète plus le droit positif.
Au moment de la réforme de l’article 2244 du code civil par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, il avait déjà été justement souligné que « ce n’est donc que par son contenu et par l’effet de diffusion d’une action à une autre, du référé au fond, que le nouvel article 2244 du code civil [dont la teneur est reprise à l’article 2241] permettra, par une simple citation en référé, d’interrompre le cours de la prescription acquisitive » (J.-L. Bergel, obs. ss L. n° 85-677 du 5 juill. 1985 [art. 37], RID 1986. 55). L’effet interruptif de prescription attachée à la demande en référé tendant au prononcé d’une mesure d’instruction préventive peut ainsi se diffuser à d’autres actions en considération du but poursuivi. La Cour de cassation juge depuis longtemps en ce sens que si l’effet interruptif de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ. 2e, 7 juill. 2022, n° 20-21.294 NP ; Civ. 1re, 7 juill. 2021, n° 19-11.638 P, Dalloz actualité, 22 juill. 2021, obs. M. Jaoul ; D. 2021. 1908 ![]() , note F. Roussel
, note F. Roussel ![]() ; ibid. 2064, obs. S. Godechot-Patris
; ibid. 2064, obs. S. Godechot-Patris ![]() ; AJ fam. 2021. 504, obs. J. Casey
; AJ fam. 2021. 504, obs. J. Casey ![]() ; Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-20.316 P, Dalloz actualité, 1er févr. 2021, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2021. 141
; Civ. 2e, 14 janv. 2021, n° 19-20.316 P, Dalloz actualité, 1er févr. 2021, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2021. 141 ![]() ; ibid. 543, obs. N. Fricero
; ibid. 543, obs. N. Fricero ![]() ; ibid. 2022. 431, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 2022. 431, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ![]() ; Rev. prat. rec. 2021. 5, chron. E. Jullien, R. Laher et O. Salati
; Rev. prat. rec. 2021. 5, chron. E. Jullien, R. Laher et O. Salati ![]() ; Com. 8 juill. 2020, n° 18-24.441 P, Dalloz actualité, 16 sept. 2020, obs. C. Bonnet ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.736 P, Dalloz actualité, 27 mai 2019, obs. J.-D. Pellier ; v. déjà Civ. 22 sept. 1941). Au-delà des mots employés, il faut admettre que le juge ne s’attache vraisemblablement pas à rechercher si une action en justice est véritablement comprise dans une autre et, d’ailleurs, il n’est pas toujours fait mention de cette condition (Civ. 2e, 8 juin 2021, n° 20-12.005 P, Dalloz actualité, 15 sept. 2021, obs. N. Hoffschir ; D. 2021. 1385
; Com. 8 juill. 2020, n° 18-24.441 P, Dalloz actualité, 16 sept. 2020, obs. C. Bonnet ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.736 P, Dalloz actualité, 27 mai 2019, obs. J.-D. Pellier ; v. déjà Civ. 22 sept. 1941). Au-delà des mots employés, il faut admettre que le juge ne s’attache vraisemblablement pas à rechercher si une action en justice est véritablement comprise dans une autre et, d’ailleurs, il n’est pas toujours fait mention de cette condition (Civ. 2e, 8 juin 2021, n° 20-12.005 P, Dalloz actualité, 15 sept. 2021, obs. N. Hoffschir ; D. 2021. 1385 ![]() ; Rev. prat. rec. 2021. 8, chron. A. Alexandre Le Roux, A.-I. Gregori et O. Salati
; Rev. prat. rec. 2021. 8, chron. A. Alexandre Le Roux, A.-I. Gregori et O. Salati ![]() ). Car il est bien difficile de concevoir qu’une action puisse être incluse dans une autre. C’est en réalité l’examen du but commun ou de la finalité commune poursuivi par les actions qui, seul, va permettre d’étendre l’effet interruptif de prescription résultant de l’exercice d’une action au délai de prescription d’une autre. Cela permet ainsi une diffusion de l’effet interruptif attaché à la demande en justice fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
). Car il est bien difficile de concevoir qu’une action puisse être incluse dans une autre. C’est en réalité l’examen du but commun ou de la finalité commune poursuivi par les actions qui, seul, va permettre d’étendre l’effet interruptif de prescription résultant de l’exercice d’une action au délai de prescription d’une autre. Cela permet ainsi une diffusion de l’effet interruptif attaché à la demande en justice fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Naturellement, lorsque le juge rejette la demande dont il est saisi, l’effet interruptif de prescription est non avenu en application de l’article 2243 du code civil (Com. 24 mars 2021, n° 19-22.110 NP ; Civ. 2e, 17 juin 2018, n° 17-17.856 NP). Lorsque, à l’inverse, il ordonne une mesure d’instruction, sa décision a pour effet de suspendre le cours de la prescription.
Les liens entre effet interruptif et effet suspensif de prescription
L’article 2239 du code civil prévoit que « la prescription est […] suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès » et, en ces cas, « le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Il faut convenir que la rédaction de ce texte paraît de prime abord assez curieuse : la partie qui, avant tout procès, demande à un juge d’ordonner une mesure d’instruction forme une demande en justice qui, déjà, interrompt le délai de prescription jusqu’au terme de l’instance et l’effet suspensif prend le relais, ce qui fait qu’en pratique un nouveau délai de prescription commencera à courir au moment où la mesure a été exécutée. Sauf lorsque la suspension a pour objet un délai de prescription dont la durée est inférieure à six mois, il paraît inutile que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à ce laps de temps (C. Brenner et H. Lécuyer, La réforme de la prescription, JCP N 2009. 1118, n° 13). Que la durée du délai, qui recommence ainsi à courir, ne puisse pas être inférieure à six mois aurait sans doute pu être utile si le défendeur avait été admis à se prévaloir du mécanisme suspensif prévu par l’article 2239 du code civil. Il est vrai que celui qui est assigné afin que le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès ne forme aucune demande en justice et, à ce titre, la jurisprudence lui refuse traditionnellement le bénéfice du mécanisme interruptif prévu par l’article 2241 du code civil. Mais il est tout aussi vrai que, dans bien des cas, les résultats de la mesure d’instruction n’intéressent pas uniquement le demandeur et permettent d’éclairer le défendeur afin qu’il détermine, s’il y a lieu, de son côté, d’exercer une action en justice. Parce que l’article 2239 n’indique pas que le bénéfice de la suspension de la prescription doit être réservé au seul demandeur, il aurait sans doute été permis d’autoriser le défendeur à se prévaloir de cette disposition, ce qui, du même coup, aurait redonné à une cohérence à la précision finale de ce texte, selon laquelle le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Mais ce qui était ainsi gagné en cohérence était peut-être perdu d’un autre côté : car il aurait été bien curieux que la demande visant à ce que soit prononcée la mesure d’instruction n’interrompe le délai de prescription qu’au profit du demandeur, tandis que le défendeur pourrait se prévaloir d’une suspension de son délai au moment où le juge ordonne la mesure.
C’est bien ainsi que les commentateurs de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ont compris l’article 2239 du code civil : la suspension du délai de prescription permet de prolonger l’effet interruptif résultant de la demande en justice formalisée par la partie afin de solliciter du juge qu’il ordonne une mesure d’instruction ; cela évite ainsi que le délai de prescription recommence à courir dès qu’est rendu le jugement ordonnant la mesure d’instruction, qui matérialise la fin de l’instance (P. Casson, « Le nouveau régime de la prescription », in P. Casson et P. Pierre [dir.], La réforme de la prescription en matière civile. Le chaos enfin régulé ?, Dalloz, 2010, p. 25, spéc. p. 46-47 ; S. Amrani-Mekki, Liberté, simplicité, efficacité, la nouvelle devise de la prescription ? À propos de la loi du 17 juin 2008, JCP 2008. I. 160, n° 63 ; N. Fricero, La prescription extinctive un an après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : ce qu’il faut savoir !, Procédures 2009, étude 6, spéc. n° 22). C’est également en ce sens que la Cour de cassation a compris l’article 2239 du code civil : dans plusieurs arrêts, elle a ainsi indiqué que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (Civ. 1re, 3 févr. 2021, n° 19-12.255 NP ; Civ. 3e, 17 déc. 2020, n° 19-14.837 NP ; 19 mars 2020, n° 19-13.459 P, D. 2020. 710 ![]() ; AJ contrat 2020. 347, obs. Y. Dagorne-Labbe
; AJ contrat 2020. 347, obs. Y. Dagorne-Labbe ![]() ; Civ. 2e, 31 janv. 2019, n° 18-10.011 P, Dalloz actualité, 7 mars 2019, obs. M. Kebir ; D. 2019. 254
; Civ. 2e, 31 janv. 2019, n° 18-10.011 P, Dalloz actualité, 7 mars 2019, obs. M. Kebir ; D. 2019. 254 ![]() ; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 2020. 170, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ![]() ).
).
Tout cela montre que l’effet suspensif de prescription, découlant du prononcé de la mesure d’instruction, ne constitue qu’un prolongement de l’effet interruptif attaché à la demande en justice. Suivant cette manière de voir les choses, il paraît difficile de considérer que la portée de cet effet suspensif, attaché au prononcé de la mesure d’instruction, diffère de celle attachée aux effets de la demande en justice : si la demande en justice, qui vise à ce que le juge ordonne, en référé, une mesure d’instruction, interrompt le délai de prescription de certains droits, il est nécessaire que l’ensemble de ces délais soient également suspendus pendant l’exécution des mesures d’instruction. Le lien qu’a voulu tisser la Cour de cassation entre les deux mécanismes est d’ailleurs si manifeste que, en l’espèce, pour apprécier la portée de l’effet suspensif de prescription, elle ne s’est pas référée à la décision du juge ordonnant la mesure d’instruction, comme pouvait sans doute le suggérer l’article 2239 du code civil, mais à la demande en référé dont il avait été saisi.
Comme l’interruption, le but ou la finalité poursuivi par l’exercice d’une action en justice permet ainsi de délimiter le champ de l’effet suspensif de prescription qui lui est attaché. En demandant au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, une partie entend bénéficier d’éléments de preuve qui, elle l’espère, révéleront l’existence de faits générateurs d’un autre droit subjectif dont elle pourrait ultérieurement se prévaloir. Il est donc possible d’apprécier les effets interruptif et suspensif de prescription au regard des faits qui constituent l’objet de la mesure. Sans heurter frontalement ces préceptes, la cour d’appel de Lyon avait cependant restreint ces effets sur la prescription de la seule action rédhibitoire dès lors que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile sollicitait l’établissement de ces vices. La censure de son arrêt indique que la Cour de cassation entend s’attacher davantage à l’objet factuel des mesures d’instruction qu’à la qualification du droit subjectif que la partie prétend ultérieurement déduire en justice. Cela n’est pas sans rappeler que le requérant n’a pas à préciser les fondements juridiques qu’il pourrait faire valoir pour justifier la prétention qui pourrait être formée devant le juge du fond (Com. 28 janv. 1992, n° 90-16.748 NP, Rev. sociétés 1992. 508, note Y. Guyon ![]() ; Civ. 2e, 20 juill. 1987, n° 86-12.889 NP) et que le juge n’est pas davantage tenu de les mentionner dans sa décision (Com. 18 nov. 2014, n° 12-29.389 NP ; Civ. 2e, 6 nov. 2008, n° 07-17.398 P, RTD civ. 2009. 166, obs. R. Perrot
; Civ. 2e, 20 juill. 1987, n° 86-12.889 NP) et que le juge n’est pas davantage tenu de les mentionner dans sa décision (Com. 18 nov. 2014, n° 12-29.389 NP ; Civ. 2e, 6 nov. 2008, n° 07-17.398 P, RTD civ. 2009. 166, obs. R. Perrot ![]() ; 8 juin 2000, n° 97-13.962 P ; Com. 14 févr. 2012, n° 11-12.833 NP, Rev. sociétés 2012. 229, obs. S. Prévost
; 8 juin 2000, n° 97-13.962 P ; Com. 14 févr. 2012, n° 11-12.833 NP, Rev. sociétés 2012. 229, obs. S. Prévost ![]() ).
).
Il faut admettre qu’il y a là une articulation cohérente des articles 2239 et 2241 du code civil…
© Lefebvre Dalloz