Maladies professionnelles : la reconnaissance hors-tableau varie selon les régions
Le système de reconnaissance complémentaire, via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pâtit d’au moins deux problèmes : les délais d’attente et les disparités d’un territoire à l’autre.
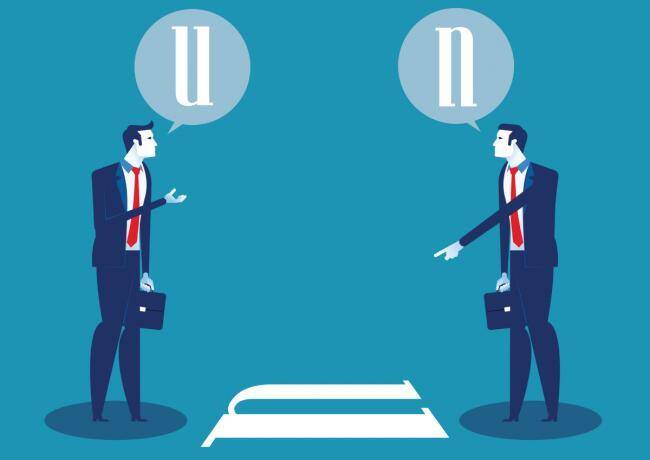
Imaginez : votre père décède d’un cancer colorectal après avoir été exposé pendant des années à l’amiante et aux émanations d’HAP (hydrocarbure polycyclique aromatique) dans le cadre de son travail. Mais selon les conclusions d’une instance dédiée de la région Paca, sa pathologie n’est pas d’origine professionnelle. A l’inverse, en Occitanie, l’organe équivalent reconnaît comme professionnel le même cancer dont est atteint un ancien collègue de votre père. La décision peut surprendre, voire paraître injuste. C’est pourtant ce qu’il s’est passé dans une affaire sur laquelle a statué le tribunal judiciaire de Nîmes en janvier 2023. Un cas particulier, bien sûr, mais qui interroge les limites de la reconnaissance dite hors tableau telle qu’elle fonctionne aujourd’hui.
L’origine professionnelle d’une pathologie peut être reconnue assez simplement avec une présomption d’imputabilité au travail si la maladie est inscrite dans un tableau de MP et que les critères d’exposition et durée de prise en charge sont remplis. Les CRRMP interviennent pour la reconnaissance dite complémentaire, prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, quand l’un des critères du tableau n’est pas rempli (alinéa 6 de l’article), ou que la pathologie ne fait pas l’objet d’un tableau mais que la personne justifie d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, (alinéa 7 de l’article).
Un CRRMP est normalement composé d’un médecin conseil de la Cnam, d’un PU-PH (professeur universitaire – praticien hospitalier) ou d’un PH qualifié en pathologies professionnelles, et d’un MIT (médecin inspecteur du travail). Lorsqu’il étudie un dossier relevant de l’alinéa 6, le comité doit décider si oui ou non la maladie est “directement causée par le travail habituel de la victime”. Dans le cas d’un alinéa 7, ces experts doivent aussi regarder si elle est “essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime”. Ainsi, lorsque la victime fumait massivement par exemple, en plus de l’exposition au travail, la maladie ne peut pas être reconnue comme professionnelle.
Etudes scientifiques versus cas individuels
Le lien d’essentialité est difficile à établir puisque les pathologies sont multifactorielles. Pour prendre leur décision collégiale, les membres du CRRMP s’appuient sur les données scientifiques publiées et parfois sur l’avis du médecin du travail, qui ne leur que trop peu souvent transmis. Le salarié et l’employeur peuvent avoir souhaité communiquer des éléments relatifs aux postes de travail, s’ils estiment que les questionnaires qu’ils ont déjà adressés ou que l’enquête figurant au dossier sont incomplets.
Dans l’arrêt cité plus haut, le tribunal remet en cause la méthodologie suivie. Les deux CRRMP saisis successivement et dont les décisions de non-reconnaissance sont attaquées par la famille de la victime, n’ont pas réclamé d’avis au médecin du travail et ils “s’en tiennent aux conclusions d’une littérature scientifique à caractère général aux conclusions contradictoires, alors qu’il s’agit d’apprécier un cas individuel”.
Interrogée sur cette carence pointée du doigt par le tribunal, la branche AT-MP de l’Assurance maladie répond seulement, par la voie de son service communication, que “l’avis du CRRMP est un avis d’expert qui s’impose à la caisse”. Questionnée ensuite sur le cas de ces deux collègues, l’un pour qui la maladie a été reconnue comme professionnelle, l’autre non, l’institution rappelle que “le CRRMP statue au cas par cas en prenant en compte toutes les spécificités individuelles. Il ne suffit pas de faire le même métier pour que les dossiers soient identiques”.
Pas homogène
D’après nos informations, les taux d’acceptation peuvent radicalement varier d’un CRRMP à l’autre (entre 35 % et 50 % pour les cas portant sur les pathologies psychiques). Il faut dire qu’il n’existe pas d’instruction nationale visant à uniformiser totalement la doctrine.
Interrogées sur l’existence ou non de lignes directrices, l’Assurance maladie renvoie à un guide édité par l’INRS, qu’elle a validé avec la DGT (Direction générale du travail). Y sont notamment présentées les méthodes d’évaluation de l’exposition à suivre, comme la mobilisation des études épidémiologiques, la littérature scientifique et l’enquête professionnelle réalisée en amont par la Sécurité sociale.
Ce document définit précisément certains critères, tout en reconnaissant que d’autres ne peuvent l’être. Par exemple, pour le tableau 57 sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, il explique très précisément ce que l’on entend par “répétitivité” mais indique à l’inverse qu’aucune valeur seuil n’a été arrêtée pour définir la “force” ou “l’amplitude articulaire” du poignet ou de la main.
CRRMP thématique ?
Interrogée sur la possibilité d’édicter des règles encore plus précises pour homogénéiser les raisonnements des CRRMP, l’Assurance maladie explique qu’elle ne fait qu’appliquer les textes, lesquels résultent des négociations entre partenaires sociaux. A la même question, la DGT estime, elle, qu’“il pourrait être envisagé une coordination et une animation des CRRMP, notamment pour mieux partager les informations et les bonnes pratiques”.
A une moindre échelle, c’est d’ailleurs un peu ce qui est sur le point d’être expérimenté. Le Grand Est s’apprête à organiser des réunions entre membres des deux équipes du CRRMP (Nancy et Strasbourg) autour de revues de dossiers permettant de rediscuter à froid de cas passés, à la demande Jean-Michel Wendling, médecin inspecteur du travail (MIT) de la région. “Cela nous permettra de débattre des limites que l’on se pose, espère-t-il. Par exemple, sur quels métiers et à partir de quelle fréquence de contraintes posturales du genou peut-on faire le lien avec des lésions chroniques du ménisque d’origine professionnelle ?”.
Depuis peu, tous les cas d’exposition aux pesticides, quand la maladie n’est pas inscrite dans un tableau, sont étudiés par un comité unique. Un système équivalent pour d’autres expositions pourrait-il voir le jour ? A ActuEL HSE, la DGT, via son service communication, déclare : “A l’instar du CRRMP unique concernant les maladies liées au Covid-19, un CRRMP spécifique pour les pathologies liées aux risques psychosociaux pourrait s’avérer utile afin d’harmoniser les décisions sur l’ensemble du territoire”. Elle nuance en revanche : “Attention toutefois à ne pas privilégier l’expertise médicale d’ “organe” concernant la maladie et comment la soigner, seule son origine professionnelle ou non étant questionnée dans le cadre de la procédure. Ces comités doivent comporter des compétences en santé au travail : Comment les salariés travaillent-ils ? Quelles expositions au vu de leur parcours professionnel ? Étaient-ils protégés comme l’affirme leur employeur ? Ou au contraire étaient-ils exposés significativement ? etc…”
Manque de médecins inspecteurs
L’autre gros problème, partagé lui de tous, est le délai de traitement des demandes, dû aux manques de professionnels disponibles pour se réunir. Les MIT ont en plus d’autres tâches à assurer, ils travaillent entre autres sur les Cpom (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens) et les PRST (Plans régionaux de santé au travail) et donnent leurs avis sur l’agrément accordé aux SPSTI. Et la plupart des régions n’en compte qu’un. Certaines en sont carrément dépourvues. C’est le cas de l’Auvergne-Rhône-Alpes, du Sud, de la Corse, de la Réunion et de Mayotte. Des intérims sont organisés.
Pour tenter de pallier ce manque, depuis l’an dernier, les comités ont le droit de siéger en l’absence du MIT, alors remplacé par un autre médecin du travail. L’Assurance maladie indique qu’il est encore trop tôt pour voir si cette réforme permet aux CRRMP de siéger plus régulièrement, mais que “la tendance semble bonne”.
Au cours des quinze dernières années, le nombre d’avis rendus en alinéa 6 est passé d’environ 7 000 à un peu moins de 21 000 en 2021. La même année, ceux rendus en alinéa 7 étaient de 5 600, en hausse également.
Dans le cadre de la récente négociation sur la branche AT-MP, les organisations syndicales auraient voulu abaisser le taux d’incapacité permanente permettant d’accéder à une reconnaissance hors tableau. Le patronat a refusé, arguant justement de l’engorgement des CRRMP.