Mise à la retraite d’un salarié à temps partiel
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
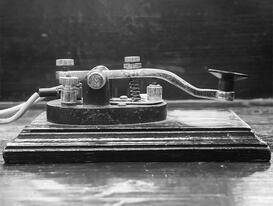
En cas de mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d’expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l’employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l’action en paiement de l’indemnité de mise à la retraite d’un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail
Les faits de l’arrêt commenté et publié au Bulletin ne présentent aucune originalité. Comptable d’une société de pompes funèbres, un salarié est mis à la retraite. Un an et dix jours plus tard, il saisit la juridiction prud’homale territorialement compétente d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de différentes indemnités. Deux points principaux méritent attention : la requalification d’un temps partiel en temps plein et le point de départ du délai de prescription relatif à la contestation d’une mise à la retraite.
Requalification d’un temps partiel en temps plein
Le contrat de travail à temps partiel doit en principe être écrit et préciser, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav., art. L. 3123-6). L’objectif de ce formalisme est de permettre au salarié de connaitre son rythme de travail. En l’espèce, ce formalisme n’avait pas été respecté. Au visa de l’article précité, la Cour de cassation rappelle la sanction applicable : « l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ». L’arrêt commenté s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante (Soc. 14 mai 1987, n° 84-43.829, Dr. soc. 1988. 444, obs. J. Savatier ; 26 janv. 2005, n° 02-46.146, D. 2005. 858 ![]() ; 21 nov. 2012, n° 11-10.258 P, D. 2012. 2809
; 21 nov. 2012, n° 11-10.258 P, D. 2012. 2809 ![]() ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ![]() ; JPC S 2013. 1093, note A. Barège ; 17 déc. 2014, n° 13-20.627, Dalloz actualité, 23 janv. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 162
; JPC S 2013. 1093, note A. Barège ; 17 déc. 2014, n° 13-20.627, Dalloz actualité, 23 janv. 2015, obs. W. Fraisse ; D. 2015. 162 ![]() ; JCP S 2015. 1067, note A. Barège). Simple, cette présomption peut être renversée par la double preuve qu’une durée exacte de travail a été convenue et que le salarié connaissait son rythme de travail et n’était pas tenu d’être à la disposition de l’employeur. En l’espèce, pour échapper à toute condamnation, l’employeur avait établi que le salarié exerçait ses fonctions de comptable à hauteur de quarante heures mensuelles seulement, essentiellement le samedi et que le reste de la semaine il travaillait comme gérant d’une société de gestion. Les juges du fond avaient suivi cet argumentaire en considérant que la durée précise du temps de travail était connue et que l’activité n’était exercée qu’une demi-journée par semaine, toujours les samedis matin. Le requérant pouvait donc difficilement prétendre être à la disposition permanente de l’employeur. Malgré ces éléments probants, le juge du droit censure l’analyse et considère que l’employeur échoue à renverser la charge de la preuve. Si la solution peut sembler sévère, elle permet aussi de rappeler les entreprises à la plus grande vigilance. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat d’exception dont il faut justifier. À défaut, il est requalifié en temps plein avec les droits salariaux qui accompagnent cette requalification. Pour renverser la présomption, il ne suffit pas d’établir que le salarié ne travaillait pas à temps plein. Il faut prouver qu’un accord a été convenu sur une durée exacte de travail et que le salarié connaissait son rythme d’activité. À ce titre, la production de bulletins de paie est insuffisante (Soc. 28 juin 1994, n° 91-40.809, inédit) de même que l’absence de clause d’exclusivité et la preuve que la durée du travail était inférieure à la durée légale (Soc. 9 janv. 2013, n° 11-16.433, D. 2013. 182
; JCP S 2015. 1067, note A. Barège). Simple, cette présomption peut être renversée par la double preuve qu’une durée exacte de travail a été convenue et que le salarié connaissait son rythme de travail et n’était pas tenu d’être à la disposition de l’employeur. En l’espèce, pour échapper à toute condamnation, l’employeur avait établi que le salarié exerçait ses fonctions de comptable à hauteur de quarante heures mensuelles seulement, essentiellement le samedi et que le reste de la semaine il travaillait comme gérant d’une société de gestion. Les juges du fond avaient suivi cet argumentaire en considérant que la durée précise du temps de travail était connue et que l’activité n’était exercée qu’une demi-journée par semaine, toujours les samedis matin. Le requérant pouvait donc difficilement prétendre être à la disposition permanente de l’employeur. Malgré ces éléments probants, le juge du droit censure l’analyse et considère que l’employeur échoue à renverser la charge de la preuve. Si la solution peut sembler sévère, elle permet aussi de rappeler les entreprises à la plus grande vigilance. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat d’exception dont il faut justifier. À défaut, il est requalifié en temps plein avec les droits salariaux qui accompagnent cette requalification. Pour renverser la présomption, il ne suffit pas d’établir que le salarié ne travaillait pas à temps plein. Il faut prouver qu’un accord a été convenu sur une durée exacte de travail et que le salarié connaissait son rythme d’activité. À ce titre, la production de bulletins de paie est insuffisante (Soc. 28 juin 1994, n° 91-40.809, inédit) de même que l’absence de clause d’exclusivité et la preuve que la durée du travail était inférieure à la durée légale (Soc. 9 janv. 2013, n° 11-16.433, D. 2013. 182 ![]() ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta
; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ![]() ; Dr. soc. 2013. 576, chron. S. Tournaux
; Dr. soc. 2013. 576, chron. S. Tournaux ![]() ). En revanche, la production de plannings hebdomadaires prévoyant la répartition des horaires entre les salariés et qui correspondaient à la durée indiquée sur les bulletins de paie permet de renverser la présomption litigieuse (Soc. 18 juin 2002, n° 00-41.978, inédit). Si la preuve est libre, elle reste exigeante au point que l’on puisse s’interroger sur la nature réelle de l’obligation qui, pour l’employeur, confine souvent à un piège. La règle est d’autant plus stricte qu’elle vaut aussi pour la seule conclusion d’un avenant modifiant la durée de travail (Soc. 20 juin 2013, n° 10-20.507, Dalloz actualité, 12 juill. 2013, obs. W. Fraisse ; D. 2013. 1629
). En revanche, la production de plannings hebdomadaires prévoyant la répartition des horaires entre les salariés et qui correspondaient à la durée indiquée sur les bulletins de paie permet de renverser la présomption litigieuse (Soc. 18 juin 2002, n° 00-41.978, inédit). Si la preuve est libre, elle reste exigeante au point que l’on puisse s’interroger sur la nature réelle de l’obligation qui, pour l’employeur, confine souvent à un piège. La règle est d’autant plus stricte qu’elle vaut aussi pour la seule conclusion d’un avenant modifiant la durée de travail (Soc. 20 juin 2013, n° 10-20.507, Dalloz actualité, 12 juill. 2013, obs. W. Fraisse ; D. 2013. 1629 ![]() ; Dr. soc. 2014. 11, chron. S. Tournaux
; Dr. soc. 2014. 11, chron. S. Tournaux ![]() ; JCP S 2013. 1334, note L. Dauxerre).
; JCP S 2013. 1334, note L. Dauxerre).
Point de départ du délai de prescription relatif à une contestation de mise à la retraite
Dans un second point le requérant contestait l’arrêt d’appel qui avait jugé prescrite sa demande d’indemnités de mise à la retraite. Celle-ci avait été décidée le 20 janvier 2020 mais, par application de la convention collective de branche qui prévoyait un préavis de quatre mois, le dernier jour travaillé avait été le 20 mai 2020. Or le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 1er février 2021. L’ensemble de ces dates suscitait une difficulté au regard de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, que vise l’arrêt commenté et aux termes duquel « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». La question revenait donc à se demander si ce délai de prescription d’un an devait courir à compter du 20 janvier 2020 (notification de la mise à la retraite) ou du 20 mai 2020 (date de la rupture effective). Cassant la décision des juges du fond, les magistrats du quai de l’Horloge retiennent la seconde solution. À nouveau, la décision ne doit pas surprendre et complète opportunément l’œuvre créatrice retenue en matière de départ à la retraite. La Cour de cassation a en effet récemment jugé qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite. Toutefois, lorsque ce départ s’inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail (Soc. 4 oct. 2023, n° 22-14.126, Dalloz actualité, 23 oct. 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1751 ![]() ; RJS 1/2024, n° 52 ; JCP S 2023. 1277, note E. Jeansen). En l’espèce c’est aussi grâce à une disposition conventionnelle portant sur la durée du préavis que le salarié échappe à la prescription. La solution mérite approbation dès lors que le juge applique une norme conventionnelle protectrice des droits des salariés leur permettant de reporter légèrement mais suffisamment le court délai de prescription que le législateur impose sans avoir pourtant formellement prévu ce type de dérogations.
; RJS 1/2024, n° 52 ; JCP S 2023. 1277, note E. Jeansen). En l’espèce c’est aussi grâce à une disposition conventionnelle portant sur la durée du préavis que le salarié échappe à la prescription. La solution mérite approbation dès lors que le juge applique une norme conventionnelle protectrice des droits des salariés leur permettant de reporter légèrement mais suffisamment le court délai de prescription que le législateur impose sans avoir pourtant formellement prévu ce type de dérogations.
Soc. 10 déc. 2025, FS-B, n° 24-12.066
par Thibault Lahalle, MCF-HDR, Directeur du master de Droit social, Université de Créteil
© Lefebvre Dalloz