Notion de consommateur et contrôle des clauses abusives
Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une personne physique concluant un contrat de crédit pour financer l’achat d’un bien immobilier qu’il projette à la location non professionnelle reste un consommateur au sens de la directive 93/13/CEE.
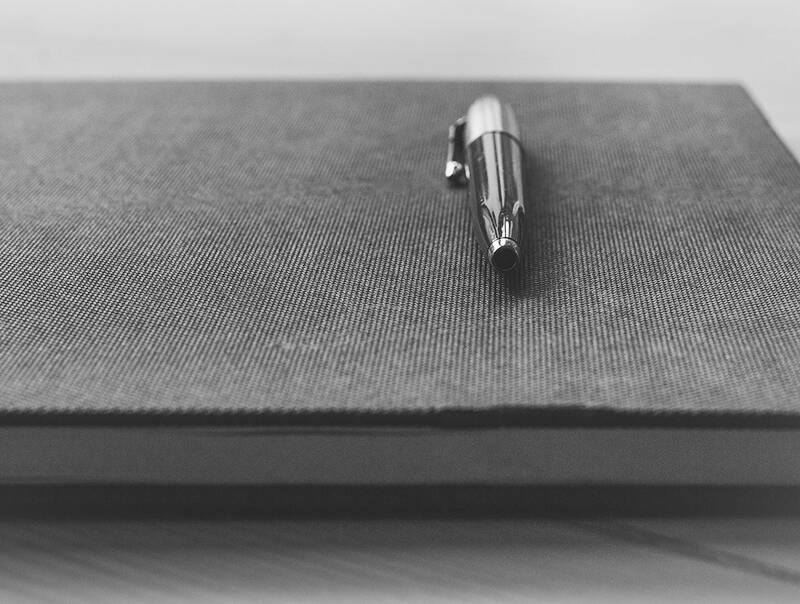
Nous retrouvons aujourd’hui dans ces colonnes le contrôle des clauses abusives après une actualité assez dense ces derniers mois (Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-25.823 F-B, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ![]() ; CJUE 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597
; CJUE 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597 ![]() ; 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23, Dalloz actualité, 7 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1215
; 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23, Dalloz actualité, 7 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1215 ![]() , note P. Dupont et G. Poissonnier
, note P. Dupont et G. Poissonnier ![]() ; ibid. 1924, obs. H. Kenfack
; ibid. 1924, obs. H. Kenfack ![]() ; 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 166
; 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 166 ![]() ; 25 avr. 2024, aff. C-561/21 et C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821
; 25 avr. 2024, aff. C-561/21 et C-484/21, Dalloz actualité, 3 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 821 ![]() ; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet ![]() ). Cette fois-ci, nous examinons un nouveau renvoi préjudiciel portant sur une question classique puisqu’elle intéresse la notion de consommateur au sens de la directive 93/13/CEE. Les juridictions des États membres éprouvent parfois, en effet, des difficultés à ce sujet de sorte que la Cour de justice est amenée à préciser comment interpréter le texte pour assurer une protection du consommateur adaptée aux objectifs poursuivis.
). Cette fois-ci, nous examinons un nouveau renvoi préjudiciel portant sur une question classique puisqu’elle intéresse la notion de consommateur au sens de la directive 93/13/CEE. Les juridictions des États membres éprouvent parfois, en effet, des difficultés à ce sujet de sorte que la Cour de justice est amenée à préciser comment interpréter le texte pour assurer une protection du consommateur adaptée aux objectifs poursuivis.
Rappelons brièvement les faits principaux ayant donné lieu au renvoi préjudiciel. L’affaire débute en Pologne. En l’espèce, des époux décident en 2008 d’acquérir un bien immobilier à Varsovie. Le but de cette acquisition est de mettre en location l’appartement ainsi acheté. Pour financer l’opération, les acquéreurs contractent un prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère (à savoir le franc suisse). Le taux d’intérêt est variable et le remboursement doit être opéré en złotys polonais. Onze ans plus tard, le contrat de crédit est intégralement honoré puisque les emprunteurs ont réglé la dernière échéance programmée.
Le 27 décembre 2019, ils saisissent toutefois le Sąd Okręgowy w Warszawie (le Tribunal régional de Varsovie) pour obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du prêt. Les emprunteurs soutiennent, au secours de leur demande en annulation, que certaines clauses du contrat de crédit, notamment celle de l’indexation sur le franc suisse, ont un caractère abusif. Le tribunal régional hésite sur la solution à préférer dans la mesure où les consommateurs ont acquis le bien afin de le mettre en location. Le juge estime qu’il existe ainsi un doute légitime sur l’application de la directive 93/13/CEE et plus précisément sur son article 2, b), et c), définissant respectivement le consommateur et le professionnel au sens de ce texte.
Le tribunal régional décide, par conséquent, de surseoir à statuer et de renvoyer à titre préjudiciel la question ainsi formulée :
« L’article 2, sous b) et c), de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne physique qui conclut un contrat de crédit hypothécaire en vue d’obtenir des fonds pour l’acquisition d’un seul local, destiné à être mis en location à titre onéreux (buy-to-let), doit être considérée comme étant un "consommateur", au sens de cette directive ? »
L’arrêt rendu le 24 octobre 2024 rappelle des constantes connues, tant au titre de la méthodologie déployée qu’au stade du résultat de sa mise en mouvement.
Une méthodologie classique
La notion de consommateur suscite des hésitations importantes et ce même en droit interne tant les critères de qualification peuvent être d’application délicate dans certaines espèces (v. à ce titre, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 10, n° 17, pointant la géométrie variable des acteurs principaux du droit de la consommation ; v. égal., par ex., Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 21-10.487 FS-B, Dalloz actualité, 17 mars 2022, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol ![]() l ; Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.097 FS-B, Dalloz actualité, 7 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1556
l ; Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.097 FS-B, Dalloz actualité, 7 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1556 ![]() ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ![]() ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol
; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol ![]() ; JT 2022, n° 257, p. 9, obs. X. Delpech
; JT 2022, n° 257, p. 9, obs. X. Delpech ![]() ).
).
Comme à chaque fois que la Cour de justice est confrontée à une question de délimitation de la directive 93/13/CEE, celle-ci commence par rappeler la définition du consommateur. Il s’agit de « toute personne physique, qui dans les contrats relevant de ladite directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » (pt n° 23, nous soulignons). Il ne s’agit que de l’économie de l’article 2, b), qui, combiné au 2, c), permet de qualifier les parties au contrat conclu. Cette opposition entre consommateur et professionnel s’explique en très grande partie par la situation d’infériorité du premier par rapport au second qui est l’une des bases du droit de la consommation (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, Dalloz, coll. « Précis », 10e éd., 2020, p. 2, n° 1). On ne sera donc guère étonné de la mention d’une telle infériorité dans la décision étudiée laquelle est très habituelle dans les renvois préjudiciels en matière de contrôle des clauses abusives.
Le critère utilisé, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, est dit « fonctionnel » (pt n° 25 de l’arrêt analysé). Celui-ci consiste, tout simplement, à déterminer si le rapport entre les parties « s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession » (pt n° 25, nous soulignons). Le but de la directive 93/13/CEE étant la protection du consommateur, il est nécessaire d’adopter une interprétation large de la notion considérée. Nous retrouvons ici d’ailleurs un arrêt que nous avions commenté dans ces colonnes en 2023 sur cette idée précise (CJUE 8 juin 2023, aff. C-570/21, Dalloz actualité, 13 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1117 ![]() ; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ![]() ; Rev. prat. rec. 2023. 40, chron. K. De La Asuncion Planes
; Rev. prat. rec. 2023. 40, chron. K. De La Asuncion Planes ![]() ; arrêt cité dans la décision étudiée au pt n° 27).
; arrêt cité dans la décision étudiée au pt n° 27).
Le juge national doit, par conséquent, analyser la situation en prenant en compte tous les éléments de fait qui peuvent démontrer « à quelle fin ce bien ou ce service est acquis » (pt n° 30). Cette idée est une position très classique au sens du droit de l’Union. La méthodologie déployée reste, en effet, presque toujours identique dans ce type de renvoi préjudiciel.
Celle-ci est assez efficace pour résoudre la difficulté comme nous allons le voir.
Le triomphe de la qualité de consommateur
Les faits donnant lieu au renvoi préjudiciel doivent être ici légèrement précisés. Les emprunteurs étaient d’une part officier de police judiciaire et, d’autre part, directrice d’école. Ils n’avaient donc pas acquis le bien pour des besoins professionnels. La Cour de justice relève, en outre, un élément qui n’est pas que de l’ordre du détail en ce sens : les emprunteurs n’avaient pas d’autres biens de rapport que celui qu’ils projetaient d’acquérir avec le crédit hypothécaire libellé en devise étrangère dont il est demandé l’annulation. La conséquence est donc simple à tirer. Des emprunteurs souhaitant acheter un bien immeuble et qui, pour ce faire, concluent un prêt ne peuvent pas être disqualifiés de leur qualité de consommateur en raison de la volonté de procéder à un investissement locatif.
Bien évidemment, le but d’un renvoi préjudiciel n’est pas de trancher le litige au fond. Ainsi, faudra-t-il que la juridiction de renvoi vérifie la question de la finalité exacte du contrat. Tant que celle-ci n’a pas une visée professionnelle, la qualité de consommateur ne saurait toutefois être rejetée. L’arrêt du 24 octobre 2024 vient par ailleurs éviter à la juridiction de renvoi un autre doute en rappelant que la présence d’un agent immobilier (ou de tout autre équivalent d’un « spécialiste pour effectuer l’achat et gérer la location ») ne saurait pas non plus écarter cette qualité. Cet élément, à lui seul, n’a, en effet, aucun rapport avec la visée professionnelle. C’est seulement lorsqu’il s’ajoute à d’autres indices qu’il peut faire pencher la balance.
Cette solution s’inscrit dans la droite lignée des textes dessinant la notion de consommateur en droit de l’Union. Il serait purement et simplement contradictoire d’exclure la qualification de consommateur pour la seule et unique raison que le bien acquis avec le prêt litigieux était destiné à être mis en location. Ce n’est que lorsque l’acquéreur procède à l’achat dans le cadre d’une activité liée à l’exercice d’une profession que la qualification de consommateur s’éloigne inévitablement. C’est la raison pour laquelle la Cour de justice a bien pris le soin de rappeler qu’il résulte du dossier transmis que les acquéreurs n’avaient acquis qu’un seul bien de rapport pour le moment. Le grand éloignement de leur profession avec la commercialité vient accroître très grandement la possibilité pour la juridiction de renvoi de pouvoir appliquer la directive 93/13/CEE à leur situation.
Voici donc un arrêt intéressant qui utilise des constantes connues. Ces rappels sont importants pour assurer à la directive 93/13/CEE luttant contre les clauses abusives son plein effet. Une position contraire viendrait très grandement diminuer la protection dessinée par la jurisprudence ces dernières années.
CJUE 24 oct. 2024, aff. C-347/23
© Lefebvre Dalloz