Ordonnance de protection : souplesse des conditions de sa délivrance
Le juge aux affaires familiales qui délivre une ordonnance de protection, car il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime, peut interdire au défendeur d’entrer en relation avec l’enfant de la victime, sans devoir se prononcer sur l’existence d’un danger spécifiquement encouru par l’enfant.
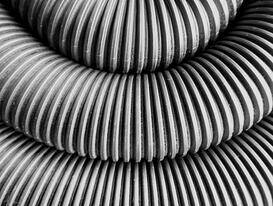
Créé par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, amélioré par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (v. not., REGINE, Commentaire de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes n° 2014-873 du 4 août 2014, D. 2014. 1895 ![]() ), le mécanisme de l’ordonnance de protection permet, en cas de violences alléguées et de danger par l’un des membres du couple considérés comme vraisemblables, l’éloignement du compagnon violent par le juge aux affaires familiales investi de prérogatives relevant classiquement de celles du juge répressif (C. Gatto, L’enfant face aux violences conjugales, AJ fam. 2013. 271
), le mécanisme de l’ordonnance de protection permet, en cas de violences alléguées et de danger par l’un des membres du couple considérés comme vraisemblables, l’éloignement du compagnon violent par le juge aux affaires familiales investi de prérogatives relevant classiquement de celles du juge répressif (C. Gatto, L’enfant face aux violences conjugales, AJ fam. 2013. 271 ![]() ). Le magistrat peut également prendre d’autres mesures et, notamment, interdire au compagnon violent d’entrer en contact avec une autre personne, tel que l’enfant de la victime (commun du couple ou non). La question se posait alors de savoir si, pour justifier une telle mesure, seule suffit la démonstration de violences et d’un danger vraisemblables à l’égard de la victime qu’est la compagne ou si les juges du fond doivent caractériser un danger spécifique pour l’enfant : la Cour de cassation, dans sa décision du 23 mai 2024, opte pour la première solution et opère ainsi une application souple des conditions de délivrance d’une telle ordonnance.
). Le magistrat peut également prendre d’autres mesures et, notamment, interdire au compagnon violent d’entrer en contact avec une autre personne, tel que l’enfant de la victime (commun du couple ou non). La question se posait alors de savoir si, pour justifier une telle mesure, seule suffit la démonstration de violences et d’un danger vraisemblables à l’égard de la victime qu’est la compagne ou si les juges du fond doivent caractériser un danger spécifique pour l’enfant : la Cour de cassation, dans sa décision du 23 mai 2024, opte pour la première solution et opère ainsi une application souple des conditions de délivrance d’une telle ordonnance.
En l’espèce, une femme a obtenu en urgence du juge aux affaires familiales, saisi le 23 mars 2022, une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 octobre 2022, qui a jugé qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées par l’épouse et le danger auquel elle était exposée. Dans ce cadre, le conjoint s’est vu accorder un droit de visite pour voir l’enfant commun du couple mais il lui a été interdit de le recevoir, de le rencontrer ou d’entrer en relation avec lui à toute autre occasion.
Celui-ci a formé un pourvoi en cassation pour contester ces dernières mesures qui l’empêchent de voir régulièrement son enfant. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir expliqué en quoi ce dernier était exposé à un danger, privant ainsi sa décision de base légale pour défaut de motivation. En effet, selon lui, les juges du fond auraient dû distinguer la situation de la mère de celle de l’enfant : ils ne pouvaient déduire l’existence d’un danger pour l’enfant de l’existence d’un danger et de violences auxquels serait exposée la mère, au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mai 2024, rejette ce raisonnement et, de fait, le pourvoi. Elle reconnaît aux juges du fond le pouvoir d’interdire tout contact entre l’enfant et le père – en-dehors du droit de visite organisé – sur le seul motif de l’existence vraisemblable de violences subies par la mère et du danger auquel elle est exposée. À ce titre, la cour d’appel « n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant ». En effet, elle reprend les termes de l’article 515-11 du code civil qui prévoit explicitement la possibilité d’interdire au défendeur d’entrer en relation avec d’autres personnes que la victime sans préciser qu’un danger à l’égard de celles-ci doit également être caractérisé.
La souplesse du régime de l’ordonnance de protection
Par cet arrêt, la Cour de cassation applique souplement le régime de délivrance de l’ordonnance de protection en refusant d’exiger de la part des juges du fond la caractérisation d’un danger pour l’enfant distinct de celui encouru par la mère. Cette souplesse résulte déjà de la lettre du texte, qui impose seulement au juge de caractériser le caractère vraisemblable des faits de violences allégués à l’égard du membre du couple, ce qui ne contraint pas le juge à caractériser des faits pénalement réprimés (M.-B. Maizy et M. Chopin, La loi du 9 juillet 2010 et l’ordonnance de protection : une réponse adaptée aux violences intrafamiliales ?, AJ fam. 2010. 514 ![]() ), précision faite que l’appréciation par le juge du caractère vraisemblable des violences alléguées et du danger auquel serait exposée la victime relève de son pouvoir souverain (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-24.180, D. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot
), précision faite que l’appréciation par le juge du caractère vraisemblable des violences alléguées et du danger auquel serait exposée la victime relève de son pouvoir souverain (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-24.180, D. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ![]() ; AJ fam. 2016. 537, obs. A. Sannier
; AJ fam. 2016. 537, obs. A. Sannier ![]() ; Dr. fam. 2016. Comm. 245, note C. Berthier). L’arrêt doit donc être analysé, en la matière, comme parfaitement conforme à la ratio legis.
; Dr. fam. 2016. Comm. 245, note C. Berthier). L’arrêt doit donc être analysé, en la matière, comme parfaitement conforme à la ratio legis.
Toutefois, la difficulté dans le cadre d’une ordonnance de protection relève du domaine probatoire quant au caractère vraisemblable des violences et du danger, qu’il appartient au demandeur – généralement à la demanderesse – de démontrer, ce qui conduit à de nombreuses absences de délivrance d’une ordonnance de protection (Rapport parlementaire de G. Geoffroy et D. Bousquet du 17 janv. 2012 sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juill. 2010 ; Mission d’évaluation de l’ordonnance de protection, 28/13 IGAS/IGSJ de juin 2014, p. 13), car la seule parole de la victime semble insuffisante (d’autres documents, tels qu’un certificat médical, sont donc souvent nécessaires pour convaincre le juge, Rép. pr. civ., v° Violences familiales – Ordonnance de protection, mesure phare de la loi du 9 juillet 2010, par E. Bazin, n° 57). Dans l’arrêt commenté, le père ne semble pas contester les violences conjugales : la souplesse du régime admise par la Cour de cassation est ainsi doublement justifiée. De plus, nulle question ici d’une « déconnexion de la situation de danger et du caractère vraisemblable des violences alléguées » (G. Kessler, La déconnexion de la situation de danger et du caractère vraisemblable des violences alléguées dans le cadre de l’ordonnance de protection, Dr. fam. 2017. Étude 7, qui démontre les risques d’une telle déconnexion à partir d’un arrêt d’appel) : cela rend plus aisée la délivrance de l’ordonnance, conformément à l’opinion de la doctrine majoritaire (ibid., selon lequel, « La meilleure solution serait sans doute de considérer que l’établissement du caractère vraisemblable des violences alléguées fait présumer qu’il en va de même du danger auquel la victime est exposée » [n° 5] ; v. égal. F. Defferrard, La « suspicion légitime » contre les violences au sein des couples ou le nouveau « référé protection », Dr. pénal 2010. Étude 27 ; E. Mulon et J. Casey, Loi du 9 juillet 2010 et décret du 29 septembre 2010 sur les violences conjugales : aspects de droit civil et de droit pénal, Gaz. Pal. 10-11 nov. 2010, p. 6).
Le renforcement de la protection du conjoint victime et de l’enfant
L’arrêt renforce la protection du conjoint victime, puisqu’il permet de confirmer la délivrance d’une ordonnance de protection sans autre justification par les juges du fond que l’existence de violences et d’un danger vraisemblables à son égard. La Cour de cassation mentionne le fait que le juge peut interdire au parent de rencontrer l’enfant, et notamment « de se rendre au domicile familial où la victime demeure » avec l’enfant. En effet, ce serait mettre de nouveau en danger la victime et risquer d’anéantir les effets protecteurs de l’ordonnance délivrée. Un tel élément fait écho à la loi du 18 mars 2024 relative aux violences intrafamiliales, puisque la titularité de l’autorité parentale peut faire l’objet d’un retrait automatique en cas de condamnation pour crime sur l’autre parent. De même, elle rend possible une suspension de plein droit des droits de visite et d’hébergement lorsque le parent fait l’objet d’un contrôle judiciaire.
La souplesse de la décision protège également directement l’enfant que l’on peut supposer exposé aux violences alléguées, puisque son père sera privé de le voir en dehors du cadre du droit de visite qui lui a été accordé (et que l’on peut imaginer encadré, notamment par la présence d’un tiers). Aussi, contrairement à ce qu’affirmait le demandeur au pourvoi, « l’existence d’un danger pour l’enfant » peut « se déduire du seul fait que sa mère est exposée à des violences vraisemblables et à un danger », mais la caractérisation d’un tel danger n’est pas nécessaire pour la délivrance d’une ordonnance de protection. Seule suffit l’existence de violences et d’un danger vraisemblables à l’égard de la mère. La protection de l’enfant par cet arrêt s’inscrit dans la continuité des politiques publiques qui « font désormais davantage le lien entre violences conjugales et violences faites aux enfants » (A. Sannier, Focus sur les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales, AJ fam. 2017. 229 ![]() ) : « un mari violent n’est pas un bon père » (ibid.). L’enfant souffre des violences conjugales et est susceptibles d’en subir à son tour (C. Gatto, L’enfant face aux violences conjugales, préc. ; E. Durand, Violences conjugales et parentalité, AJ fam. 2013. 276
) : « un mari violent n’est pas un bon père » (ibid.). L’enfant souffre des violences conjugales et est susceptibles d’en subir à son tour (C. Gatto, L’enfant face aux violences conjugales, préc. ; E. Durand, Violences conjugales et parentalité, AJ fam. 2013. 276 ![]() qui évoque notamment le concept d’aliénation parentale). La récente loi précitée sur les violences intrafamiliales résonne également dans ce contexte, puisque celle-ci prévoit de nouveaux cas de suspension – de plein droit ! – de l’exercice de l’autorité parentale, notamment dans le cadre d’agressions sexuelles incestueuses pour lesquels le parent est poursuivi ou a été condamné, et même de retrait automatique de la titularité de l’autorité parentale dans cette même hypothèse.
qui évoque notamment le concept d’aliénation parentale). La récente loi précitée sur les violences intrafamiliales résonne également dans ce contexte, puisque celle-ci prévoit de nouveaux cas de suspension – de plein droit ! – de l’exercice de l’autorité parentale, notamment dans le cadre d’agressions sexuelles incestueuses pour lesquels le parent est poursuivi ou a été condamné, et même de retrait automatique de la titularité de l’autorité parentale dans cette même hypothèse.
***
En somme, l’appréciation souple par la Cour de cassation des conditions de délivrance d’une ordonnance de protection est louable au regard de l’objectif poursuivi par une telle mesure et de la nécessité de protéger le compagnon, victime directe des violences, et l’enfant, potentielle victime collatérale de celles-ci. De manière générale, l’arrêt s’inscrit dans une perspective globale de renforcement de protection des victimes de violences intrafamiliales : d’autres mesures peuvent être prises par le juge dans le cadre de l’ordonnance de protection – il peut notamment statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. De même, il s’agit d’un combat mondial, comme en témoignent notamment le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ou encore la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui insiste sur l’obligation positive mise à la charge des États de prendre les mesures nécessaires aux fins de protection de la victime des violences alléguées (v. par ex., CEDH 23 févr. 2016, Civek c/ Turquie, n° 55354/11, Dalloz actualité, 8 mars 2016, obs. E. Autier ; AJDA 2016. 1738, chron. L. Burgorgue-Larsen ![]() ; D. 2016. 1124
; D. 2016. 1124 ![]() , note L. Pelletier
, note L. Pelletier ![]() ).
).
Civ. 1re, 23 mai 2024, FS-B, n° 22-22.600
© Lefebvre Dalloz