Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » 1er octobre au 31 octobre 2024
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante du 1er octobre au 31 octobre 2024.
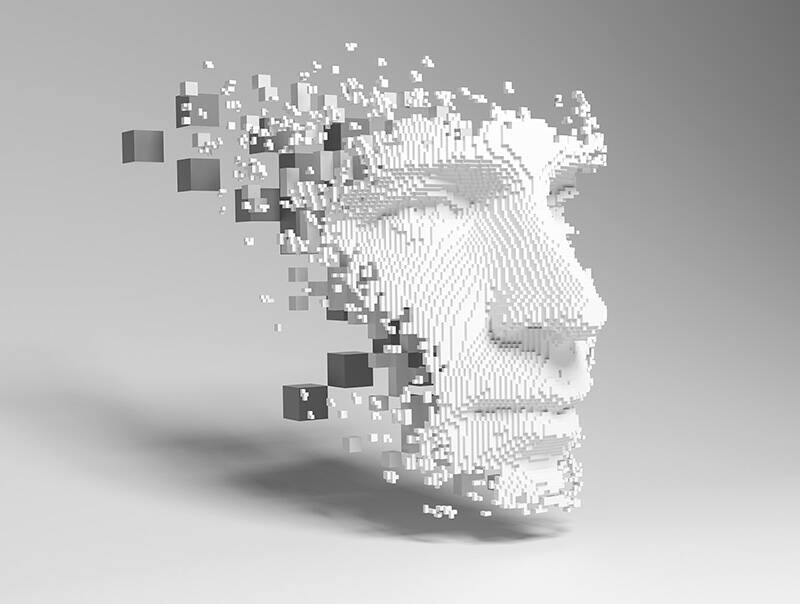
Propriété littéraire et artistique
Convention de Berne
- Critère de réciprocité matérielle et art. 2.7. Une demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vitra Collections AG, une société de droit suisse, à Kwantum Nederland BV et Kwantum België BV, qui exploitent, aux Pays-Bas et en Belgique, une chaîne de magasins d’articles d’aménagement intérieur, parmi lesquels du mobilier, au motif que ces dernières ont commercialisé une chaise qui, selon Vitra, enfreindrait des droits d’auteur dont elle est titulaire. Selon la CJUE, l’article 2, sous a), et l’article 4, § 1, de la directive 2001/29, lus en combinaison avec l’article 17, § 2, et l’article 52, § 1, de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, ils s’opposent à ce que les États membres appliquent, en droit national, le critère de réciprocité matérielle prévu à l’article 2, § 7, deuxième phrase, de la convention de Berne à l’égard d’une œuvre des arts appliqués dont le pays d’origine est un pays tiers et dont l’auteur est un ressortissant d’un pays tiers. Il appartient au seul législateur de l’Union, conformément à l’article 52, § 1, de la Charte, de prévoir, par une législation de l’Union, s’il y a lieu de limiter l’octroi, dans l’Union, des droits prévus à cet article 2, sous a), et à cet article 4, § 1. (CJUE 24 oct. 2024, C-227/23, Kwantum)
Intelligence artificielle
- Recommandations SACD. La SACD et les représentants des producteurs s’engagent sur le terrain de l’intelligence artificielle. La SACD et les organisations représentant les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques ont adopté des recommandations relatives à l’insertion de clauses dans les contrats liant les auteurs aux producteurs afin d’accompagner le développement de l’utilisation de l’intelligence artificielle générative (IAG) dans la création française et européenne. (Communiqué du 23 oct. 2024)
Conditions de protection du droit d’auteur
- Originalité d’une combinaison de fleurs et feuillages (oui). Le premier dessin représente plusieurs fleurs de formes et couleurs différentes, mais dénuées de toute tige et feuillage, entre lesquelles sont ajoutées des formes sinueuses pouvant évoquer des rubans. Le second reproduit différentes fleurs et feuillages mais certaines fleurs dessinées tiennent davantage de la figure géométrique que d’une fleur naturelle. Enfin, le troisième représente moult fleurs, principalement de la même taille, dans des coloris différents, agrémentées de quelques tiges, sans feuilles, le tout donnant une impression de masse. Ces quelques exemples renforcent donc l’originalité du dessin en cause, en montrant qu’un assemblage de fleurs et de feuillages, peut être très différent d’un autre, pour peu que les choix qui y président, comme en l’espèce, procèdent de l’arbitraire, et soient le reflet de la personnalité de son auteur. Le tribunal retient donc l’originalité du dessin n° 11584 T. (TJ Rennes, 7 oct. 2024, n° 21/01974)
- Originalité d’une structure temporaire (non). La société VE, créée en décembre 1997, est spécialisée dans l’organisation d’évènements, dans lesquels elle propose la location d’espaces et notamment des tentes de réception. Elle expose avoir créé en 2007 un type de structure temporaire haut de gamme pour laquelle elle a fait appel à un illustrateur technique M. [G] [K], structure commercialisée sous le nom d’«Orangerie éphémère ». Elle revendique un droit d’auteur. (…) Les caractéristiques de « l’Orangerie éphémère », prises isolément ou en combinaison, sont dépourvues d’originalité de sorte que l’oeuvre revendiquée n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Il convient dès lors de rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. (Paris, 9 oct. 2024, n° 22/20264)
- Originalité d’une émission de TV. C’est au terme d’une analyse pertinente des éléments du dossier que le tribunal a jugé que M. [X] était en réalité l’auteur de l’émission “Suivez le guide” qui apparaît empreinte de la personnalité de son auteur tant par son format que par les partis pris de montage et de réalisation, leur conférant une originalité certaine. Il est en effet attesté le travail de recherche, de rédaction du synopsis, voire le résumé des plateaux ou la préparation des questions posées par la présentatrice, mais également, au travers la scénarisation de la présentation générale des monuments, de leur histoire, de leurs particularités et intérêt, un réel travail de réalisation et de montage de ces émissions par M. [X]". (…) Face à ces éléments, la société Y se contente de contester l’originalité du format de l’émission dont elle indique, sans la moindre preuve à l’appui de son affirmation, qu’il correspond au format général des émissions de la chaine. Le jugement qui a retenu que l’émission “Suivez le guide” constituait une œuvre de l’esprit empreinte de la personnalité de son auteur, M. [X], est en conséquence confirmé. (Bordeaux, 15 oct. 2024, n° 22/00925)
Titularité
- Oeuvre collective. Par ailleurs, la société A produit diverses fiches navettes adressées par son manager à Monsieur [E] et contenant diverses directives quant à la couleur, aux formats papier et/ou numérique, au type de document, au nombre d’exemplaires et au texte à utiliser pour satisfaire la commande ou le projet, ainsi que différents courriels sollicitant l’appelant pour qu’il fasse des modifications ou ajouts en fonction de l’appréciation de son travail par sa supérieure hiérarchique. Par conséquent, loin de démontrer toute création personnelle, les éléments de l’espèce confirment que Monsieur [E] a participé à une oeuvre collective à l’initiative de son employeur qui l’a éditée, publiée ou divulguée sous sa direction et son nom, dans laquelle sa contribution personnelle s’est fondue dans l’ensemble en vue duquel elle était conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à l’appelant un droit distinct, comme le prévoit l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle. La demande de Monsieur [E] doit donc être rejetée. (Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 oct. 2024, n° 22/02173)
Bases de données
- Investissement substantiel et matérialité de la contrefaçon. Il ressort des circonstances que la société SFD démontre à tout le moins avoir dépensé environ 25 000 euros pour la mise à jour de sa base de données entre 2019 et 2020, dépenses permettant de vérifier le contenu de la base est de s’assurer de la fiabilité des informations qu’elle contient. Elle justifie donc en 2020 d’un investissement substantiel nouveau portant sur l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette base, étendant ainsi son droit à la protection de sa base de données. (…) Il ressort clairement des conclusions de l’expert que la société AD a réutilisé, au point de la reconstituer, une partie substantielle de la base de données de la société SFD (…). Il ressort de ces circonstances que la contrefaçon est établie s’agissant des données relatives aux garages indépendants. Elle n’est pas établie s’agissant du surplus des données, en particulier celles relatives aux garages sous enseigne. (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145)
Procédure
- Compétence. Si la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes. Conformément au premier alinéa de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (T. confl., 7 oct. 2024, n° 4317)
- Mesure de blocage (CPI, art. L. 336-2) et recours du CNC, de la société Gaumont et de la société Disney. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…) La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la “substance même du droit à la liberté d’entreprendre” des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés Orange, Bouygues télécom, Free, SFR et SFR fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à plus d’une quinzaine de sites de streaming, à partir du territoire français par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix. (TJ Paris, 18 oct. 2024, n° 24/11901)
Statut professionnel
- OTQF et contrat de production audiovisuelle. M. A a cédé à la société de production "Cotton Prod", par contrat du 9 février 2023, ses droits d’auteur ainsi que les droits d’exploitation du court-métrage "Montparnasse, au revoir". Aux termes de ce contrat, M. A sera le réalisateur du film. Ce projet a obtenu un accord de subventionnement, à hauteur de 83 000 € par le Centre national de la cinématographie (CNC), contractualisé le 7 mars 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société de production "Cotton Prod" a confié la réalisation du court-métrage à M. A., dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage et que le tournage doit durer 25 jours, répartis sur les mois de mars à juin 2024. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du tournage qui était déjà prévu à la date de la mesure d’éloignement attaquée et toujours en cours à cette date, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requêté dirigés contre ces décisions, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A., laquelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. (TA Paris, 4 oct. 2024, n° 2419418)
- Proposition de loi visant à l’instauration d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi avait été déposée par M. Pierre Dharréville, député des Bouches‑du‑Rhône sous la XVIe législature. Elle est aujourd’hui portée par Mme Soumya BOUROUAHA et une trentaine de députés. Les signataires de cette proposition veulent “reconnaître le travail que constitue ce geste de création et le protéger. Ils souhaitent ainsi ouvrir un débat et permettre que soient prises des décisions permettant d’assurer une meilleure protection sociale aux créateurs et créatrices dans notre pays”. (Déposée le 15 oct. 2025)
- Revenus de l’activité d’artistes-auteurs et direction de collection. Une demande d’annulation pour excès de pouvoir à l’endroit de l’instruction n° DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale avait été faite par le CAAP, mais elle est rejetée pour différentes raisons et notamment parce qu’elle n’est pas inintelligible, ni ne porte atteinte au principe de sécurité juridique du fait des imprécisions qu’elle comporterait ou des confusions qu’elle serait susceptible de créer. On retiendra le point 13. Le Conseil d’Etat rappelle que “le 9° de l’article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 1er du décret du 28 août 2020, prévoit que constituent également des revenus artistiques principaux, tels que définis au point précédent, les revenus provenant de " la conception et de l’animation d’une collection éditoriale originale". Il résulte certes des dispositions des articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale citées aux points 9 et 10, définissant le champ d’application du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, “que l’activité des directeurs de collection n’est susceptible d’entrer dans le champ de ce régime que dans la mesure où elle permet de les regarder comme auteurs ou co-auteurs des ouvrages de la collection qu’ils dirigent”. (CE 16 oct. 2024, n° 472016)
Fiscalité
- Crédit d’impôt. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que, pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 220 octies du code général des impôts, l’agrément à titre définitif doit être délivré par le ministre chargé de la culture dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fixation de l’œuvre ou de la production de celle-ci. En l’espèce, l’association Encore Music a justifié de la fixation de l’œuvre par la publication de l’enregistrement "Hâte-toi lentement" de l’artiste Isabelle Georges sur support numérique (disque compact) le 25 juin 2021. La ministre de la culture fait valoir que la requérante, à qui l’obligation d’obtenir un agrément à titre définitif dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la fixation de l’œuvre avait été rappelée dans le courrier du 3 septembre 2020 ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, a sollicité la délivrance de l’agrément à titre définitif le 25 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé par les dispositions de l’article 220 Q du code général des impôts. La circonstance, à la supposer établie, que le retard pris dans la demande de l’agrément à titre définitif est imputable à des contraintes indépendantes de la volonté de l’association Encore Music liées notamment aux problèmes de santé rencontrés par son administratrice et l’arrêt définitif de ses fonctions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. L’allégation selon laquelle le comité d’experts chargé de se prononcer sur la délivrance de l’agrément définitif prévu à l’article 220 Q du code général des impôts ne se réunirait pas régulièrement pour permettre l’examen des dossiers déposés, à la supposer établie, n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, c’est à bon droit que la ministre de la culture a refusé de délivrer à l’association Encore Music l’agrément à titre définitif prévu à l’article 220 Q du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. (TA Paris, 23 oct. 2024, n° 2324148)
Propriété industrielle
Droit des marques
- Appréciation du risque de confusion - Marques faiblement distinctives. Dans le cadre d’un conflit opposant la marque Fruitology, déposée pour des services en classe 41 (Education dans le domaine culinaire), et la marque verbale portugaise antérieure Centro de Frutologia, enregistrée également pour des services en classe 41 (Education; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et ateliers de formation), le Tribunal de l’Union européenne note, au regard d’une appréciation globale, qu’il existe un risque de confusion, pour une partie non négligeable du public pertinent, ayant un niveau d’attention moyen, même dans l’hypothèse, retenue par la chambre de recours, selon laquelle la marque antérieure ne posséderait qu’un faible caractère distinctif. En effet, eu égard à l’identité ou la similitude des services en cause, la coïncidence accrue des mots inventés « frutologia » et « fruitology » l’emporte sur les différences entre les signes en conflit et en particulier sur la présence de l’expression « centro de » au début de la marque antérieure, qui est moins distinctive que le mot « frutologia », de sorte qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse être amenée à penser que les services en cause proposés sous ces marques ont une origine commune ou que la marque demandée constitue une variante de la marque antérieure. (TUE 23 oct. 2024, aff. T-523/23)
- Appréciation du risque confusion. Dans la cadre d’un conflit opposant la marque VINATIS, déposée pour des services de la classe 35, en lien avec du vin ou d’autres boissons alcooliques ou non alcooliques, et la marque figurative antérieure Vinitus, enregistrée pour des services en classe 43 (services de restaurants; bars à tapas…), le Tribunal de l’Union européenne retient que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique. Bien que l’élément « vin », commun auxdits signes, soit allusif, cela ne peut avoir pour effet d’exclure les similitudes existantes entre ces signes du fait de cet élément. De même, les différences visuelles et phonétiques entre les éléments les plus distinctifs des signes en conflit, à savoir les éléments « itus » et « atis », sont assez limitées et, partant, insuffisantes pour constater que ces signes sont différents eu égard à l’ensemble de leurs similitudes, en particulier celles résultant de l’élément « vin » commun auxdits signes. C’’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, malgré la faible similitude de certains des services en cause. La similitude élevée des signes en conflit sur le plan phonétique et leur similitude moyenne sur le plan visuel, ainsi que la similitude, à des degrés divers, des services en cause et le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure impliquent que le public pertinent espagnol, même dans le cas où son niveau d’attention est élevé, pourrait croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. (TUE 23 oct. 2024, aff. T-605/23)
- Usage sérieux - Lieu de l’usage. La circonstance que certains services couverts par une marque soient fournis en dehors de l’Union ne fait pas obstacle à l’existence d’un usage sérieux de ladite marque au sein de l’Union, lequel peut être révélé par l’ensemble des démarches entreprises dans l’Union afin de commercialiser ces services. Il convient d’établir une distinction entre le lieu de la prestation des services et le lieu de l’usage d’une marque de l’Union européenne, seul ce dernier étant pertinent aux fins de l’examen du caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne. En conséquence, il y a lieu de considérer que, même lorsque les services sont proposés au public à la vente ou promus sur le marché de l’Union, mais sont ensuite fournis (ou « exportés ») en dehors du territoire de l’Union (dans les États du monde entier où les clients sont établis), un tel usage de la marque de l’Union européenne peut être considéré comme sérieux au sens de l’article 58, § 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18, § 1, second alinéa, sous b), et l’article 9, § 3, sous c), du même règlement, transposé par analogie aux « services ». (TUE 16 oct. 2024, aff. T-211/23)
- Prescription - Marque domaniale - Déceptivité - Déchéance. S’il est constant que la marque domaniale est attachée au domaine viticole dont elle constitue un élément indétachable qui ne peut être transmis indépendamment de la propriété de la terre, il s’agit d’un élément incorporel du fond qui n’en conserve pas moins sa fonction de marque de sorte que l’action en nullité qui la remet en cause ne constitue pas pour autant une action réelle immobilière qui partant serait soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, quand bien même le litige tendrait à la défense d’une AOP. C’est donc la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’est appliquée à compter du 19 juin 2008 à l’action en nullité d’une marque qui constitue une action mobilière ou personnelle, même s’agissant de poursuivre la nullité d’une marque domaniale. Lorsque les conditions d’usage d’une marque domaniale ont été contrôlées, qu’il s’agisse du conditionnement des vins mais également de leur vinification et de la cohabitation de deux domaines au sein d’une même exploitation, lesquelles n’ont pas appelé d’observations de la part de l’organe de contrôle des appellations domaniales, de sorte qu’en l’état des pièces produites, l’action en déchéance visant de manière générale une utilisation devenue trompeuse d’une marque domaniale (château) ne saurait prospérer. (Bordeaux, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 22/00403)
- Prescription - Forclusion par tolérance. L’article L. 716-2-6 nouveau du code de la propriété intellectuelle, d’application immédiate au 11 décembre 2019, n’a rendu imprescriptibles que les actions dont la prescription n’était pas encore acquise sous l’empire du droit ancien au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019, prise en application de la loi Pacte, le 11 décembre 2019. En effet, il n’est pas discuté que selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’ elle n’a pas d’effet rétroactif. Elle ne saurait ainsi remettre en cause une situation définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne. En ce sens l’article 2222 du code civil prévoit que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion déjà acquise. En revanche, elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Dès lors, si l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, selon lequel l’action ou la demande nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, est applicable aux titres existants au jour de son entrée en vigueur, en l’absence de toute disposition expresse transitoire de l’ordonnance permettant de déroger aux principes instaurés par les articles 2 et 2222 du code civil, l’imprescriptibilité nouvelle qui doit être regardée comme une disposition qui allonge le délai de prescription ne pouvait s’appliquer aux prescriptions d’ores et déjà acquises au jour de son entrée en vigueur. A contrario, elle avait vocation à régir les demandes en nullité afférentes à des situations dont la prescription n’était alors pas acquise.
La jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte faisait déjà de l’enregistrement de la marque postérieure non seulement une condition mais également le point de départ du délai de forclusion par tolérance. Il est ainsi constant que la prescription par tolérance suppose établie la connaissance par le propriétaire d’une marque antérieure de l’usage par un tiers de la marque postérieure, après son enregistrement, de sorte que le point de départ d’une telle forclusion ne peut être antérieur à la date d’enregistrement du signe litigieux à titre de marque. (Bordeaux, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 23/03449)
- Mauvaise foi (non). Il est admis que la seule connaissance par le déposant de l’utilisation du signe par un tiers, ne suffit pas à le constituer de mauvaise foi et à rendre le dépôt frauduleux, la mauvaise foi supposant d’établir que le dépôt litigieux n’a été effectué que pour détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver définitivement un tiers d’un signe nécessaire à son activité. Or, tandis qu’aucun élément ressortant du contrat de location gérance ou de ses avenants, tous antérieurs au dépôt en litige, n’interdisait effectivement au locataire gérant de déposer en tant que marque l’enseigne ’MONKEY’S FOREST’ sous laquelle il exploitait le parc d’attraction objet de ces contrats, l’appelante ne démontre nullement la mauvaise foi du déposant qu’elle se contente d’alléguer et qui ne saurait être évincée de la seule concomitance entre la signature de l’avenant le 30 novembre 2020 et le dépôt de la marque le 1er octobre 2020, même si ce dernier est de deux mois antérieur à la signature de l’avenant. Au contraire, il peut être observé qu’il n’est allégué aucunes dissensions entre les parties au moment du dépôt de la marque litigieuse, le 1er octobre 2020, qui seraient de nature à constituer le titulaire de la marque de mauvaise foi vis à vis de la société Mondamert puisqu’au contraire, les parties ont convenu dans la même période de prolonger la durée du contrat de location gérance, même si celui-ci n’a été signé que le 30 novembre 2020. Ainsi n’est-il pas établi que le titulaire n’a déposé la marque en litige sous laquelle il exploitait le parc accrobranche en location gérance que dans un but étranger au droit des marques ou pour priver la société Mondamert d’un droit sur le signe, de sorte que la décision qui a écarté le motif absolu de nullité du dépôt litigieux est confirmée. (Bordeaux, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 23/01895)
Brevet
- Saisie-contrefaçon - Déloyauté (non). La non révélation de difficultés financières rencontrées par la société demandant la saisie-contrefaçon, à supposer avérées, n’est pas suffisante à caractériser sa déloyauté, cet élément n’étant pas de nature à permettre au juge d’appréhender les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Le juge des requêtes apprécie la nécessité d’ordonner la constitution de garanties non en fonction de la solvabilité de la requérante mais du dommage éventuellement encouru par le saisi en raison de l’exécution des mesures ordonnées dans le cas où les opérations de saisies seraient annulées ou l’action en contrefaçon rejetée.
La mise en place du cercle de confidentialité telle que prévu dans l’ordonnance précitée conformément aux dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce, apparaît une mesure de protection raisonnable et suffisante à garantir la confidentialité informations saisies, et il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une constitution de garantie en préalable de la levée du séquestre provisoire, l’insolvabilité de la partie requérante, à supposer établie, étant à cet égard indifférente. (Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 oct. 2024, n° 23/12839)
- Prud’hommes - Compétence. Il résulte de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle que l’action du salarié auteur d’une invention appartenant à l’employeur, tendant au paiement d’une rémunération supplémentaire en application de l’article L. 611-7 du même code, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. (Soc. 23 oct. 2024, n° 22-19.700)
- Inventions de salariés - Rémunération supplémentaire. Le renouvellement des droits de propriété intellectuelle constitue un critère pertinent pour apprécier l’importance de l’invention pour la société qui a déposé le brevet. Les pratiques d’une entreprise en matière de rémunération constituent également un critère pertinent et en l’espèce, la société Iveco se réfère à une distinction entre d’une part les brevets de produits innovants et nouveaux susceptibles d’une demande industrielle, d’autre part les brevets de produits permettant d’améliorer l’efficacité ou l’utilisation d’un autre produit. Elle n’apporte cependant aucun élément permettant de classer les brevets visés par la demande du salarié dans l’une ou l’autre de ces deux catégories en opposant au salarié le défaut de renseignement d’une documentation technique. Or, il apparaît d’une part que cette documentation technique n’est pas exigée par la loi, d’autre part que l’employeur qui ne conteste pas avoir procédé à plusieurs demandes de renouvellements de la protection des dits brevets auprès de l’office européen des brevets, ne peut sérieusement soutenir qu’il ne serait pas en mesure de déterminer si ces inventions sont innovantes ou non. Compte tenu de ces éléments, la cour fixe la rémunération supplémentaire due par la société Iveco France à M. [X] au titre des brevets déposés et renouvelés dont il est l’inventeur, à la somme de 5 000 euros par brevet, soit en l’espèce, une somme totale de 25 000 € pour les cinq brevets sus-visés et déboute le salarié de sa demande pour le surplus. (Lyon, ch. soc. a, 9 oct. 2024, n° 22/01784)
- Compétence. La CJUE a rappelé dans l’arrêt Solvay du 12 juillet 2012 que la règle de compétence spéciale (de l’art. 6.1 du règl. n° 44/2001 du 22 déc. 2000, devenu l’article 8.1 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012) en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Cette même règle ne saurait être interprétée en vue de l’appliquer de telle sorte qu’elle permette au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié. C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de fait, dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en ’uvre dans des Etats contractants différents, ne sont pas les mêmes. D’autre part, il ne saurait être conclu à l’existence d’une même situation de droit lorsque plusieurs juridictions de différents États contractants sont saisies d’actions en contrefaçon d’un brevet européen délivré dans chacun de ces États et que ces actions sont engagées à l’encontre de défendeurs domiciliés dans ces États pour des faits prétendument commis sur leur territoire.
Un brevet européen demeure régi, tel qu’il découle clairement des articles 2, § 2, et 64, § 1 de la convention de Munich, par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré. De ce fait, toute action en contrefaçon de brevet européen doit, ainsi qu’il ressort de l’article 64, § 3, de ladite convention, être examinée au regard de la réglementation nationale en vigueur, en la matière, dans chacun des États pour lesquels il a été délivré. Afin d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d’une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l’égard des mêmes produits et, d’autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu’ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause. (Paris, pôle 5 ch. 2, 11 oct. 2024, n° 22/16203)
© Lefebvre Dalloz