Permis de construire obtenu par fraude : pas de régularisation possible par modificatif
Dans un arrêt qui sera mentionné aux tables du Lebon, le Conseil d’État réduit encore les hypothèses de survie des permis de construire obtenus par fraude, en jugeant qu’ils ne peuvent jamais être régularisés par l’obtention d’un permis modificatif.
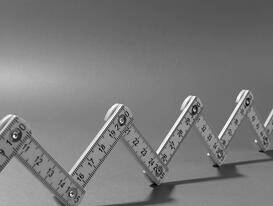
En 2022, le maire de Villennes-sur-Seine avait délivré à une société immobilière HLM un permis de construire autorisant un changement de destination et la réhabilitation d’un ensemble de bureaux, en vue d’y construire une douzaine de logements ; plusieurs voisins du projet avaient demandé du Tribunal administratif de Versailles l’annulation ce permis de construire.
Ils faisaient valoir que ce permis avaient été obtenu par fraude : selon eux, alors que la demande du pétitionnaire situait le projet sur une seule parcelle cadastrale, il ressortait du plan de masse joint à cette demande que le projet comportait également la construction de cinq places de parking sur une parcelle voisine.
En réaction, la société immobilière avait demandé et obtenu en cours d’instance un permis de construire modificatif, aux termes duquel le projet englobait désormais trois parcelles, dont celle prévue initialement pour le parking, tandis que les places de stationnement étaient déplacées sur la première parcelle.
Par la suite, le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande des requérants sans se prononcer sur l’existence d’une fraude : en effet, la juridiction avait considéré que même en estimant que le permis initial avait été obtenu par fraude, le moyen soulevé était devenu inopérant, puisqu’il ciblait un vice régularisé par un permis modificatif obtenu en cours d’instance.
Saisi d’un pourvoi formé par les requérants de première instance, le Conseil d’État, par sa décision du 18 décembre 2024, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles au motif « qu’en se fondant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que la société (…) avait présenté de manière intentionnelle des informations erronées sur le terrain d’assiette du projet dans son dossier de demande de permis de construire, de nature selon les requérants à tromper l’administration sur la réalité du projet, et de ce que le permis de construire litigieux aurait ainsi été obtenu par fraude, sur la circonstance que le dossier de permis de construire modificatif avait modifié la demande sur ce point, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ».
La situation précaire du permis de construire obtenu par fraude
La notion d’acte administratif unilatéral obtenu par fraude a été dégagée par le Conseil d’État dans un arrêt Sarovitch du 12 avril 1935 duquel il ressort qu’un tel acte n’est pas créateur de droits et peut donc être retiré à tout moment ; ce principe se retrouve aujourd’hui tel quel à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui concerne tous les actes administratifs unilatéraux et, donc, les permis de construire. Cette notion doit cependant être distinguée de celle de l’inexistence, puisque le Conseil d’État a jugé que les administrations doivent tirer toutes les conséquences légales d’un acte obtenu par fraude tant qu’il n’y a pas été mis fin (CE 29 nov. 2002, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille c/ Mme Papegneis, n° 223027, Lebon ![]() ; AJDA 2003. 276
; AJDA 2003. 276 ![]() , chron. F. Donnat et D. Casas
, chron. F. Donnat et D. Casas ![]() ; D. 2003. 667
; D. 2003. 667 ![]() ; AJFP 2003. 4
; AJFP 2003. 4 ![]() ; RFDA 2003. 234, concl. G. Bachelier
; RFDA 2003. 234, concl. G. Bachelier ![]() ; ibid. 240, note P. Delvolvé
; ibid. 240, note P. Delvolvé ![]() ; RTD civ. 2003. 268, obs. J. Hauser
; RTD civ. 2003. 268, obs. J. Hauser ![]() ).
).
En pratique, le Conseil d’État a jugé que la fraude au permis de construire est caractérisée lorsque « le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme » (CE 16 août 2018, NSHHD (Sté), n° 412663, RDI 2018. 513, obs. P. Soler-Couteaux ![]() ; AJCT 2018. 643, obs. O. Didriche
; AJCT 2018. 643, obs. O. Didriche ![]() ) ; dans la même décision, il a écarté l’application d’un éventuel délai raisonnable d’un an, rappelant que ce permis pouvait être retiré à tout moment (en l’espèce, 2 ans après sa délivrance, à la suite d’un recours gracieux).
) ; dans la même décision, il a écarté l’application d’un éventuel délai raisonnable d’un an, rappelant que ce permis pouvait être retiré à tout moment (en l’espèce, 2 ans après sa délivrance, à la suite d’un recours gracieux).
L’impossibilité totale de régularisation du permis frauduleux
Il existe plusieurs hypothèses de régularisation d’un permis de construire illégal par l’obtention d’un permis de construire modificatif, dans le but d’encourager les porteurs de projets tout en permettant un retour à la légalité des projets irréguliers.
En principe, « lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial » (CE 2 févr. 2004, Sté la Fontaine de Villiers, n° 238315).
Le juge peut avoir l’initiative d’une telle régularisation lorsque le vice qu’il repère est susceptible d’être régularisé, en prononçant une annulation partielle et en fixant un délai dans lequel le titulaire du permis litigieux pourra en demander la régularisation (C. urb., art. L. 600-5) ; il peut aussi, après avoir constaté une irrégularité, surseoir à statuer jusqu’à expiration d’un délai fixé pour laisser au titulaire le temps d’obtenir une régularisation (C. urb., art. L. 600-5-1).
Une demande de permis modificatif pour régulariser un permis illégal peut aussi intervenir sur l’initiative du titulaire de ce permis, pendant une instance ou non.
Le Conseil d’État avait déjà récemment jugé que la fraude n’est pas au nombre des vices « susceptibles d’être régularisés » au sens des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE 11 mars 2024, Dalloz actualité, 25 mars 2024, obs. A. de Dieuleveult ; Saint-Raphaël (Cne), n° 464257, Lebon ![]() ; AJDA 2024. 528
; AJDA 2024. 528 ![]() ; RDI 2024. 300, obs. P. Soler-Couteaux
; RDI 2024. 300, obs. P. Soler-Couteaux ![]() ; AJCT 2024. 384, obs. R. Bonnefont
; AJCT 2024. 384, obs. R. Bonnefont ![]() ), empêchant ainsi toute régularisation à l’initiative du juge.
), empêchant ainsi toute régularisation à l’initiative du juge.
Dans ses conclusions sous cette décision, le rapporteur public avait mis en avant le fait qu’une solution contraire aurait pu inciter les pétitionnaires à déposer des demandes de permis de construire frauduleuses, en comptant sur la possibilité d’une régularisation si l’administration ou un adversaire du projet venait à découvrir le pot-aux-roses.
La même logique semble avoir guidé la décision du 18 décembre 2024, qui formalise le principe selon lequel « lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré », par exception donc au principe posé dans la décision Société la Fontaine de Villiers.
© Lefebvre Dalloz