Précision sur la motivation de la détention provisoire
La chambre de l’instruction n’est tenue de motiver expressément, sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d’une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen, qu’à l’occasion de la décision de prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale.
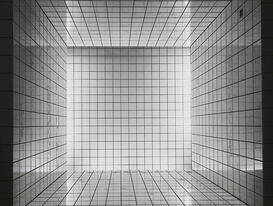
Au cours de la détention provisoire, la question d’une mise en liberté peut être évoquée à plusieurs reprises. D’abord, la détention provisoire est encadrée en termes de durée. Il résulte en effet de l’article 145-1 du code de procédure pénale qu’en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder deux ans. Exceptionnellement, la détention peut être prolongée pour de nouvelles périodes de quatre mois lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité. Dans le cas d’espèce, le demandeur au pourvoi, mis en examen des chefs de tentative d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a vu sa détention provisoire prolongée exceptionnellement au-delà de quatre années.
Ensuite, toute personne incarcérée provisoirement peut, à tout moment, demander sa mise en liberté (C. pr. pén., art. 148). Dans le cadre de l’arrêt commenté, le demandeur au pourvoi a déposé une demande de mise en liberté peu après la prolongation de sa détention provisoire, laquelle a été rejetée.
Par l’arrêt commenté, la Haute juridiction opère une distinction entre les motifs de la prolongation exceptionnelle de la détention et ceux du rejet de la demande de mise en liberté.
Critères de motivation distincts
En l’espèce, le demandeur au pourvoi a formulé une demande de mise en liberté après prolongation exceptionnelle de la détention provisoire au-delà de quatre années. Il fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté sa demande sans caractériser l’existence d’un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens.
Pour rejeter la demande de mise en liberté, les juges se sont fondés sur le fait que la détention provisoire a fait l’objet d’une prolongation exceptionnelle, à l’occasion de laquelle la chambre de l’instruction a jugé que la mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité. Ils ont ajouté que l’information est en voie d’achèvement et que la détention provisoire, qui n’excède pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité des investigations, demeure justifiée pour éviter une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l’importance des préjudices causés, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique, y compris mobile.
La Haute juridiction a rejeté le pourvoi et considéré que la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les dispositions du code de procédure pénale. Les juges ont retenu que l’article 145-2, alinéa 3, dudit code n’oblige la chambre de l’instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d’une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu’à l’occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale. Ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas à renouveler cette motivation particulière quand elle statue sur les demandes de mise en liberté formées par la personne mise en examen postérieurement à cette décision de prolongation exceptionnelle, sauf à être saisie d’un moyen en ce sens.
La Cour de cassation opère ainsi une distinction entre la motivation de la prolongation exceptionnelle de la détention et celle du rejet de la demande de mise en liberté.
Un positionnement conforme à la législation
La position de la Haute juridiction correspond à une lecture littérale des dispositions du code de procédure pénale.
Ce code dispose, en son article 145-2, alinéa 3, que lorsqu’elle se prononce sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l’instruction statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Concernant la demande de mise en liberté, le magistrat doit évoquer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 148).
Le positionnement de la Cour de cassation se justifie pleinement. Dès lors que la détention provisoire excède la durée maximale, il est tout à fait essentiel de s’assurer que son maintien est justifié par des considérations particulières.
La difficulté de l’affaire d’espèce tient en le fait que la demande de mise en liberté est intervenue après la prolongation exceptionnelle. Ainsi, les juges de cassation ont eu à déterminer si la demande de mise en liberté formulée pendant la période de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire doit être appréhendée au regard des critères justifiant cette prolongation exceptionnelle. La réponse est négative : quel que soit le moment de la demande de mise en liberté, elle doit être appréciée en considération des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale.
Juridiquement cette portée se justifie dans la mesure où il s’agit de deux procédures distinctes, quand bien même l’une permet la seconde.
Crim. 27 mai 2025, FS-B, n° 25-81.871
par Fanny Charlent, Docteur en Droit, Avocat inscrit au Barreau des Alpes de Haute-Provence
© Lefebvre Dalloz