Président décroché, répression neutralisée
Par un arrêt du 29 mars 2023, la chambre criminelle confirme que l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice d’un droit conventionnellement garanti.
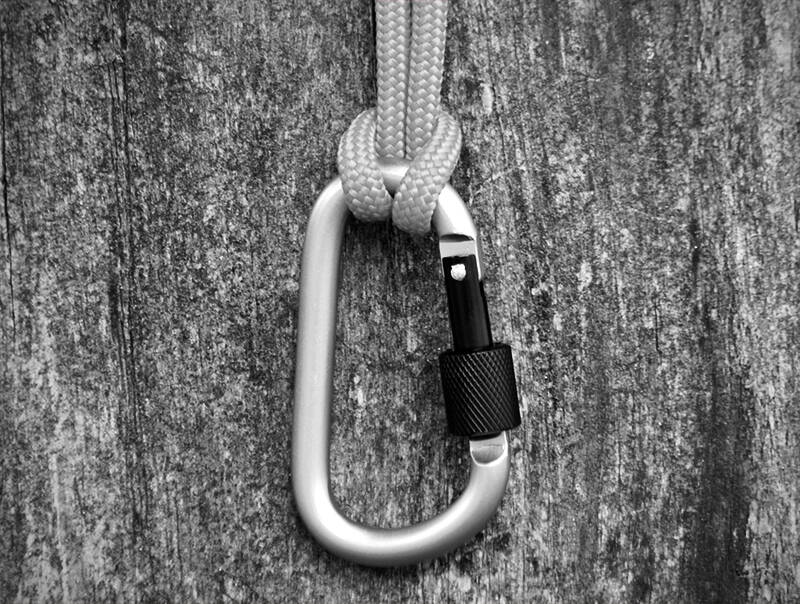
Les « décrocheurs » de portraits présidentiels n’ont décidément pas fini de faire parler d’eux. Les faits sont désormais bien connus, et s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Décrochons Macron ! » initiée par le mouvement ANV COP21 en vue de protester contre ce que ses membres qualifient d’inaction gouvernementale face au dérèglement climatique. Le 28 mai 2019, huit militants, vêtus de tee-shirts frappés du logo du mouvement, pénètrent dans les locaux de quatre mairies girondines aux heures d’ouverture au public, se dirigent vers les salles de mariage et s’emparent du portrait officiel du président de la République. Celui-ci est remplacé par une affiche sur laquelle figure la silhouette du président, accompagnée du message « Urgence sociale et climatique – Où est Macron ? ».
Poursuivis des chefs de vol en réunion et, pour certains, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et refus de se soumettre à un prélèvement biologique, les huit « décrocheurs » sont condamnés le 6 décembre 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux. La condamnation, confirmée par la cour d’appel bordelaise le 16 septembre 2020, est censurée par la chambre criminelle de la Cour de cassation par un premier arrêt du 22 septembre 2021 (n° 20-85.434, Dalloz actualité, 8 oct. 2021, obs. M. Recotillet ; AJ pénal 2021. 533 ![]() ; Légipresse 2021. 462 et les obs.
; Légipresse 2021. 462 et les obs. ![]() ; ibid. 600, étude C. Bigot
; ibid. 600, étude C. Bigot ![]() ; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier
; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ![]() ; RSC 2021. 823, obs. X. Pin
; RSC 2021. 823, obs. X. Pin ![]() ; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna
; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna ![]() ). Sur renvoi, la cour d’appel de Toulouse relaxe l’ensemble des prévenus des chefs susvisés le 27 avril 2022, et la Cour de cassation, par un second arrêt du 29 mars 2023, rejette le pourvoi formé par le ministère public.
). Sur renvoi, la cour d’appel de Toulouse relaxe l’ensemble des prévenus des chefs susvisés le 27 avril 2022, et la Cour de cassation, par un second arrêt du 29 mars 2023, rejette le pourvoi formé par le ministère public.
L’affaire trouve son épilogue dans le contrôle de proportionnalité opéré par les juges toulousains sur le fondement des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme. Les deux moyens critiquaient l’arrêt de la cour d’appel de renvoi ayant jugé que la sanction des comportements visés à la prévention constituait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression (Conv., art. 10) s’agissant du vol en réunion ; et au droit au respect de la vie privée (Conv., art. 8) s’agissant des refus de se soumettre aux opérations de prélèvement biologique et de relevés signalétiques.
La neutralisation d’une ingérence dans la liberté d’expression
Voilà maintenant quelques années que la liberté d’expression est régulièrement invoquée par des prévenus devant les tribunaux afin de légitimer – avec un succès variable – les actions pour lesquelles ils sont poursuivis. Ce moyen de défense, qui n’a rien d’inhabituel s’agissant d’infractions « expressives par nature » (dont l’élément matériel se traduit par l’écrit ou la parole), a désormais le vent en poupe s’agissant d’infractions « expressives par destination » qui, a priori étrangères à l’expression, sont commises dans un contexte traduisant l’intention de véhiculer un message (sur cette distinction, v. X. Pin, RSC 2022. 817 ![]() ). Est ainsi neutralisée, sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH, la répression de l’escroquerie commise par une journaliste ayant infiltré un mouvement politique pour réaliser une enquête sur son fonctionnement (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-83.774, D. 2016. 2216
). Est ainsi neutralisée, sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH, la répression de l’escroquerie commise par une journaliste ayant infiltré un mouvement politique pour réaliser une enquête sur son fonctionnement (Crim. 26 oct. 2016, n° 15-83.774, D. 2016. 2216 ![]() ; AJ pénal 2017. 38, obs. N. Verly
; AJ pénal 2017. 38, obs. N. Verly ![]() ; Légipresse 2017. 67 et les obs.
; Légipresse 2017. 67 et les obs. ![]() ; ibid. 92, Étude H. Leclerc
; ibid. 92, Étude H. Leclerc ![]() ; RSC 2016. 767, obs. H. Matsopoulou
; RSC 2016. 767, obs. H. Matsopoulou ![]() ) ; ou celle de l’exhibition sexuelle commise par une militante féministe ayant exposé sa poitrine nue dans un musée (Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.827, D. 2020. 438
) ; ou celle de l’exhibition sexuelle commise par une militante féministe ayant exposé sa poitrine nue dans un musée (Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.827, D. 2020. 438 ![]() ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ![]() ; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE
; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE ![]() ; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry
; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry ![]() ; Légipresse 2020. 148 et les obs.
; Légipresse 2020. 148 et les obs. ![]() ; ibid. 233, étude L. François
; ibid. 233, étude L. François ![]() ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy
; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ![]() ; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud
; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud ![]() ; ibid. 909, obs. X. Pin
; ibid. 909, obs. X. Pin ![]() ).
).
Dans l’espèce commentée, la cour d’appel de Bordeaux avait pourtant affirmé que la liberté d’expression « ne peut jamais justifier la commission d’un délit pénal ». Ce raisonnement fut censuré par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2021, la Haute juridiction estimant qu’il appartenait aux juges de rechercher, comme il le leur avait été demandé par les prévenus, si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression. Appliquant cette consigne, la cour d’appel de renvoi a conclu à la relaxe des prévenus.
Pour rejeter le pourvoi formé par le parquet toulousain, la chambre criminelle a d’abord rappelé les modalités du contrôle de proportionnalité exigé, avant d’observer qu’elles ont été respectées en l’espèce. Dans un premier temps, en présence d’une atteinte alléguée par le prévenu à sa liberté d’expression, il appartient au juge de s’assurer du lien direct entre le comportement et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général. En l’occurrence, les juges du fond ont justement considéré que les changements climatiques constituent un tel sujet, et caractérisé le lien entre celui-ci et les faits poursuivis (portraits soustraits par des personnes identifiables par leurs vêtements comme membres de l’ANV COP21, et remplacés par une affiche porteuse d’un message politique). Dans un second temps, il appartient au juge de vérifier le caractère proportionné de la condamnation, en prenant en compte, « concrètement » et « entre autres éléments », les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé ; étant précisé qu’en matière de vol, les critères pertinents pourront tenir à la valeur matérielle du bien, son éventuelle valeur symbolique, et la réversibilité ou l’irréversibilité du dommage causé à la victime. En l’espèce, les juges toulousains ont constaté que les faits ont été commis à visage découvert et de façon non violente par des auteurs dénués d’intérêt personnel ou financier, sur un bien de très faible valeur marchande (8,90 € par portrait). Ils en ont déduit que l’action « n’apparaît pas avoir porté atteinte à la dignité de la fonction ou à celle de la personne humaine ».
Les « décrocheurs » girondins pourraient sembler mieux lotis que certains de leurs confrères. On se rappelle, en effet, que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par trois arrêts du 18 mai 2022 consacrant les critères susvisés, a jugé que la condamnation pour vol en réunion d’autres prévenus poursuivis pour des faits similaires ne constituait pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de leur liberté d’expression (nos 21-86.685, 20-87.272 et 21-86.647, D. 2022. 1186 ![]() , note S. Pellé
, note S. Pellé ![]() ; AJ pénal 2022. 374, obs. J.-B. Thierry
; AJ pénal 2022. 374, obs. J.-B. Thierry ![]() ; AJCT 2022. 593, obs. S. Lavric
; AJCT 2022. 593, obs. S. Lavric ![]() ; Légipresse 2022. 340 et les obs.
; Légipresse 2022. 340 et les obs. ![]() ; ibid. 487, étude R. Le Gunehec et A. Pastor
; ibid. 487, étude R. Le Gunehec et A. Pastor ![]() ; ibid. 2023. 119, étude E. Tordjman, O. Lévy et S. Menzer
; ibid. 2023. 119, étude E. Tordjman, O. Lévy et S. Menzer ![]() ; RSC 2022. 817, obs. X. Pin
; RSC 2022. 817, obs. X. Pin ![]() ). Avaient été soulignés la valeur symbolique des portraits présidentiels, le refus des prévenus de les restituer à défaut de satisfaction de leurs revendications, et la circonstance que les vols avaient été commis en réunion. La comparaison de ces arrêts avec celui du 29 mars 2023 a quelque chose de déconcertant. La valeur symbolique du bien – dont on peut douter de la pertinence pour apprécier l’opportunité de punir une action militante (v. F. Rousseau, JCP 2022. 879) était ici la même ; la restitution des portraits n’a pas davantage eu lieu si l’on en croit les conclusions de l’avocat général en l’espèce (p. 6 – peut-être a-t-elle seulement tardé, puisque le prononcé des peines avait été ajourné à cette fin ?) ; et les faits ont également été commis en réunion.
). Avaient été soulignés la valeur symbolique des portraits présidentiels, le refus des prévenus de les restituer à défaut de satisfaction de leurs revendications, et la circonstance que les vols avaient été commis en réunion. La comparaison de ces arrêts avec celui du 29 mars 2023 a quelque chose de déconcertant. La valeur symbolique du bien – dont on peut douter de la pertinence pour apprécier l’opportunité de punir une action militante (v. F. Rousseau, JCP 2022. 879) était ici la même ; la restitution des portraits n’a pas davantage eu lieu si l’on en croit les conclusions de l’avocat général en l’espèce (p. 6 – peut-être a-t-elle seulement tardé, puisque le prononcé des peines avait été ajourné à cette fin ?) ; et les faits ont également été commis en réunion.
Toujours est-il que cet arrêt vient nourrir une discussion doctrinale passionnante sur la nature de la neutralisation de la répression opérée par la chambre criminelle depuis quelques années au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si l’on a d’abord pu y voir une nouvelle cause de justification de l’infraction, il semblerait qu’elle s’apparente plutôt à une exception d’inconventionnalité venant faire ponctuellement échec au droit interne lorsque celui-ci aboutit à une sanction contraire aux engagements internationaux de la France au regard des circonstances (Dr. pénal 2022. Étude 8, obs. P. Rousseau ; X. Pin, art. préc. ; E. D. 2023. 124, obs. E. Dreyer ![]() ).
).
La neutralisation d’une ingérence dans le respect de la vie privée
L’arrêt du 29 mars 2023 fait droit à une seconde exception d’inconventionnalité, cette fois-ci soulevée au visa de l’article 8 de la Convention européenne. Le second moyen critiquait la relaxe de quatre prévenus des chefs de refus de se soumettre à un prélèvement biologique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, au sens des articles 706-56 et 55-1 du code de procédure pénale.
En ce qu’elles visent à contraindre une personne soupçonnée de crimes ou de délits à se livrer à des prélèvements nécessaires à l’enquête, consistant dans le recueil de données identifiantes susceptibles d’être mémorisées dans des fichiers, ces deux infractions constituent incontestablement une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (CEDH 22 juin 2017, n° 8806/12, Aycaguer c/ France, § 33, Dalloz actualité, 27 juin 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2017. 1311 ![]() ; ibid. 1768, chron. L. Burgorgue-Larsen
; ibid. 1768, chron. L. Burgorgue-Larsen ![]() ; D. 2017. 1363, et les obs.
; D. 2017. 1363, et les obs. ![]() ; AJ pénal 2017. 391, note V. Gautron
; AJ pénal 2017. 391, note V. Gautron ![]() ; 18 avr. 2013, n° 19522/09, M. K. c/ France, § 29, Dalloz actualité, 14 mai 2013, obs. M. Léna ; D. 2013. 1067, et les obs.
; 18 avr. 2013, n° 19522/09, M. K. c/ France, § 29, Dalloz actualité, 14 mai 2013, obs. M. Léna ; D. 2013. 1067, et les obs. ![]() ; ibid. 2014. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 2014. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; RSC 2013. 666, obs. D. Roets
; RSC 2013. 666, obs. D. Roets ![]() ). Toutefois, comme l’affirme la chambre criminelle en l’espèce, telle ingérence n’est pas, en elle-même, disproportionnée à l’objectif poursuivi. Ceci résulte notamment, concernant les prélèvements biologiques, de ce que l’intéressé n’ayant pas été condamné peut en solliciter l’effacement et dispose d’un recours juridictionnel effectif en cas de refus du procureur ; et, s’agissant du prélèvement d’empreintes digitales, de ce que la conservation des empreintes est limitée dans le temps et que leur effacement est prévu en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement (Crim. 28 oct. 2020, n° 19-85.812, Dalloz actualité, 16 nov. 2020, obs. F. Engel ; D. 2020. 2122
). Toutefois, comme l’affirme la chambre criminelle en l’espèce, telle ingérence n’est pas, en elle-même, disproportionnée à l’objectif poursuivi. Ceci résulte notamment, concernant les prélèvements biologiques, de ce que l’intéressé n’ayant pas été condamné peut en solliciter l’effacement et dispose d’un recours juridictionnel effectif en cas de refus du procureur ; et, s’agissant du prélèvement d’empreintes digitales, de ce que la conservation des empreintes est limitée dans le temps et que leur effacement est prévu en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement (Crim. 28 oct. 2020, n° 19-85.812, Dalloz actualité, 16 nov. 2020, obs. F. Engel ; D. 2020. 2122 ![]() ; ibid. 2021. 762, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat
; ibid. 2021. 762, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ![]() ; AJ pénal 2021. 35, obs. C. Liévaux
; AJ pénal 2021. 35, obs. C. Liévaux ![]() ).
).
Néanmoins, la Haute juridiction a déjà jugé, dans une espèce mettant en cause d’autres « décrocheurs », que la conformité de ces dispositions avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas au juge d’en écarter l’application s’il retient, dans le cadre de l’exercice de son contrôle de proportionnalité, une disproportion entre les faits reprochés et l’atteinte au respect de la vie privée des prévenus (Crim. 22 sept. 2021, n° 20-80.489, Dalloz actualité, 8 oct. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 1720, et les obs. ![]() ; AJ pénal 2021. 533, obs. G. Chetard
; AJ pénal 2021. 533, obs. G. Chetard ![]() ; RSC 2021. 823, obs. X. Pin
; RSC 2021. 823, obs. X. Pin ![]() ; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna
; ibid. 2022. 445, obs. E. Rubi-Cavagna ![]() ; v. égal. Crim. 3 sept. 2021, n° 19-86.847). En l’espèce, la Cour observe que les juges du fond, pour entrer en voie de relaxe, ont correctement relevé la faible gravité des faits commis, à l’occasion d’une action politique et militante dans le but d’alerter sur un sujet d’intérêt général.
; v. égal. Crim. 3 sept. 2021, n° 19-86.847). En l’espèce, la Cour observe que les juges du fond, pour entrer en voie de relaxe, ont correctement relevé la faible gravité des faits commis, à l’occasion d’une action politique et militante dans le but d’alerter sur un sujet d’intérêt général.
© Lefebvre Dalloz