Prestation de serment de l’interprète, statut de suspect et infractions non-intentionnelles : précisions de la chambre criminelle
N’encourt pas nécessairement l’annulation l’arrêt qui ne mentionne pas que l’interprète a prêté serment ou est assermenté. Par ailleurs, doit être entendue comme simple témoin une personne à l’encontre de laquelle il n’existe pas de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une faute pénale. Enfin, doit être considérée comme étant « particulière » l’obligation de sécurité qui est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable.
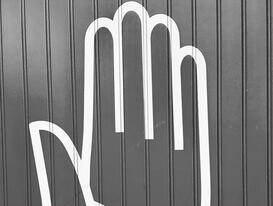
Dans un arrêt du 22 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte plusieurs précisions d’ordre procédural concernant les droits de la défense, d’une part, et la notion « d’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » dans le cadre de la caractérisation d’une infraction involontaire d’atteinte aux personnes (blessures ou homicide involontaire), d’autre part.
Deux moyens d’ordre procédural touchant aux droits de la défense étaient en effet soulevés. Le premier reprochait à l’arrêt attaqué de ne pas faire mention du fait que l’interprète, qui apporta son concours au prévenu lors de l’audience, avait prêté serment ou était assermenté, ce qui était selon les auteurs du pourvoi susceptible de porter atteinte aux droits du prévenu. Le second portait sur la coordination des statuts de simple témoin et de suspect dans le cadre d’une enquête de flagrance, la personne finalement condamnée ayant d’abord été auditionnée en tant que simple témoin, puis considérée comme suspecte et entendue sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue.
Le pourvoi arguait également que l’obligation prévue par la loi ou le règlement dont la violation avait été retenue n’était pas suffisamment précise, « particulière », pour permettre l’engagement de la responsabilité pénale d’une personne physique pour une infraction non-intentionnelle.
La Cour de cassation rejette l’ensemble de ces moyens et confirme la décision entreprise.
L’absence de mention dans la décision du fait que l’interprète a prêté serment ou était assermenté n’est pas nécessairement une cause de nullité
La chambre criminelle commence sa décision par un revirement de jurisprudence. Elle juge en effet qu’il n’est pas nécessaire que l’arrêt mentionne que l’interprète présent lors de l’audience ait prêté serment ou qu’il ait été assermenté, à partir du moment où la Cour de cassation est en mesure de vérifier que celui-ci est bien inscrit sur les listes des experts assermentés.
Pour mémoire, l’article 407 du code de procédure pénale prévoit que, si nécessaire, « le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience » (al. 1er). Le serment de l’interprète permet de garantir, notamment, son indépendance et son impartialité, alors qu’il joue un rôle primordial dans le déroulement du procès pénal et que les parties doivent pouvoir lui faire une confiance absolue. Il est la condition nécessaire à l’exercice des droits de la défense, et concourt plus généralement à la bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, la jurisprudence estimait jusqu’à maintenant que le texte de la décision devait mentionner que l’interprète avait prêté serment en début d’audience, ou qu’il était déjà assermenté, ce qui le dispensait de prêter serment à nouveau devant la juridiction (Crim. 28 mars 1991, n° 90-83.227). À défaut d’une telle mention, la décision rendue encourait l’annulation, et ce même si l’interprète était par ailleurs inscrit sur une liste d’interprètes assermentés (Crim. 12 janv. 2000, n° 99-83.399).
Or, l’arrêt commenté relève que le nom de l’interprète figurait dans le texte de la décision, et qu’il était dès lors possible de vérifier que celui-ci était nécessairement assermenté puisqu’inscrit à titre probatoire sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Amiens. L’arrêt n’encourt donc pas l’annulation, même en l’absence de mention selon laquelle l’interprète était assermenté.
La Cour de cassation adopte ainsi une position plus souple : l’absence de mention explicite du statut d’assermenté de l’interprète n’entraîne plus automatiquement l’annulation de l’arrêt. Il faut toutefois que les informations présentes dans le texte de la décision permettent de vérifier que l’interprète était assermenté, à défaut de quoi la décision devrait toujours encourir l’annulation.
La coordination entre les statuts de simple témoin et de suspect dans le cadre d’une enquête de flagrance
Dans le cadre d’une enquête de police, les personnes sont entendues selon des régimes distincts suivant qu’elles sont considérées comme étant de simples témoins des faits (C. pr. pén., art. 62), comme des personnes soupçonnées entendues librement (C. pr. pén., art. 61-1 s.) ou comme des personnes soupçonnées entendues dans le cadre d’une garde à vue (C. pr. pén., art. 62-2 s.). À chaque statut correspond des droits différents, le niveau de protection étant plus important à mesure que le niveau de contrainte augmente.
Être entendu en tant que suspect sous le régime de l’audition libre permet notamment de connaître la qualification, la date et le lieu présumés des faits ou d’être assisté d’un avocat si l’infraction reprochée est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. A contrario, la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt très récent que le simple témoin n’avait pas le droit d’être assisté d’un avocat (Crim. 23 mai 2024, n° 23-85.888, Dalloz actualité, 3 juin 2024, obs. M. Slimani ; D. 2024. 1020 ![]() ), ce qui avait déjà été jugé concernant le témoin entendu par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire (Crim. 4 oct. 2023, n° 23-81.287, Dalloz actualité, 11 oct. 2023, obs. T. Scherer ; D. 2023. 1750
), ce qui avait déjà été jugé concernant le témoin entendu par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire (Crim. 4 oct. 2023, n° 23-81.287, Dalloz actualité, 11 oct. 2023, obs. T. Scherer ; D. 2023. 1750 ![]() ; AJ pénal 2023. 513, obs. J. Chapelle
; AJ pénal 2023. 513, obs. J. Chapelle ![]() ; RSC 2023. 828, obs. J.-P. Valat
; RSC 2023. 828, obs. J.-P. Valat ![]() ).
).
Il est donc primordial de savoir à partir de quel moment une personne devient suspecte aux yeux des enquêteurs et doit donc se voir notifier ses droits. Le pourvoi reprochait en effet à l’arrêt attaqué d’avoir refusé d’annuler des auditions d’une personne entendue en tant que simple témoin, alors qu’elle aurait dû être entendue en tant que suspect. En effet, l’article 61-1 du code de procédure pénale dispose qu’une personne doit être entendue sous ce régime dès lors qu’il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Le changement de statut doit intervenir dès que l’existence de soupçons est avérée, y compris quand ceux-ci apparaissent au cours de l’audition du témoin (C. pr. pén., art. 62, al. 3), étant entendu que l’audition d’une personne en tant que simple témoin est régulière pendant la vérification de la réalité des indices permettant de la considérer comme suspect (Crim. 19 févr. 1997, n° 95-84.446, D. 1997. 118 ![]() ).
).
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation précise que « les raisons plausibles de soupçonner » doivent concerner les faits matériels pouvant être imputés à la personne concernée, faits susceptibles de caractériser une faute pénale. En l’occurrence, n’étaient pas suffisantes les simples circonstances que la personne était responsable légal de la société employant la victime et conducteur d’un engin en cause dans l’accident, ce qui ne pouvait pas laisser présumer qu’elle avait commis une faute pénale.
Blessures et homicide involontaires : précisions sur la nature de l’obligation particulière de prudence et de sécurité
Dans la présente affaire, le prévenu a été déclaré coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (C. pén., art. 121-3, al. 3 et 4, et 222-19). Rappelons qu’en matière d’infractions non-intentionnelles, la responsabilité pénale d’une personne physique est plus ou moins facile à engager suivant que sa faute a causé de manière directe ou indirecte le dommage. Dans le premier cas, une simple faute d’imprudence ou de négligence suffit à engager la responsabilité pénale. Dans le second, il est nécessaire de prouver une faute délibérée ou caractérisée.
Cette distinction fondée sur le lien de causalité, introduite par la loi Fauchon du 10 juillet 2000 dans le but principal de protéger les décideurs publics particulièrement exposés pénalement de par leurs fonctions, est en pratique difficile à suivre. La jurisprudence se montre en effet particulièrement confuse dans l’appréciation du caractère direct ou indirect de la causalité entre la faute et le dommage, alors même que cela conditionne la recherche d’une faute qualifiée plutôt qu’une faute simple, et en dépit des principes de précision et d’interprétation stricte de la loi pénale (des craintes avaient d’ailleurs été exprimées à ce sujet dès les débats parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi Fauchon en 2000, v. P. Fauchon, Rapport de la commission des lois, Sénat, Session ordinaire de 1999-2000 ; v. égal., en ce sens, J.-Cl. Pénal Code, Art. 121-3, fasc. 20, v° Élément moral de l’infraction, par J.-Y. Maréchal, n° 84).
En l’espèce, le pourvoi posait notamment la question de savoir si une loi ou un règlement prescrivant uniquement un objectif général de sécurité, sans préciser quelles mesures devaient concrètement être mises en place pour l’atteindre, pouvait être considéré comme une « obligation particulière de prudence et de sécurité » dont la violation pourrait être considérée comme une faute caractérisée.
En réponse, la Cour de cassation confirme que des obligations de sécurité sont particulières à partir du moment où elles sont « objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables, sans faculté d’appréciation personnelle » de la personne en cause (§ 28), ce qui était le cas des obligations posées par les articles R. 4323-34 et R. 4323-47 du code du travail qui avaient été méconnues.
Crim. 22 mai 2024, F-B, n° 23-82.621
© Lefebvre Dalloz