Projet de directive ô¨ Green claims ô£ et lutte contre l'ûˋcoblanchiment
Le 22 mars 2023, la Commission europûˋenne a prûˋsentûˋ un projet de directive sur les allûˋgations environnementales et les ûˋcolabels. Celle-ci vise û introduire des obligations exigeantes de justification des allûˋgations environnementales afin de mieux orienter les consommateurs.
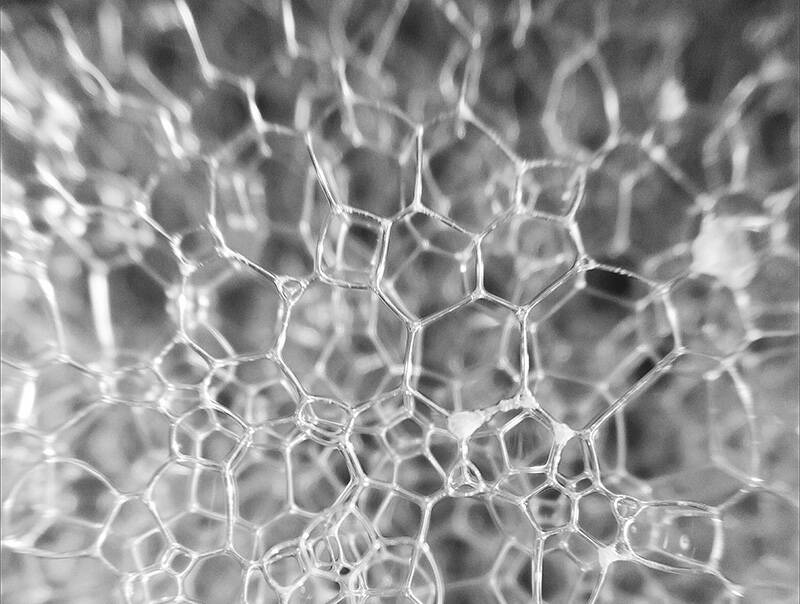
Dans le cadre du Pacte vert européen (communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le Green Deal européen, COM/2019/640 final), la Commission a présenté le 22 mars dernier une proposition de directive sur les allégations vertes, qui complète d’autres propositions de législation (v. not. proposition de dir. du Parlement européen et du Conseil modifiant les dir. 2005/29/CE et 2011/83/UE en ce qui concerne la responsabilisation des consommateurs en matière de transition écologique par une meilleure protection contre les pratiques déloyales et une meilleure information, COM(2022) 143 final). Elle vise à lutter contre la prolifération de déclarations trompeuses liées à la durabilité environnementale des produits et services. Son objectif affiché est de donner aux consommateurs « une plus grande assurance qu’un produit vendu comme étant écologique l’est réellement et […] une information de meilleure qualité pour choisir des produits et services respectueux de l’environnement » (Commission européenne, Protection des consommateurs : permettre des choix durables et mettre fin à l’écoblanchiment, communiqué de presse, 22 mars 2023). L’enjeu est également d’encourager les entreprises à verdir leur offre, sans que celles-ci en soient pénalisées dans la mesure où la transition écologique est source de surcoûts : la Commission espère ainsi que les entreprises « qui font de réels efforts pour améliorer la durabilité environnementale de leurs produits seront plus facilement reconnues et récompensées par les consommateurs et pourront stimuler leurs ventes, au lieu de faire face à une concurrence déloyale » (ibid.).
La proposition de directive s’inscrit ainsi dans la volonté de la Commission de donner aux consommateurs les moyens de faire des « choix plus éclairés » et de jouer un « rôle actif » dans la transition écologique : autrement dit, d’en faire des « consom’acteurs » (v. par ex. G. Jazottes, Faire du consommateur un acteur du développement durable, RLDA 2010/09, p. 81, n° 52). Elle contribuera, aux côtés de nombreux autres textes européens encadrant la fourniture d’informations environnementales – à l’instar des étiquettes énergies apposées sur certains biens de consommation (règl. (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE) –, à renforcer la fonction pédagogique du contrat qui est de plus en plus mis au service de la transition écologique (sur l’essor de la fonction pédagogique du contrat, v. A. Stevignon, Le climat et le droit des obligations, LGDJ, 2022, p. 302, n° 367 ; v. aussi l’article précurseur de M. Hautereau-Boutonnet, De l’obligation d’information “sur l’environnement” à l’obligation d’information “pour l’environnement”, entre intérêt des parties et intérêt général, RDC 2012, n° 3, p. 908 à 926).
Le constat d’un « greenwashing » ambiant
Une étude réalisée par la Commission en 2020 sur 150 allégations environnementales du type « neutre en carbone », « zéro carbone » « issue de matériaux recyclés » a révélé que 53,3 % d’entre elles étaient vagues, trompeuses ou infondées concernant les caractéristiques environnementales des produits et que 40 % d’entre elles n’étaient pas du tout étayées.
L’étude a également recensé plus de 230 labels environnementaux sur le marché européen, qu’ils soient publics ou privés, et constaté que la moitié d’entre eux étaient accordés sans que les vérifications adéquates soient effectuées.
Le greenwashing apparaît si endémique que l’exposition au risque redouté du « name and shame » apparaît très relatif. Dans ce contexte, le projet de directive a pour ambition d’encadrer strictement ces deux types d’allégations environnementales.
À cet égard, le champ d’application du projet de directive est large quoique résiduel. En effet, la future directive devrait s’appliquer aux « allégations environnementales explicites », entendues comme les allégations environnementales présentées sous forme de texte ou contenues dans un label environnemental (art. 2, 2), qui ne sont pas régis par un autre texte de l’Union en ce qui concerne leur justification, leur communication ou leur vérification (art. 1, 2°), à l’instar du label écologique de l’Union européenne (règl. (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2009 établissant le label écologique de l’UE) ou du label des denrées alimentaires biologiques (règl. (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques).
Un encadrement strict des allégations environnementales
Les articles 3 et suivants fixent des exigences minimales exigeantes relatives à la justification des allégations environnementales explicites.
Selon l’article 3, les professionnels à l’origine d’allégations environnementales seront d’abord tenus de procéder à une évaluation qui devra notamment :
- préciser si l’allégation porte sur l’ensemble du produit, une partie du produit ou certains aspects du produit, ou sur l’ensemble des activités d’un professionnel ou sur une partie ou un aspect de ces activités ;
- s’appuyer sur des preuves scientifiques largement reconnues, utiliser des informations exactes et tenir compte des normes internationales pertinentes ;
- démontrer que les impacts environnementaux, les aspects environnementaux ou les performances environnementales qui font l’objet de l’allégation sont significatifs au regard du cycle de vie du produit ;
- en cas d’allégation sur les performances environnementales, prendre en compte tous les aspects ou impacts environnementaux significatifs pour l’évaluation des performances environnementales ;
- démontrer que l’allégation n’est pas équivalente aux exigences imposées par la loi ;
- démontrer que les effets positifs sur l’environnement allégués sont significativement meilleurs que ceux résultant des pratiques habituellement observées ;
- démontrer que les effets positifs allégués ne conduisent pas à d’autres impacts environnementaux.
Quant au contenu des informations relatives à l’allégation environnementale devant être fournies, il est précisément encadré par l’article 5. En particulier, les professionnels seront tenus de communiquer les études ou calculs sous-jacents utilisés pour évaluer, mesurer et contrôler les incidences sur l’environnement ou la performance environnementale allégués, sans tronquer les résultats de ces études ou calculs et les explications relatives à leur portée, leurs hypothèses et leurs limites, à moins que ces informations ne constituent un secret commercial.
Les informations en question devront être mises à disposition dans un formulaire papier ou sous la forme d’un lien internet pour d’un QR code ou équivalent, permettant aux consommateurs de disposer facilement de toutes les données en amont de leur achat (art. 5). Ces informations devront également être vérifiées de manière indépendante (art. 10 et 11).
Les allégations climatiques spécifiquement ciblées
Parmi les allégations environnementales, sont particulièrement visées par la Commission les allégations climatiques selon lesquelles les produits ou les entités sont « neutres pour le climat », « neutres en carbone », « compensés à 100 % », ou qu’ils seront « nets zéro » dans un certain horizon de temps. Comme le relève la Commission, « il a été démontré que les allégations climatiques sont particulièrement susceptibles de manquer de clarté et d’ambiguïté et d’induire les consommateurs en erreur » (consid. 21, traduction libre). En effet, ces déclarations sont souvent fondées sur la « compensation » des émissions de gaz à effet de serre par des « crédits carbone » générés en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple dans le cadre de projets forestiers ou d’énergie renouvelable. Les méthodologies qui sous-tendent les compensations varient considérablement et ne sont pas toujours transparentes, précises ou cohérentes. Il en résulte des risques importants de surestimation et de double comptage des émissions évitées ou réduites, qui sont dénoncées depuis longtemps (v. not. à l’échelle de l’entreprise).
Désormais, la justification des allégations liées au climat doit prendre en compte toutes les compensations d’émissions de gaz à effet de serre qui sont recherchées séparément des émissions de gaz à effet de serre du produit ou de l’entité (art. 3, 1, h). En outre, les informations communiquées devraient également préciser la part des émissions totales qui sont compensées, si ces compensations se rapportent à des réductions d’émissions ou à des absorptions d’émissions (art. 5, 6, f). Les déclarations relatives au climat qui incluent l’utilisation de compensations doivent être étayées par des méthodologies qui garantissent l’intégrité et la comptabilisation correcte de ces compensations et reflètent ainsi de manière cohérente et transparente l’impact sur le climat qui en résulte (consid. 21).
La proposition de directive précise également que, lorsque l’allégation communiquée concerne les performances environnementales futures, elle doit en priorité se fonder sur les améliorations apportées dans le cadre des activités et de la chaîne de valeur de l’entreprise à l’origine de l’allégation plutôt que sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si la proposition de directive ne prohibe pas les allégations de « neutralité carbone » pourtant très critiquées, elle tend à encourager les réductions effectives des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit, le recours à la compensation étant conçu comme subsidiaire, ce qui apparaît opportun.
En définitive, quoique les informations à fournir apparaissent complexes (la proposition de directive prévoit cependant que les professionnels visés devront communiquer « un résumé de l’évaluation comprenant les éléments énumérés dans le présent paragraphe, qui est clair et compréhensible pour les consommateurs visés par l’allégation » (art. 5, 6 g, traduction libre), l’ensemble de ces obligations devraient toutefois permettre une réelle comparabilité des produits et inciter les professionnels à réduire effectivement les émissions directes et indirectes générées par les produits pour lesquels ils souhaitent formuler des allégations environnementales. Cet encadrement étroit pourrait également réduire les risques contentieux auxquels sont de plus en plus exposées les entreprises qui se livrent au « climate-washing ». En effet, les allégations climatiques, quoique ne portant pas sur des produits, sont à l’origine de plusieurs affaires médiatisées en France (Total Energies c. Greenpeace e.a. ; FIFA c. Notre Affaire à Tous).
Un encadrement accru des labels environnementaux
Pour mettre fin à la prolifération de labels qui jette le discrédit sur une démarche qui doit pourtant être encouragée, la proposition de directive entend n’autoriser que des labels suffisamment exigeants.
À l’avenir, les futurs labels publics devront être élaborés à l’échelle européenne et reposer sur les critères précis évoqués ci-dessus permettant de contribuer aux objectifs environnementaux européens (art. 8, 3). Par ailleurs, de nouveaux labels privés ne pourront émerger que s’ils sont plus exigeants que ceux existant (art. 8, 6). Une transparence accrue sera exigée. Les labels devront également respecter les contraintes applicables aux allégations environnementales, à savoir qu’il conviendra, pour s’en prévaloir, de prouver les bénéfices environnementaux et de recourir à des organismes tiers indépendants. Indirectement, la proposition de directive favorisera certainement l’essor du label écologique de l’Union européenne.
Les sanctions encourues
En cas de manquement aux obligations posées, les entreprises encourront des sanctions administratives et pénales. Les États membres devront désigner une autorité compétente en charge de l’application de la directive (art. 13) qui sera dotée de pouvoirs de contrôle et de sanction (art. 14). Les sanctions pécuniaires devront être proportionnées au chiffre d’affaires de l’entreprise et il sera notamment tenu compte du bénéfice économique tiré de l’infraction. Le montant maximal des amendes devrait être dissuasif et fixé au moins au niveau de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du professionnel (art. 17).
Quelle articulation avec le droit français ?
Plusieurs textes de droit français, pour certains très récents, encadrent déjà les allégations environnementales. En particulier, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2021 (L. n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 12, codifié à l’art. L. 229-68 C. envir.) a introduit un nouvel article L. 229-68 dans le code de l’environnement qui interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public un certain nombre d’éléments énumérés par la loi et précisés par décret (Décr. nos 2022-538 et 2022-539 du 13 avr. 2022, entrés en vigueur au 1er janv. 2023). Une telle interdiction est assortie de sanctions en cas de non-respect, prévues à l’article L. 229-69. Dans la mesure où les annonceurs doivent d’ores et déjà produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie, le législateur devra certainement remanier ces règles adoptées il y a peu à l’occasion de la transposition de la directive.
Quant aux sanctions encourues, les allégations environnementales trompeuses peuvent d’ores et déjà être réprimées notamment sur le fondement de l’article L. 121-2, e, du code de la consommation également introduit par la loi Climat et résilience (L. n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 10 et 11). Les sanctions encourues devront être réévaluées à l’aune de la directive définitivement adoptée, sachant que des retouches pourraient être nécessaires à l’occasion de la transposition d’une autre directive laquelle prévoit de réviser la définition des pratiques commerciales trompeuses (proposition de dir. du 30 mars 2022 modifiant les dir. 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations).
© Lefebvre Dalloz