Quel délai pour agir contre la banque en cas d’opération de paiement de non autorisée ?
Le délai de treize mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ne concernant que le signalement de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le client peut assigner sa banque en paiement dans le délai de prescription de droit commun.
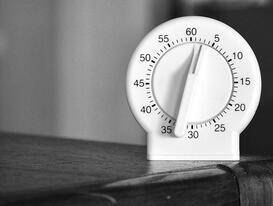
Le droit bancaire est sujet à une actualité jurisprudentielle assez dense ces derniers mois avec un nombre important d’arrêts intéressants rendus par la Cour de cassation (v. sur la fraude au président, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697 F-B et n° 24-10.168, Dalloz actualité, 17 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1116 ![]() ; sur les opérations de paiement non autorisées, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.777 F-B, Dalloz actualité, 19 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1116
; sur les opérations de paiement non autorisées, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.777 F-B, Dalloz actualité, 19 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1116 ![]() ; sur le virement au débit d’un compte d’un mineur réalisé par l’un de ses parents, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.604 FS-B, Dalloz actualité, 18 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1052
; sur le virement au débit d’un compte d’un mineur réalisé par l’un de ses parents, Com. 12 juin 2025, n° 24-13.604 FS-B, Dalloz actualité, 18 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 1052 ![]() ; sur la question des chèques non remis à l’encaissement, Com. 5 mars 2025, FS-B, n° 23-16.944, Dalloz actualité, 14 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 484
; sur la question des chèques non remis à l’encaissement, Com. 5 mars 2025, FS-B, n° 23-16.944, Dalloz actualité, 14 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 484 ![]() ). Cette fréquence des décisions rendues signe, une nouvelle fois, « l’intervention du droit bancaire dans nos activités quotidiennes » (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, p. 3, n° 4).
). Cette fréquence des décisions rendues signe, une nouvelle fois, « l’intervention du droit bancaire dans nos activités quotidiennes » (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, p. 3, n° 4).
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation lequel est promis aux honneurs d’une publication au Bulletin. La décision traite d’une problématique pratique essentielle, à savoir celle du délai que doit respecter le client qui constate une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée au sens du code monétaire et financier. Certaines juridictions du fond ont développé des interprétations divergentes qui ont appelé une harmonisation bienvenue de jurisprudence.
Les faits à l’origine du pourvoi sont classiques en la matière. Une personne physique, client d’un établissement bancaire, remarque deux virements non sollicités de sa part toutefois passés dans la nuit du 5 au 6 mars 2019, l’un pour 7 314 € et l’autre de l’ordre de 3 717 €. Le 7 mars suivant, la victime contacte sa banque pour indiquer ne pas en être à l’origine. Le client sollicite, en outre, le remboursement des sommes concernées mais l’établissement bancaire lui refuse ce bénéfice en arguant que les virements ont été autorisés grâce à ses données personnelles.
Ce n’est que le 21 décembre 2021 que l’assignation introductive du client est délivrée à la banque aux fins d’obtenir le remboursement au titre des opérations litigieuses. Se noue alors une question de recevabilité de l’action, l’établissement bancaire prétendant que le client est forclos au sens de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. Ce raisonnement est accueilli par la Cour d’appel de Douai qui juge donc irrecevables les prétentions du demandeur à l’action. Cette irrecevabilité se fonde sur le délai de treize mois de la disposition précitée dans la mesure où l’assignation a été délivrée plus de deux ans après les débits frauduleux (Douai, 21 mars 2024, n° 23/02376, disponible en libre accès sur Judilibre).
Le client considère que ce raisonnement méconnaît la lettre des dispositions applicables et se pourvoit, à juste titre, en cassation. Il estime avoir correctement signalé les opérations litigieuses dans les treize mois des deux débits concernés, ce qui ne l’empêchait pas selon lui de pouvoir engager son action dans le délai quinquennal de droit commun. Son pourvoi sera couronné de succès puisqu’il aboutit à une cassation pour violation de la loi.
L’arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’occasion d’apporter une précision fort utile quant à l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Une hésitation à nuancer
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier, d’apparence pourtant assez claire, comporte un léger flottement qui a conduit à cristalliser une hésitation devant certaines juridictions du fond. La lettre de cette disposition indique, en effet, que l’utilisateur du service doit signaler sans tarder l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Si ce signalement n’est pas réalisé immédiatement, il doit l’être dans les treize mois du débit « sous peine de forclusion ». Comme le notent certains auteurs, cette sanction est « particulièrement grave (…) le payeur (ou le bénéficiaire) se verra également interdit de toute action fondée sur le droit commun de la responsabilité en la matière » (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, op. cit., p. 770, n° 1556). Il s’agit donc, bien souvent, du nerf de la guerre dans les contentieux opposant les banques à leurs clients.
Que se passe-t-il, cependant, si l’opération est correctement signalée dans ce délai mais que l’assignation en paiement du client envers son établissement bancaire dépasse les treize mois à compter du débit ? À partir de la lettre de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, il est possible en outre de soutenir deux raisonnements très différents à ce titre :
- soit on considère que le délai de treize mois ne vaut que pour le signalement à la banque de l’opération litigieuse et non pour l’éventuelle action du client en remboursement quand son établissement lui refuse amiablement celui-ci. Cette action devrait alors être régie par le droit commun faute d’un autre texte l’enserrant dans un délai spécial. Il s’agit de la position soutenue par le moyen élevé par le demandeur à la cassation (pt n° 4).
- Soit on considère, au contraire, que le délai de treize mois régit à la fois le signalement de l’opération à la banque et l’éventuelle action au fond contre celle-ci. Cette position était celle de l’arrêt frappé du pourvoi qui avait jugé irrecevables les prétentions du client qui avait délivré l’assignation à son contradicteur le 21 décembre 2021 pour des débits de mars 2019 (Douai, 21 mars 2024, n° 23/02376, préc.).
Plusieurs arguments s’opposent à ce second raisonnement. Le plus solide réside dans la lettre de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier lui-même qui ne vient ériger qu’une forclusion liée spécifiquement au signalement. C’est, d’ailleurs, la position défendue par une partie de la doctrine bancariste derrière laquelle nous nous rangeons volontiers en raison du poids de l’argumentation littérale (J. Lasserre Capdeville et N. Kilgus, Opérations de paiement non autorisées : difficultés liées à la contestation, D. 2025. 112 ![]() , spéc. nos 13 s.). La disposition légale n’empêche, en effet, à aucun moment le client d’engager une action au fond contre son établissement bancaire au-delà de ce bornage.
, spéc. nos 13 s.). La disposition légale n’empêche, en effet, à aucun moment le client d’engager une action au fond contre son établissement bancaire au-delà de ce bornage.
Plus encore, réduire à treize mois un tel délai d’action créerait un raccourcissement drastique de la temporalité des conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées qui ne serait certainement pas compatibles avec les enjeux des directives 2007/64/CE du 13 novembre 2007 dite « DSP 1 » et (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 dite « DSP 2 ». Le considérant n° 31 du premier texte mentionne, d’ailleurs, spécifiquement la possibilité de recourir au délai de prescription de droit commun une fois le signalement correctement réalisé par le client. Autrement dit, la volonté du législateur de l’Union semble se diriger clairement vers une approche souple en la matière.
La chambre commerciale de la Cour de cassation ne s’y trompe pas et fait ainsi triompher le raisonnement le plus pertinent eu égard à l’architecture des textes.
Signalement de l’opération et assignation de la banque
L’arrêt rendu le 2 juillet 2025 précise clairement que le client avait signalé l’opération litigieuse sans attendre, « ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun » (pt n° 7, nous soulignons). On peut certainement regretter que le principe n’ait pas été posé plus explicitement au sein d’un paragraphe préliminaire qui aurait été placé après le contenu de l’article L. 133-24 du code monétaire financier (pt n° 5). Peut-être que ce choix rédactionnel a été écarté à des fins de simplification.
Quoi qu’il en soit, le code monétaire et financier implique la coexistence de deux délais différents quand un client constate une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée :
- un premier de forclusion de treize mois à partir du débit qui ne concerne que le signalement de l’opération. Celui-ci est d’ailleurs encore plus subtil car le texte prévoit bien que cette durée est un maximum dans la mesure où le client doit normalement réagir « sans délai » (J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, op. cit, p. 770, n° 1555). À partir de ce signalement, soit la banque rembourse amiablement les sommes questionnées, soit elle refuse de le faire, par exemple, en avançant une négligence grave de l’utilisateur au sens de l’article L. 133-19, IV, du même code.
- un second délai de prescription qui est, faute de texte spécial, régi par le droit commun s’agissant de l’action en paiement pour contraindre la banque à opérer le remboursement évoqué par les textes. Le client dispose donc d’une durée beaucoup plus longue pour y procéder. Par prudence, mieux vaut considérer qu’il convient également de fixer le point de départ du délai quinquennal à la date du débit même si la réponse ne s’infère pas avec la même évidence que pour la question du signalement. Un report serait théoriquement possible, par exemple à la date dudit signalement ou plus drastiquement du refus de la banque, mais celui-ci se discute très largement. L’adéquation des points de départ au seul jour du débit permet, en outre, une certaine simplicité pratique dans le suivi des dossiers pour chacun entre la forclusion de treize mois et la prescription quinquennale de cinq ans.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette dualité des délais est en tout état de cause la seule capable de respecter pleinement la lettre et l’esprit des directives DSP1 et DSP2. On ne saurait reprocher au client de l’espèce étudiée d’avoir par ailleurs tardé : les opérations non autorisées ont été passées dans la nuit du 5 au 6 mars 2019 et ces dernières avaient été signalées le lendemain, soit le 7 mars suivant. Appliquer, dans un tel cas, le bref délai de treize mois à l’action en paiement reviendrait à scléroser d’autant plus la logique à l’œuvre dans les textes de facture européenne (J. Lasserre Capdeville et N. Kilgus, Opérations de paiement non autorisées : difficultés liées à la contestation, art. préc., spéc. n° 15).
Il faut donc se réjouir d’une telle clarification même si l’article L. 133-24 interprété dans l’arrêt sous commentaire n’est pas pour autant imprécis puisqu’il n’évoque que le signalement de l’opération non autorisée ou mal exécutée comme nous l’avons examiné plus haut. Les services juridiques des banques, tout comme leurs conseils, devront en tenir compte rapidement pour éviter le déploiement au sein de leurs conclusions de moyens en irrecevabilité voués à l’échec. En amont de toute assignation, rien n’empêche toutefois les établissements bancaires de refuser légitimement un remboursement dans les cas prévus par la loi, notamment quand l’utilisateur commet une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier. La banque doit alors simplement respecter les conditions pour ce faire comme l’a rappelé utilement la chambre commerciale il y a quelques mois en réitérant une position connue depuis novembre 2020 (Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.149 F, Dalloz actualité, 13 mai 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 828 ![]() ; v. égal., en 2024, Com. 20 nov. 2024, n° 23-15.099, Dalloz actualité, 28 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2004
; v. égal., en 2024, Com. 20 nov. 2024, n° 23-15.099, Dalloz actualité, 28 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2004 ![]() ; ibid. 2025. 602, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; ibid. 2025. 602, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ![]() ; ibid. 1082, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre
; ibid. 1082, chron. C. Bellino, T. Boutié et C. Lefeuvre ![]() ; RTD com. 2025. 173, obs. D. Legeais
; RTD com. 2025. 173, obs. D. Legeais ![]() ; 12 nov. 2020, n° 19-12.112, D. 2020. 2284, et les obs.
; 12 nov. 2020, n° 19-12.112, D. 2020. 2284, et les obs. ![]() ; Dalloz IP/IT 2021. 297, obs. N. Kilgus
; Dalloz IP/IT 2021. 297, obs. N. Kilgus ![]() ; RTD com. 2021. 173, obs. D. Legeais
; RTD com. 2021. 173, obs. D. Legeais ![]() ).
).
Ce premier semestre de l’année 2025 s’achève donc par une décision importante mettant fin à une divergence de jurisprudence à propos de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. Le client dispose de treize mois pour signaler l’opération et de cinq ans pour agir contre sa banque afin de la contraindre à lui régler les sommes dues. En somme, voici un très bel arrêt de droit bancaire sous le prisme de l’argument littéral.
Com. 2 juill. 2025, F-B, n° 24-16.590
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
© Lefebvre Dalloz