Rappel de l’impossibilité de prononcer une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois
La chambre criminelle rappelle l’interdiction faite à la juridiction pénale de prononcer une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois, y compris si cette peine est prononcée conjointement à une autre et si elle se cumule avec elle, sans confusion possible.
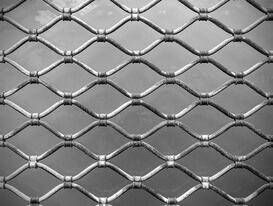
Par cet arrêt, la Cour de cassation nous donne l’opportunité de revenir sur les règles entourant le prononcé de la peine qui ont été notamment remaniées à l’occasion de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Plus particulièrement, il convient de nous intéresser aux courtes peines d’emprisonnement ferme, d’une durée inférieure ou égale à un mois, ayant été supprimées par le législateur, mais qui suscitent toujours un intérêt de la part de certains pouvoirs publics et politiques (v. par ex., Proposition de loi n° 374 visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, adoptée en 1re lecture par le Sénat le 3 avr. 2025).
Afin de mieux comprendre les enjeux posés par l’arrêt, il importe de se référer préalablement aux données de l’espèce. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences aggravées et menaces, un homme a été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, à cinq ans d’inéligibilité, à l’interdiction de percevoir une pension de réversion et au retrait total de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs. En outre, le tribunal correctionnel l’a condamné à six mois d’emprisonnement du chef d’évasion. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision, seulement en ce qui concerne les peines prononcées. Par un arrêt du 19 février 2025, la Cour d’appel de Poitiers a condamné le prévenu des mêmes chefs à trente mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire et, pour les faits d’évasion, à un mois d’emprisonnement. Toutefois, le ministère public a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la juridiction d’appel d’avoir prononcé une peine d’emprisonnement d’un mois, et ce en violation de l’article 132-19 du code pénal.
La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule partiellement la décision de la cour d’appel ayant prononcé une peine d’emprisonnement d’un mois du chef d’évasion. La cassation est limitée à cette peine, les autres sanctions prononcées pour violences aggravées et menaces étant maintenues. La Haute juridiction, aux visas des articles 111-3 et 132-19 du code pénal, rappelle, d’une part, que la juridiction pénale ne peut pas prononcer une peine qui n’est pas prévue par les textes et, d’autre part, qu’aucune peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ne peut être prononcée en réponse à un acte délictuel. Plus encore, les juges du quai de l’Horloge ajoutent que cette interdiction relative au prononcé d’une peine d’emprisonnement comprise entre un jour et un mois subsiste lorsqu’elle est ordonnée en même temps qu’une autre peine et qu’elle se cumule avec elle, sans confusion possible.
L’interdiction de prononcer une peine qui n’est pas prévue par la loi
Pour censurer la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation se fonde tout d’abord sur les dispositions de l’article 111-3 du code pénal relatif au principe de légalité des délits et des peines, qui implique qu’un individu ne peut être poursuivi et condamné que par l’application d’une loi préexistant à l’acte qui lui est reproché. Plus spécifiquement, la Cour se réfère au second alinéa de l’article précité qui dispose que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ».
Dans l’affaire commentée, le prévenu était notamment poursuivi du chef de délit d’évasion, infraction passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € en l’absence de circonstance aggravante (C. pén., art. 434-27, al. 2). La question posée était de savoir si la cour d’appel pouvait légalement condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois pour ce délit. A priori, la juridiction pénale était libre de prononcer une peine d’emprisonnement qui ne pouvait excéder le maximum légal encouru, à savoir trois ans, cette peine devant être individualisée « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (C. pén., art. 132-1). À cette interrogation, la Cour de cassation a – sans surprise – apporté une réponse limpide : dans la mesure où l’article 132-19 du code pénal interdit tout prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois, la juridiction d’appel ne pouvait pas condamner le prévenu à un mois d’emprisonnement du chef d’évasion. Dès lors, la cassation ne pouvait qu’être encourue.
L’interdiction de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’un mois, même conjointement avec une autre et sans confusion possible
L’un des objectifs de la loi du 23 mars 2019 était de limiter le recours aux peines les plus courtes, jugées par le législateur comme désocialisantes et prédisposant à la récidive (v. par ex., A. Simon, L’histoire sans fin de la disparition des courtes peines, Gaz. Pal. n° 40, 19 nov. 2019. 68). Ce faisant, le législateur ne permet plus à la juridiction pénale de prononcer une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois, en application de l’article 132-19 du code pénal. Il faut savoir que cette disposition n’entend aucunement instituer une peine minimale, autrement dit une peine plancher, mais a pour « objectif de supprimer les courtes peines d’emprisonnement et de les remplacer par des peines alternatives » (Crim. 11 mai 2021, n° 20-85.464, D. 2021. 961 ![]() ; AJ pénal 2021. 360, note J. Frinchaboy
; AJ pénal 2021. 360, note J. Frinchaboy ![]() ). En cela, l’objectif est louable en ce que le législateur a souhaité faire reculer le prononcé des peines d’emprisonnement, a fortiori des plus courtes.
). En cela, l’objectif est louable en ce que le législateur a souhaité faire reculer le prononcé des peines d’emprisonnement, a fortiori des plus courtes.
Il convient toutefois de souligner que l’efficacité des peines courtes d’incarcération est sujette à discussions. En effet, la littérature montre aussi que les courtes peines n’ont pas nécessairement d’effet désocialisant et éliminatoire sur les individus : elles ne conduisent généralement ni à la perte du logement, ni à la perte de l’emploi, ni à la perte de la famille et ne sont pas suffisamment longues pour réaliser un effet d’apprentissage social (R. L. Burgess et R. L. Akers, A Differential Association-Reinforcement Theory of Criminal Behavior, Social Problems, 1966, n° 14(2), p. 128).
Cela étant, il faut reconnaître que les courtes peines d’incarcération ne permettent « ni à la personne concernée, ni aux services de probation, de préparer à temps un projet de sortie comportant un minimum d’éléments de nature sociale (not., logement et ressources financières issues du travail ou d’allocations ou aide sociale), sanitaire (non-interruption de la prescription et de l’accès à des médicaments, notamment pour le traitement de pathologies mentales, ou à des produits de substitution) et psycho-criminologique » (Rép. pén., v° Peine : exécution, par M. Herzog-Evans, juin 2025, n° 17). À cet égard, la peine d’emprisonnement d’un mois ne paraît pas forcément la plus appropriée pour sanctionner l’auteur d’un acte délictuel et espérer dans le même temps favoriser son insertion ou réinsertion, ce qui explique en partie qu’elle ait été supprimée.
En toute hypothèse, puisque le législateur interdit depuis mars 2019 le prononcé d’une telle peine d’emprisonnement ferme, inférieure ou égale à un mois, la décision de la cour d’appel ne pouvait qu’être censurée. Les juges d’appel ne pouvaient pas condamner l’auteur des faits à une peine d’un mois d’emprisonnement, et ce même s’ils l’avaient condamné à une autre peine de trente mois, dont six mois avec sursis probatoire, pour des faits de violences aggravées et de menaces. Il importe donc de retenir que, dans tous les cas et si elle l’estime nécessaire, la juridiction pénale doit au moins prononcer une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un mois en réponse à chaque infraction commise par l’auteur, en sachant qu’elle devra ou pourra, selon les situations, faire l’objet d’un aménagement (C. pén., art. 132-19, al. 3 et 132-25 s.).
Finalement, la solution de la Cour de cassation est parfaitement cohérente compte tenu de la règle de droit applicable et rappelle utilement à la juridiction pénale que les textes applicables prohibent le prononcé d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un mois, quand bien même elle est ordonnée conjointement à une autre peine d’incarcération.
Crim. 1er oct. 2025, F-B, n° 25-82.787
par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille
© Lefebvre Dalloz