Rappels utiles au sujet de l’appel principal formé par l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’intimé peut, lorsque le jugement de première instance ne lui a pas été notifié, relever appel principal de ce dernier jusqu’à l’expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 909 du code de procédure civile.
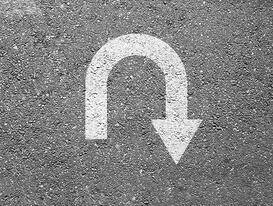
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, la position de l’intimé présente par nature une certaine précarité. Que l’appel principal soit vicié ou que l’appelant ne respecte pas les charges procédurales qui lui incombent, et c’est toute la procédure d’appel qui s’en trouve affectée. Certes, l’intimé qui souhaiterait obtenir la confirmation de la décision attaquée pourrait certainement s’en satisfaire ; celui qui, en revanche, souhaiterait contester la décision de première instance verrait ainsi anéanties ses chances d’obtenir la réformation de la décision. Pour pallier ce risque – qui au regard des nombreuses sanctions qui rythment la procédure d’appel contemporaine ne saurait être ignoré – les parties et leurs conseils ont deux solutions : la première consiste à prendre l’initiative de l’appel sans attendre une éventuelle déclaration d’appel de l’adversaire ; la seconde est de doubler les conclusions d’intimé d’une nouvelle déclaration d’appel qui sera alors jointe au premier appel formé. Dans une récente décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur cette dernière pratique qui, aujourd’hui devenue courante dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, n’en demeure pas moins originale : l’appel principal formé par l’intimé.
Un jugement est rendu par un tribunal judiciaire le 20 octobre 2020 entre plusieurs parties, et précisons-le immédiatement, ce jugement ne leur est pas notifié. Une des parties interjette appel le 18 janvier 2021, une autre le 8 février 2021. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état déclare le second appel irrecevable. L’ordonnance est confirmée par la Cour d’appel de Bastia dans un arrêt du 18 mai 2022. Pour confirmer l’irrecevabilité du second appel, les juges du fond s’appuient sur une analyse littérale des articles 909 et 911-1 – devenu, depuis le 1er septembre 2024, l’article 916 – du code de procédure civile. Ils considèrent qu’aucun de ces deux textes ne donne à l’intimé la possibilité de former appel principal d’une même décision, de telle sorte que cet appel aurait dû être formé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ce dont en l’espèce il n’est pas justifié.
Dans un arrêt rendu le 6 février dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure le raisonnement suivi. Repartant des mêmes articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, la Cour de cassation retient une tout autre analyse et considère que « l’intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés ». Dans le cas d’espèce, le premier appel ayant été relevé le 18 janvier 2021 et les conclusions de l’appelant ne lui ayant pas encore été notifiées, l’intimé pouvait encore relever appel principal du même jugement le 8 février 2021.
L’arrêt, qui doit être approuvé tant dans son principe que dans sa motivation, nous donne l’occasion de revenir sur la figure originale de l’appel principal formé par l’intimé, d’en rappeler l’intérêt pour la partie intimée ainsi que son régime.
L’intérêt de l’appel principal formé par l’intimé
Toutes les parties à une décision de première instance peuvent ne pas s’en satisfaire et vouloir en obtenir la réformation. Pour des considérations pratiques, le code de procédure civile distingue l’appel principal – formé par celui qui prend l’initiative de la critique de la décision –, de l’appel incident et de l’appel provoqué – formés ultérieurement par les autres parties à la décision attaquée. Si tous ces mécanismes poursuivent un même objectif, tous ne sont en revanche pas soumis au même régime (v. pour une illustration récente des différences entre l’appel incident et l’appel provoqué, C. Auché et N. De Andrade, Appel incident et appel provoqué : de faux jumeaux, Dalloz actualité, 22 janv. 2020).
Il faut bien voir que l’appel principal d’un côté et l’appel incident et provoqué de l’autre ne se placent pas sur un même plan. Plus précisément, les appels incident et provoqué se trouvent dans la dépendance de l’appel principal sur lequel ils se greffent. Cette relation de dépendance n’est pas sans conséquence : l’anéantissement de l’appel principal emporte avec lui l’appel incident et l’appel provoqué qui ne peuvent donc en principe lui survivre. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’appel principal est déclaré caduc (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.801, Dalloz actualité, 1er juin 2015, obs. M. Kebir ; D. 2015. 1423 ![]() , note C. Bléry et L. Raschel
, note C. Bléry et L. Raschel ![]() ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle ![]() ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero
; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ![]() ; Gaz. Pal. 2015, n° 265, p. 9 obs. N. Hoffschir ; Procédures 2015, n° 7, p. 11, note H. Croze) ou irrecevable (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 18-21.550, Dalloz actualité, 11 janv. 2021, obs. C. Lhermitte ; Gaz. Pal. 2021, n° 4, p. 78, obs. V. Egéa). Il convient néanmoins de préciser : si l’appel incident ou provoqué a été formé hors délai pour interjeter appel principal, il suivra le sort de ce dernier et sera donc anéanti en cas de caducité ou d’irrecevabilité ; en revanche, si l’appel incident ou provoqué a été interjeté dans le délai pour former appel principal, la caducité ou l’irrecevabilité n’aura aucun effet sur lui (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-10.726, Dalloz actualité, 24 oct. 2020, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 2021, n° 4, p. 76 obs. N. Hoffschir). En dépit de cette dernière réserve, force est de constater que la position dans laquelle se trouve l’intimé présente un certain état de précarité. D’autant plus qu’en l’état actuel de la procédure d’appel, les occasions de voir disparaître l’appel principal sont nombreuses. Il faut bien voir, en outre, que le jour où l’anéantissement de l’appel principal sera prononcé, l’intimé se trouvera bien souvent forclos pour agir à titre principal, le délai pour interjeter appel ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision attaquée.
; Gaz. Pal. 2015, n° 265, p. 9 obs. N. Hoffschir ; Procédures 2015, n° 7, p. 11, note H. Croze) ou irrecevable (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 18-21.550, Dalloz actualité, 11 janv. 2021, obs. C. Lhermitte ; Gaz. Pal. 2021, n° 4, p. 78, obs. V. Egéa). Il convient néanmoins de préciser : si l’appel incident ou provoqué a été formé hors délai pour interjeter appel principal, il suivra le sort de ce dernier et sera donc anéanti en cas de caducité ou d’irrecevabilité ; en revanche, si l’appel incident ou provoqué a été interjeté dans le délai pour former appel principal, la caducité ou l’irrecevabilité n’aura aucun effet sur lui (Civ. 2e, 1er oct. 2020, n° 19-10.726, Dalloz actualité, 24 oct. 2020, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 2021, n° 4, p. 76 obs. N. Hoffschir). En dépit de cette dernière réserve, force est de constater que la position dans laquelle se trouve l’intimé présente un certain état de précarité. D’autant plus qu’en l’état actuel de la procédure d’appel, les occasions de voir disparaître l’appel principal sont nombreuses. Il faut bien voir, en outre, que le jour où l’anéantissement de l’appel principal sera prononcé, l’intimé se trouvera bien souvent forclos pour agir à titre principal, le délai pour interjeter appel ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision attaquée.
La situation de l’intimé n’est pas vraiment plus confortable, dans l’hypothèse où la décision de première instance ne lui aurait pas été notifiée. Consacrant une jurisprudence bien établie (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n° 13-24.142, Dalloz actualité, 9 déc. 2014, obs. M. Kebir ; Procédures 2015, n° 1, p. 34, note H. Croze ; 13 mai 2015, n° 14-13.801, préc. ; 12 mai 2016, n° 15-18.906, D. 2017. 422, obs. N. Fricero ![]() ; Procédures 2016, n° 7, p. 17, note H. Croze ; 13 oct. 2016, n° 15-25.926, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2017. 92
; Procédures 2016, n° 7, p. 17, note H. Croze ; 13 oct. 2016, n° 15-25.926, Dalloz actualité, 7 nov. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2017. 92 ![]() , note N. Hoffschir
, note N. Hoffschir ![]() ; ibid. 422, obs. N. Fricero
; ibid. 422, obs. N. Fricero ![]() ), le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile est venu poser un « principe de concentration des appels » (Circ. du 4 août 2017). L’ancien article 911-1 – aujourd’hui 916 – du code de procédure civile fait désormais obstacle à ce qu’un intimé puisse, après la disparition d’un premier appel principal, relever appel du même jugement de première instance dès lors que les conclusions de l’appelant lui ont été régulièrement notifiées et qu’il n’a pas formé appel incident ou provoqué dans les délais impartis ou dès lors que son appel incident a été déclaré irrecevable. L’objectif de cette disposition est clair : il s’agit d’exclure « pour les parties négligentes toute possibilité de rattrapage du seul fait de l’absence de signification du jugement » (Circ. du 4 août 2017). Si le mécanisme, qui participe « à assurer l’efficacité de la procédure d’appel » (CE 13 nov. 2019, nos 412255, 412286, 412287, 412308 et 415651, Dalloz actualité, 29 nov. 2019, obs. R. Laffly), peut certainement se justifier dans son principe, il oblige les parties et leurs conseils à davantage de prudence, car l’absence de notification du jugement de première instance ne protège plus suffisamment l’intimé, dont le sort se trouve, dans cette hypothèse également, lié à celui de l’appelant.
), le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile est venu poser un « principe de concentration des appels » (Circ. du 4 août 2017). L’ancien article 911-1 – aujourd’hui 916 – du code de procédure civile fait désormais obstacle à ce qu’un intimé puisse, après la disparition d’un premier appel principal, relever appel du même jugement de première instance dès lors que les conclusions de l’appelant lui ont été régulièrement notifiées et qu’il n’a pas formé appel incident ou provoqué dans les délais impartis ou dès lors que son appel incident a été déclaré irrecevable. L’objectif de cette disposition est clair : il s’agit d’exclure « pour les parties négligentes toute possibilité de rattrapage du seul fait de l’absence de signification du jugement » (Circ. du 4 août 2017). Si le mécanisme, qui participe « à assurer l’efficacité de la procédure d’appel » (CE 13 nov. 2019, nos 412255, 412286, 412287, 412308 et 415651, Dalloz actualité, 29 nov. 2019, obs. R. Laffly), peut certainement se justifier dans son principe, il oblige les parties et leurs conseils à davantage de prudence, car l’absence de notification du jugement de première instance ne protège plus suffisamment l’intimé, dont le sort se trouve, dans cette hypothèse également, lié à celui de l’appelant.
Pour pallier le risque de voir disparaître leur appel incident ou provoqué du fait des manquements de l’appelant, les parties intimées et leurs conseils ont tout intérêt à prendre l’initiative de l’appel, ou dans le cas où leur adversaire aurait été plus diligent, à doubler leurs conclusions d’intimé d’une nouvelle déclaration d’appel. La pratique de l’appel principal formé par une partie déjà intimée par un premier appel passe assurément pour originale ; elle peut même en pratique soulever certaines difficultés – la jonction qui sera réalisée entre l’appel principal formé par l’appelant et l’appel principal formé par l’intimé ne constitue qu’une mesure d’administration judiciaire qui ne permet pas la fusion parfaite des deux procédures dans une instance unique (Soc. 24 sept. 2014, n° 13-19.467). La pratique de l’appel principal formé par l’intimé reste malgré tout nécessaire pour préserver son droit à la critique de la décision rendue en première instance.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 février dernier, c’est précisément ce qu’ont cherché à faire les parties intimées par l’appelant principal en relevant un nouvel appel contre la même décision afin de « se préserver des risques d’une éventuelle irrecevabilité de l’appel formé » par l’appelant. Si l’opportunité de l’appel principal formé par l’intimé n’est pas remise en cause devant la Cour d’appel de Bastia qui reconnaît elle-même qu’« il n’est pas contestable que le fait de former un appel principal présente un intérêt majeur pour un intimé à un premier appel de la même décision » (Bastia, 18 mai 2022, n° 22/00047), une incertitude pouvait demeurer quant à son régime.
Le régime de l’appel principal formé par l’intimé
Pour le conseiller de la mise en état, comme pour la Cour d’appel de Bastia, l’appel formé par l’intimé « doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ». Ce délai n’ayant pas été respecté en l’espèce, l’appel interjeté le 8 février 2021 devait être déclaré irrecevable.
La motivation peut convaincre lorsque la décision de première instance a été notifiée aux parties. Dans ce cas de figure, il n’est en effet aucune raison que l’intimé se voit reconnaître un délai plus long pour interjeter appel que celui laissé à l’appelant. Une solution inverse serait du reste contraire au principe de l’égalité des armes, qui implique qu’une partie ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à une autre (v. déjà, sur la question des délais impartis aux parties pour exercer une voie de recours en matière criminelle, Crim. 17 sept. 2008, n° 08-80.598, Dalloz actualité, 2 oct. 2008, obs. C. Girault ; D. 2009. 44, chron. P. Chaumont et E. Degorce ![]() ; AJ pénal 2008. 456
; AJ pénal 2008. 456 ![]() , étude C. Saas
, étude C. Saas ![]() ). De la sorte, toutes les parties auxquelles la décision de première instance a été notifiée sont soumises au délai de droit commun d’un mois à compter de la notification du jugement pour relever appel.
). De la sorte, toutes les parties auxquelles la décision de première instance a été notifiée sont soumises au délai de droit commun d’un mois à compter de la notification du jugement pour relever appel.
Il en va toutefois nécessairement autrement lorsque, comme en l’espèce, le jugement de première instance n’a pas été notifié aux parties, car le délai d’un mois pour interjeter appel n’a pas commencé à courir. Dans ce cas de figure, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise donc – là, réside l’apport principal de l’arrêt du 6 février 2025 – que l’intimé doit former appel principal de la décision dans les délais qui lui sont impartis pour conclure aux articles 905-2 et 909 du code de procédure civile.
À s’en tenir à une lecture rapide, la solution pourrait paraître aggraver le sort de l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire. Alors que l’appelant bénéficie, lorsque la décision de première instance n’a pas été notifiée aux parties, de deux ans pour interjeter appel (C. pr. civ., art. 528-1), l’intimé voit quant à lui son appel enfermé dans les délais, nécessairement plus courts, des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile. Néanmoins, l’argument tiré d’une éventuelle violation du principe de l’égalité des armes doit être immédiatement écarté. Il faut bien voir que le délai laissé à l’intimé pour former appel principal court à compter de la notification des conclusions de l’appelant. De la sorte, l’intimé aura toujours disposé, en pratique, d’un délai plus long que celui dont a bénéficié l’appelant pour relever appel de la décision de première instance.
En réalité, la solution se déduit assez logiquement de la lecture de l’article 911-1 – aujourd’hui 916 – du code de procédure civile et du principe de concentration des appels qu’il pose. Rappelons-le, l’objet de ce principe est essentiellement de faire obstacle à ce qu’une personne intimée à une procédure d’appel puisse profiter de l’absence de notification du jugement attaquée pour relever appel de cette même décision. Bien sûr, la concentration n’est applicable que dans le cas où l’intimé n’aurait pas déjà sollicité la réformation de la décision attaquée et formé appel incident. Derrière le mécanisme de l’article 911-1 – devenu 916 – du code de procédure civile, la question est donc de savoir si l’intimé souhaite ou non obtenir la réformation de la décision de première instance. La volonté de l’intimé pouvant s’exprimer dans les délais qui lui sont laissés pour conclure, il est somme toute logique de lui laisser la possibilité de relever appel principal du jugement attaqué jusqu’à l’expiration de ces mêmes délais.
La solution qui consiste à faire coïncider le délai laissé à l’intimé pour former appel principal avec le délai imparti pour conclure et, le cas échéant, relever appel incident ou provoqué nous semble plutôt convaincante. Elle nous semble trouver un juste équilibre entre la recherche d’une procédure d’appel efficace, et la protection du droit de critique de la décision rendue en première instance par l’intimé, lorsque la voie d’appel lui est ouverte. Il est à espérer qu’un même équilibre guide les prochaines décisions rendues sur l’appel principal formé par l’intimé, pratique, qui au regard de la complexité de la procédure d’appel actuelle et des nombreuses sanctions qui la parcourent, a certainement encore de beaux jours devant elle.
Civ. 2e, 6 févr. 2025, F-B, n° 22-18.971
© Lefebvre Dalloz