Reçu pour solde de tout compte non signé : quel effet sur le délai de prescription ?
Il résulte des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
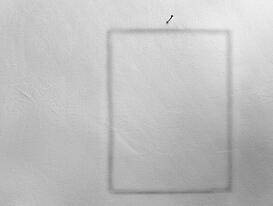
Trente-deux ans après son recrutement en qualité d’ajusteur mécanicien machine par la société Renault, un salarié est licencié pour faute. De la dispense d’exécution du préavis on doit déduire que l’employeur n’a pas retenu les qualifications de faute grave ou lourde. Moins de deux semaines après la fin de ce préavis, il est incarcéré pour une durée de quatre ans. Cinq mois après sa levée d’écrous, il saisit la juridiction prud’homale territorialement compétente de diverses demandes relatives à des sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte ainsi que des indemnités pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Au motif que le salarié n’a jamais signé ledit reçu et que celui-ci n’a donc jamais eu d’effet libératoire, les juges du fond accèdent aux demandes du requérant. Dans son pourvoi l’employeur considère pourtant les demandes prescrites.
Par l’arrêt commenté du 14 novembre 2024 et publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision litigieuse au visa notamment des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013). Après avoir rappelé mot pour mot le contenu des dispositions précitées, elle ajoute en substance que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié plusieurs documents sociaux que sont le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail, l’attestation d’assurance chômage et le reçu pour solde de tout compte. Ce dernier fait l’inventaire des sommes versées au salarié au moment de ladite rupture quelle qu’en soit la cause, unilatérale ou négociée. Quérable et non portable, l’employeur doit se contenter de le laisser à la disposition du travailleur (Soc. 1er juill. 2015, n° 13-26.850, RJS 11/2015, n° 709) qui dispose d’un délai de six mois pour le dénoncer – sans motivation obligatoire – à compter de sa signature. Au-delà, il devient libératoire pour l’employeur mais uniquement pour les sommes qui y sont mentionnées. Ce régime doit être articulé avec les termes de l’article L. 1471-1 du code du travail selon lequel – antérieurement à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 – toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
Pour emporter extinction des obligations mentionnées dans le reçu, celui-ci doit comporter la signature du salarié et, de façon certaine, la date de cette signature (Soc. 20 févr. 2019, n° 17-24.600, JCP S 2019. 1109, note L. Paoli). En revanche, la mention du délai de six mois précitée n’est pas impérative (Soc. 4 nov. 2015, n° 14-10.657 P, Dalloz actualité, 4 déc. 2015, obs. A. Doutreleau ; D. 2015. 2322 ![]() ; Dr. soc. 2016. 91, obs. J. Mouly
; Dr. soc. 2016. 91, obs. J. Mouly ![]() ). Ainsi s’explique l’affirmation de l’arrêt commenté selon lequel « le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ». Dans l’intérêt du salarié le formalisme est important mais l’employeur a aussi intérêt à ce que le reçu soit signé rapidement après la rupture du contrat pour être « libéré » au plus vite. En l’espèce, le problème tenait au fait que le salarié avait été incarcéré pour une durée de quatre ans – douze jours seulement après la fin du préavis – et qu’il n’avait pas pu signer le document litigieux. Dans ces conditions, pour la cour d’appel, ce dernier n’avait produit aucun effet libératoire et aucune prescription n’avait commencé à courir si bien qu’il était recevable à saisir le juge à sa sortie de prison pour faire valoir ses droits. Toutefois, ce raisonnement faisait fi de l’article L. 1471-1 qui permet à un salarié d’être rempli de ses droits en saisissant le juge dans les deux ans qui suivent la rupture du contrat. En l’espèce la cour d’appel avait pris soin de relever que ce délai prenait fin le 16 juin 2015.
). Ainsi s’explique l’affirmation de l’arrêt commenté selon lequel « le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées ». Dans l’intérêt du salarié le formalisme est important mais l’employeur a aussi intérêt à ce que le reçu soit signé rapidement après la rupture du contrat pour être « libéré » au plus vite. En l’espèce, le problème tenait au fait que le salarié avait été incarcéré pour une durée de quatre ans – douze jours seulement après la fin du préavis – et qu’il n’avait pas pu signer le document litigieux. Dans ces conditions, pour la cour d’appel, ce dernier n’avait produit aucun effet libératoire et aucune prescription n’avait commencé à courir si bien qu’il était recevable à saisir le juge à sa sortie de prison pour faire valoir ses droits. Toutefois, ce raisonnement faisait fi de l’article L. 1471-1 qui permet à un salarié d’être rempli de ses droits en saisissant le juge dans les deux ans qui suivent la rupture du contrat. En l’espèce la cour d’appel avait pris soin de relever que ce délai prenait fin le 16 juin 2015.
L’absence de signature du reçu permettait donc au salarié de ne pas être tenu par le délai de six mois mais uniquement dans la limite des deux ans, posée à l’article L. 1471-1. Pour que le droit d’agir dépasse cette limite, il aurait fallu que les juges du fond justifient d’« une cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription » c’est-à-dire d’une « impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultat de la loi, de la convention ou de la force majeure ». De la décision commentée il s’infère que l’incarcération du salarié ne constitue pas une telle cause comme l’avait déjà décidé les magistrats du quai de l’Horloge (Soc. 15 oct. 1996, n° 93-43.668 P, D. 1996. 246 ![]() ; Dr. soc. 1997. 246, note P.-H. Antonmattei
; Dr. soc. 1997. 246, note P.-H. Antonmattei ![]() ).
).
Soc. 16 nov. 2024, F-B, n° 21-22.540
© Lefebvre Dalloz