Règlement Rome II : notion de disposition impérative obligatoire
Par un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce, de façon insatisfaisante, sur une question préjudicielle visant à déterminer si la loi bulgare sur les obligations prévoyant que « la réparation du préjudice immatériel est déterminée par le juge en équité » est ou non une loi de police.
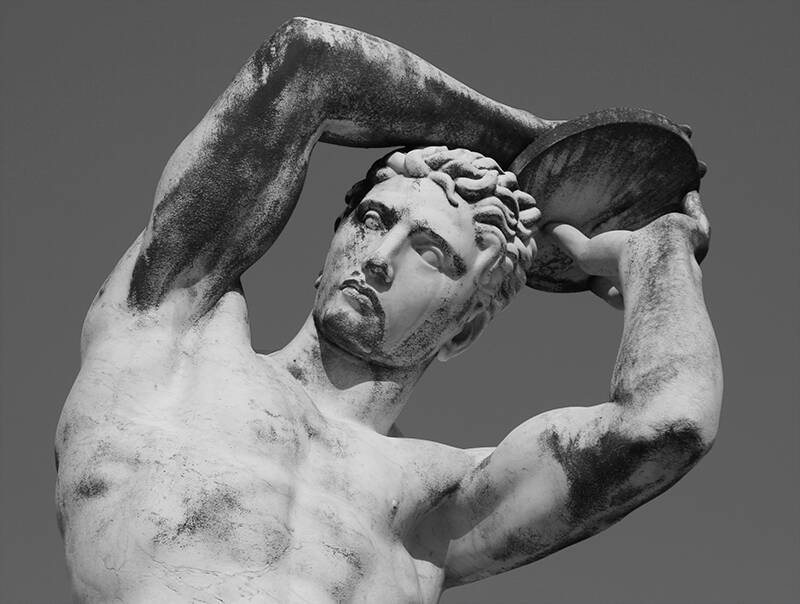
Le règlement Rome II (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, selon son article 1, § 1.
Par son article 4, § 1, il prévoit que, sauf dispositions contraires, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Il envisage par ailleurs, par son article 16, l’hypothèse dans laquelle il existe des « dispositions impératives dérogatoires » du for : « Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle ». Même si cette expression n’a pas été utilisée par les rédacteurs du règlement, il s’agit ainsi de réserver l’application des lois de police du for (P. de Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, 11e éd., Dalloz, 2023, n° 1514).
Rappelons, à ce sujet, qu’il est admis que la notion de loi de police peut être, dans le cadre du règlement Rome II, définie comme le fait, en matière contractuelle, le règlement Rome I (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (sur la loi applicable aux obligations contractuelles), dont l’article 9, § 1, énonce qu’une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
L’affaire jugée le 5 septembre 2024 donne à la Cour de justice l’occasion de donner une illustration de ces principes.
Une personne, de nationalité bulgare mais établie en Allemagne, est décédée en Allemagne lors d’un accident de la circulation routière. Le responsable, de nationalité bulgare et établi en Allemagne, était assuré par une compagnie allemande. Les parents de la victime, de nationalité bulgare et domiciliés en Bulgarie, ont alors saisi le juge bulgare en demandant la réparation de leur préjudice immatériel.
Le droit allemand était en principe applicable en application de l’article 4, § 1, du règlement Rome II. Néanmoins, les parents ont soutenu que le droit bulgare devait être mis en œuvre en tant que loi de police, la loi bulgare sur les obligations prévoyant que « la réparation du préjudice immatériel est déterminée par le juge en équité ».
La question était donc de déterminer si une telle disposition devait être qualifiée de loi de police.
Afin de cerner la solution énoncée par la Cour de justice, il est nécessaire de rappeler que, s’agissant de l’identification éventuelle d’une « disposition impérative dérogatoire », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, le juge national doit constater, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement (CJUE 31 janv. 2019, aff. C‑149/18, pt 31, D. 2019. 257 ![]() ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ![]() ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ![]() ; Rev. crit. DIP 2019. 557, note D. Bureau
; Rev. crit. DIP 2019. 557, note D. Bureau ![]() ; RTD eur. 2019. 869, étude M. Ho-Dac
; RTD eur. 2019. 869, étude M. Ho-Dac ![]() ). Ainsi, le juge doit examiner si la disposition considérée a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l’État membre du for considère comme essentiels et si son respect est jugé crucial par cet État membre pour la sauvegarde de ces intérêts (arrêt, pt 41), l’application de cette disposition devant s’avérer absolument nécessaire pour protéger l’intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d’espèce (arrêt, pt 42). Il faut également rappeler que puisqu’une loi de police vise la sauvegarde d’intérêts publics, il y a lieu de considérer qu’une loi qui vise la protection d’intérêts individuels ne peut être qualifiée de loi de police que dans la mesure où la protection de tels intérêts correspond à un intérêt public essentiel (arrêt, pts 45 et 46).
). Ainsi, le juge doit examiner si la disposition considérée a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l’État membre du for considère comme essentiels et si son respect est jugé crucial par cet État membre pour la sauvegarde de ces intérêts (arrêt, pt 41), l’application de cette disposition devant s’avérer absolument nécessaire pour protéger l’intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d’espèce (arrêt, pt 42). Il faut également rappeler que puisqu’une loi de police vise la sauvegarde d’intérêts publics, il y a lieu de considérer qu’une loi qui vise la protection d’intérêts individuels ne peut être qualifiée de loi de police que dans la mesure où la protection de tels intérêts correspond à un intérêt public essentiel (arrêt, pts 45 et 46).
Dans l’affaire soumise à la Cour de justice, la disposition bulgare dont la qualification de loi de police était discutée visait la protection des intérêts individuels de personnes ayant subi un préjudice immatériel.
À ce sujet, l’arrêt fournit la réponse suivante : l’article 16 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’« une disposition nationale qui prévoit que l’indemnisation du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche d’une personne décédée lors d’un accident de la circulation est déterminée par le juge en équité ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que, lorsque la situation juridique en cause présente des liens suffisamment étroits avec l’État membre du for, la juridiction saisie constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition nationale, que son respect est jugé crucial au sein de l’ordre juridique de cet État membre, au motif qu’elle poursuit un objectif de protection d’un intérêt public essentiel qui ne peut pas être atteint par l’application de la loi désignée en vertu de l’article 4 de ce règlement ».
Cet arrêt du 5 juillet 2024 mérite de retenir l’attention car la jurisprudence relative à la détermination des lois de police en matière de responsabilité extracontractuelle est rare (par ex., retenant que la législation française concernant l’indemnisation des victimes d’infractions par les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions a le caractère d’une loi d’application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger, Civ. 2e, 3 juin 2004, n° 02-12.989, D. 2005. 1198 ![]() ; ibid. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup
; ibid. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ![]() ; Rev. crit. DIP 2004. 750, note D. Bureau
; Rev. crit. DIP 2004. 750, note D. Bureau ![]() ; Dr. et patr. 2004, n° 131, obs. Fr. Monéger ; RCA 2004. 7, obs. H. Groutel ; retenant que l’art. 65 de la loi du 29 juill. 1881 est une loi de police et d’application immédiate, Civ. 1re, 19 oct. 2004, n° 02-15.680, D. 2005. 878
; Dr. et patr. 2004, n° 131, obs. Fr. Monéger ; RCA 2004. 7, obs. H. Groutel ; retenant que l’art. 65 de la loi du 29 juill. 1881 est une loi de police et d’application immédiate, Civ. 1re, 19 oct. 2004, n° 02-15.680, D. 2005. 878 ![]() , note C. Montfort
, note C. Montfort ![]() ; ibid. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup
; ibid. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup ![]() ).
).
Cependant, cet arrêt n’en demeure pas moins insatisfaisant. Sur la forme, son style est alambiqué, ce qui ne facilite pas la compréhension du raisonnement mis en œuvre. Sur le fond, la réponse qu’il apporte est décevante car la Cour de justice retient en substance que la loi bulgare dont la qualification était recherchée n’est pas en principe une loi de police, sauf si les critères de définition des lois de police sont réunis. L’arrêt ne permet donc pas d’en savoir plus sur cette qualification, qui était pourtant l’objet de la question préjudicielle.
CJUE 5 sept. 2024, aff. C-86/23
Lefebvre Dalloz